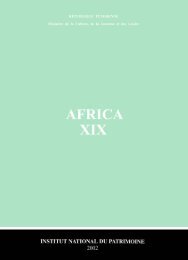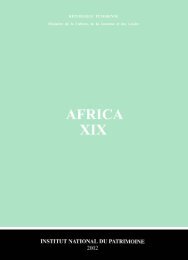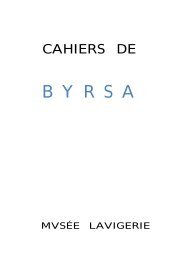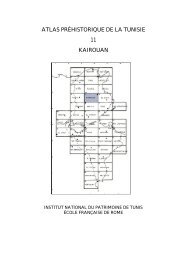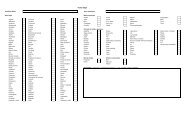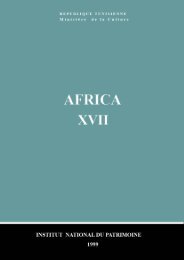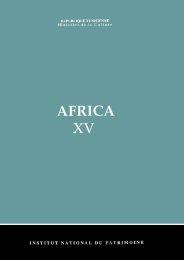africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Africa XIII/L'Etat économique de l'Afrique byzantine d'après les récits des chroniqueurs arabes Abdelatif MRABET<br />
tardive (19) , le chiffre de 300 centenaires, loin d'être atypique, peut même paraître<br />
modeste. Pensons, par exemple, aux 1300 centenaria mentionnés par Procope à propos<br />
de l'expédition byzantine montée contre les Vandales en 468 ap. J - C (20) ; ou encore,<br />
toujours selon le même auteur, aux 4000 centenaria encaissés et dépensés par<br />
l'empereur Justinien (21) .<br />
Quoi qu'il en soit, même révisés à la baisse, voire diminués de moitié ou davantage, ces<br />
chiffres donnés par les différents chroniqueurs arabes, constituent une importante<br />
information économique ; ils nous révèlent que l'Afrique <strong>du</strong> VIIème siècle est<br />
monétairement riche (22) . Cette richesse était d'autant plus importante que les sources, à<br />
plusieurs reprises, font état de différents autres butins monétaires ; les chroniqueurs, le<br />
plus souvent à court d'informations, ne pouvant évaluer les prises, se contentaient<br />
simplement de la vague mention de butin sans davantage de précision. Ces mentions<br />
"silencieuses" sont bien plus nombreuses que les indications chiffrées. Il ne faut pas<br />
oublier que lors des premières campagnes, notamment pendant les raids de 647 et de<br />
648 en Byzacéne, le pillage, la confiscation et la rançon ont été des faits de guerre<br />
d'autant plus fréquents que les soldats arabes qui ne touchaient pas de soldes, ne se<br />
sentaient investis d'aucune mission particulière (23) ; leur dirigeants qui n'avaient pas<br />
encore arrêté de politique précise à l'égard de cette Ifriqya que l'on disait "trompeuse et<br />
perfide" (24) , cherchaient à tirer le meilleur parti des ressources <strong>du</strong> pays et de s'en<br />
retourner aussitôt en Egypte. En 647-648, le butin était si fabuleux qu'Abdallah b. Saad<br />
bien avant qu'on lui proposât les fameux 300 qintar.écrivit à son lieutenant en Egypte et<br />
"lui ordonna de lui envoyer, par mer, des bateaux, dans lesquels, il chargerait les<br />
richesses dont les musulmans s'étaient emparés "(25) .<br />
Indirectement, de la même manière qu'ils nous permettent d'inventorier certaines<br />
ressources <strong>africa</strong>ines, les récits arabes de la conquête nous donnent une image de la<br />
répartition de la richesse dans l'espace maghrébin ; sur le plan monétaire, l'inégalité<br />
paraît flagrante. De toute évidence, le butin suit l'opulence ; l'Ifriqya, c'est à dire la<br />
Byzacéne et la Proconsulaire, est la partie la plus riche d'Afrique <strong>du</strong> Nord. En 648, ce<br />
sont des habitants de Byzacéne, retranchés dans l'amphithéâtre de Thysdrus (El-Djem,<br />
Tunisie) (26) qui s'inquiètent de voir Abdallah b. Saad lancer ses détachements "dans<br />
toutes les directions" et faire un "butin considérable " (27) ; finalement , face à l'intensité<br />
accordé par Grégoire (sic) à Abdallah b. Saad ; voir Masse H. : "La chronique d'Ibn A'tham et la conquête de<br />
l'Ifriqiya", dans Mélanges Gaudefroy-Demombynes, le Caire, 1935-1945, p 89.<br />
Rappelons aussi que beaucoup d'auteurs modernes ont commis l'erreur de confondre le qintar avec notre quintal<br />
métrique (100 kgs).<br />
(20)<br />
A ce sujet, voir entre autres, Callu J.P., "Le centenarium", p. 304 et suivi.<br />
(21)<br />
procOpe :"La guerre contre les Vandales" trad. et comm. de Roques D. , les Belles Lettres, Paris, 1990, p.48 et<br />
notel,p.231.<br />
(22)<br />
procope : "Historia arcana ", XIX, 7-8 ; cité par J.P Callu, "Le centenarium", p.307.<br />
Dans un tout autre contexte, mais toujours en témoignage d'une certaine abondance monétaire, rappelons l'évaluation<br />
par Diehl Ch. <strong>du</strong> montant des appointements annuels des agents de l'administration byzantine civile et militaire<br />
d'Afrique, soit, respectivement, 17.423 et 9.026 solidi, ceci sans compter la solde des soldats et le traitement <strong>du</strong><br />
Magister militum... Voir Diehl Ch., "L'Afrique byzantine".<br />
(23)<br />
A la suite des événements de 647 et après le départ des troupes d'Abdallah b. Saad, Héraclius exigea des<br />
Africains une somme égale à celle qu'ils avaient donnée au général arabe. Cette information donnée par An-Nuwaïri<br />
et par Al-Baladhuri lequel, cite à son tour le chroniqueur ziride Ar-Raqiq laisse entendre que les potentialités<br />
monétaires <strong>africa</strong>ines étaient réellement importantes. Voir An-Nuwaïri, "Nihayat" dans l'histoire des Berbères, Ibn<br />
Khaldoun, De Slane, T 1, p. 324 ; Al-Baladhuri, "Al Bayan...", p.17.<br />
(24)<br />
Comme le disait si bien Talbi M. : "L'orient venait chercher en Ifriqiya la Sahada, certes, mais ne faisait pas fi<br />
<strong>du</strong> butin ..." Talbi M. "L'Emirat", p.23.<br />
(25)<br />
Propos prêtés au calife Omar ibn el-Khattab ; voir entre autres, Ibn Abd al-Hakam, "Conquête"..., p.41.<br />
(26)<br />
Al-Maliki : "Riadh an-Noufous"...", d'après Caudel, "Les premières invasions...", p 73.<br />
(27)<br />
J C'est Ibn al-Athir qui donne cette information reprise par an-Nuwaïri ; voir Ibn Al-Athir, "Al-Kamil...", d'après<br />
Claudel, op. cite, p.72 ; An-Nuwaïri, "Nihayat" dans "histoire des Berbères", op. cite, p.322. L'archéologie semble<br />
confirmer l'utilisation de l'amphithéâtre d'El-Djem à des fins de fortification.<br />
(28)<br />
Ibn Abd al-Hakam, "Conquête...", p43.<br />
126