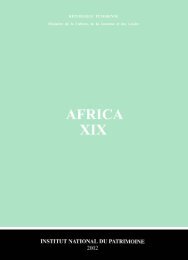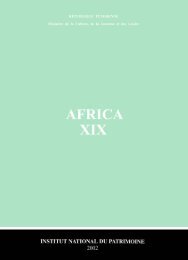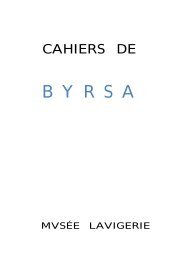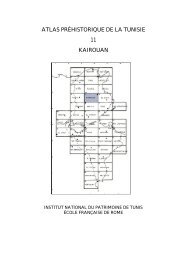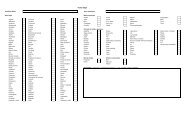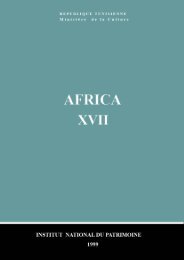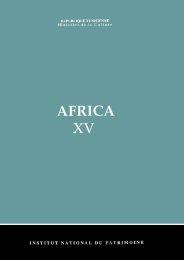africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Africa XIII/ABOU-FIHR : un monument hydraulique hafside <strong>du</strong> XIIIème siècle : Archéologie et Histoire Adnan LOUHICHI<br />
qui incitèrent en 1912 le Secrétaire Général <strong>du</strong> Gouvernement Tunisien à classer par<br />
décret le bassin comme monument historique (1) . Le site a été découvert et identifié<br />
comme étant celui d'Abu-Fihr par Paul Gauckler en 1902 (2) .<br />
L'OEUVRE HYDRAULIQUE DU SULTAN<br />
Le jardin princier Abu-Fihr est l'oeuvre <strong>du</strong> Sultan Hafside Abu-Abdallah, alias<br />
al-Mustansir (1249-1277), fils d'Abu-Zakariya, fondateur de l'Etat Hafside en 1228 (3) .<br />
Abu-Fihr fait partie d'un vaste projet hydraulique. Il s'agit des travaux qui permirent<br />
l'ad<strong>du</strong>ction de l'eau des sources de Zaghouan vers la capitale, dont essentiellement la<br />
Mosquée Zitouna et vers le jardin princier. Ils prirent fin en l'an 666 H - 1267.<br />
Az-Zarkasi nous apprend que les travaux débutèrent en 648-1250, c'est à dire,<br />
un an après l'avènement <strong>du</strong> sultan et qu'ils s'achevèrent en 666 H. Il précise également<br />
qu'al-Mustansir a dû restaurer l'aque<strong>du</strong>c romain et le remettre en état de fonctionnement<br />
pour drainer l'eau de Zaghouan vers Tunis et Abu-Fihr. Les mêmes informations se<br />
retrouvent dans d'autres sources.<br />
Al-Abdari corrobore les dires d'az-Zarkasi ainsi qu'al-Omari qui spécifie en outre que<br />
Abu-Fihr se trouve "à une distance de trois milles environ de la ville. L'eau est amenée<br />
dans l'un et dans l'autre par un canal qui vient de Zagwan, une montagne à deux<br />
journées de Tunis, une branche en pénètre dans la citadelle". Ibn Abi-dinar donne aussi<br />
la date de 666 H comme celle de la fin des travaux de restauration de l'aque<strong>du</strong>c (4) .<br />
L'oeuvre de ce calife fut à la fois grandiose et onéreuse. Il aurait fallu dix-huit<br />
années de travail et des milliers d'hommes pour la parachever.<br />
Soulignac affirme que 116 Km d'aque<strong>du</strong>c sur les 132 que compte celui de<br />
l'empereur Hadrien ont été restaurés ou reconstruits (5) .<br />
Il a fallut surtout construire un nouveau tronçon d'aque<strong>du</strong>c pour desservir la ville de<br />
Tunis. Une partie monumentale de ce tronçon, assez bien conservée mesurant près de<br />
1000m de long, relie Ras-al-Tabiya à la colline de la Rabta. C'est l'aque<strong>du</strong>c <strong>du</strong> Bardo.<br />
Cet ouvrage situé aux portes de Tunis a été particulièrement soigné. En sus des<br />
exigences architectoniques, l'esthétique y a prévalu également. Prestige et ostentation<br />
ne sont sans doute pas étrangers aux raisons qui ont présidé au choix de cette<br />
architecture de l'eau. "Il traverse, supporté par une longue et belle suite d'arches, la<br />
plaine située entre Ras al-Tabiya et la colline de la Rabta qui domine la ville au<br />
Nord-Ouest. Cette partie de l'ad<strong>du</strong>ction, d'une exécution parfaitement élégante et<br />
soignée... est connue sous le nom d'acque<strong>du</strong>c <strong>du</strong> Bardo" (6) .<br />
Une seconde partie de cette ad<strong>du</strong>ction qui relie la Rabta à la Qasba de Tunis<br />
probablement, a aujourd'hui complètement disparu. Solignac a réussi à en retrouver<br />
quelques traces permettant de définir approximativement le tracé de l'ouvrage aux<br />
approches de la ville. Ce dernier devait aboutir à un bassin d'arrivée. A partir de ce<br />
point, un système de canalisation assurait, d'après al-Abdari, l'ad<strong>du</strong>ction de l'eau vers la<br />
Grande Mosquée Zitouna (7) . Cette mosquée était également pourvue d'un réseau<br />
(1)<br />
Journal Officiel <strong>du</strong> 23 mars 1912 ; décret <strong>du</strong> 13 mars 1912.<br />
(2)<br />
Solignac 1936 p.533.<br />
(3)<br />
Abu Abdallah se proclama calife avec le titre "amir al-Muminin" en 1253 et se gratifia <strong>du</strong> surnom al-Mustansir<br />
billah.<br />
(4)<br />
Az-Zarkassi "Tarin ad-Dawlatayn", p.33 et p.38.<br />
Al-Abdari , "al-Rihla al Maghribiya", pp.40- 41<br />
Al-Omari, " Masalik " pp. 111 -112.<br />
Ibn Abi Dinar, "Al-Mounis ", pp.120-121.<br />
(5)<br />
Solignac, 1936., p.521 n'argumente pas cette affirmation par des données archéologiques.<br />
(6) Ibid. P. 523.<br />
(7) Al Abdari, "Al-Rihla.." p. 40<br />
156