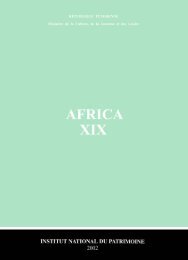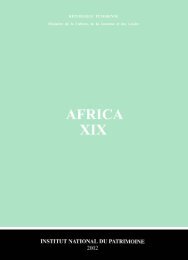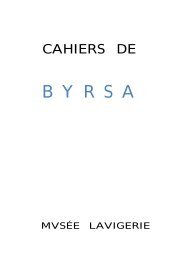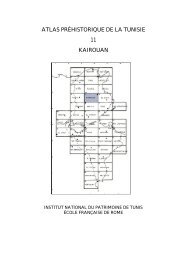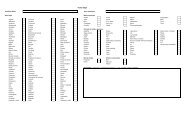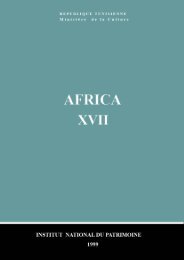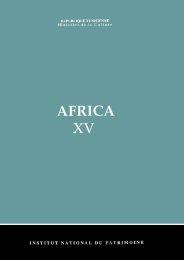africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Africa XIII/Monastir au 19ème siècle, à propos de la ville et de l'urbanisme arabo-musulman MedMoncef M'HALLA<br />
ensemble de constructions (habitations et autres). Elle n'est matérialisée que par ces<br />
voies, mais la délimitation de sa configuration sur une carte n'est pas possible, même de<br />
visu elle n'est pas accessible, la limite interne étant donnée par la profondeur des<br />
maisons, domaine de l'interdit, "hurma." Voyons sur la carte ce qui partage humat Bab al<br />
Gharbi et humat al-Trabelsia. Pour accéder à celle-ci on entre par la porte de Bab<br />
al-Gharbi et on prend la première rue à droite (rue de Tripoli) desservant des maisons<br />
considérées comme faisant partie de humat al-Trabelsia tout en ayant le dos accolé à<br />
celles faisant partie de humat Bab al-Gharbi. De même si chacun des deux quartiers est<br />
matérialisé par une rue principale qui mène à Bab al-Jedid, la limite interne entre eux est<br />
marquée par des maisons dont la profondeur ne peut être pressentie.<br />
Si les quatre grandes divisions, les quatre "huma masiha-s", sont essentiellement<br />
des unités administratives, constituant l'assiette fiscale, avec à la tête de chacune un<br />
cheikh, peut-on dire des humas-s en tant qu'unités résidentielles qu'elles repro<strong>du</strong>isent un<br />
découpage et une répartition d'ordre ethnique? La désignation de celles-ci renvoie à<br />
l'indication d'orientation spatiale, de lieu, de fonction, d'origine historique lointaine ; à<br />
part humat al-Trabelsia qui indique l'origine commune de ses occupants encore que<br />
celle-ci les lierait à une autre cité, Tripoli. On ne peut supposer l'existence, comme dans<br />
les villages, d'une articulation des groupes agnatiques et <strong>du</strong> territoire. En milieu urbain, la<br />
parenté n'est pas la charpente de la société. Et les rapports agnatiques ne sont pas définis<br />
dans le cadre <strong>du</strong> quartier. Il est vrai que l'indivi<strong>du</strong> est désigné par sa "nisba", mais<br />
celle-ci n'indique pas une parenté de groupe, elle n'est qu'une chaîne d'ascendants en<br />
ligne directe (patrilinéaire) laissant tomber les branches collatérales. En ville, où la<br />
"nisba" est de portée courte, l'ancêtre apical n'étant souvent que l'aïeul, c'est surtout le<br />
nom patronymique qui est tenu pour un signe probant de la citadinité, auquel est accolé<br />
dans l'écrit la référence au métier, à la qualité religieuse ou militaire, à l'origine<br />
géographique et qui peut tenir lieu de patronyme. Les citadins sont "indivi<strong>du</strong>alisés",<br />
"hum-ul munfari<strong>du</strong>na fi ansabihim", désignation d'Ibn Khaldoun qui a valeur de<br />
sentence.<br />
Le quartier est une unité collecvtive réelle. Pour désigner les hommes d'un<br />
quartier on dit 'Jama c at humat" tel (43) , soit un groupe que rassemble un lieu. C'est un<br />
cadre social où se réalisent les manifestations de la sociabilité. Pour reprendre la<br />
typologie des groupements sociaux, établie par G. Gurvitch (44) , celui qui correspond au<br />
"huma" n'est pas le groupement de parenté, mais le groupement de localité à<br />
caractère territorial et dont les membres sont liés par le voisinage. Ici ce n'est pas la<br />
parenté mais la vicinité qui compte.<br />
A cette organisation sociale correspond des institutions politiques particulières<br />
à la société citadine. D'abord le pouvoir central y est représenté d'une manière constante<br />
et directe: par un corps militaire et par le caïd, un seul pour le Sahel (de Sousse ,<br />
Monastir et Mahdia) au cours de la deuxième moitié <strong>du</strong> 19ème siècle. L'autorité <strong>du</strong> bey<br />
est exercée par l'adjoint <strong>du</strong> caïd, le khalifa, qui a un pouvoir administratif, de police. A la<br />
tête de chacun des quatre quartiers, il y a un cheikh, agent d'exécution dont la tâche est<br />
essentiellement fiscale. Quant au mode d'acquisition de cette charge: c'est la<br />
désignation par le khalifa. C'est un homme <strong>du</strong> commun, sans grand prestige. Le caïd<br />
écrit en décembre 1871 à propos des quatre cheikhs de Monastir : "tous ne savent ni<br />
lire, ni écrire " (45) .<br />
(43) A.G.T.T. Doss. 443 bis p. 221 pour exemple.<br />
(44) Gurvitch G., La vocation actuelle de la sociologie, Tl, P.U.F. 1968.<br />
(45) A.G.G.T Doss 425, p235<br />
254