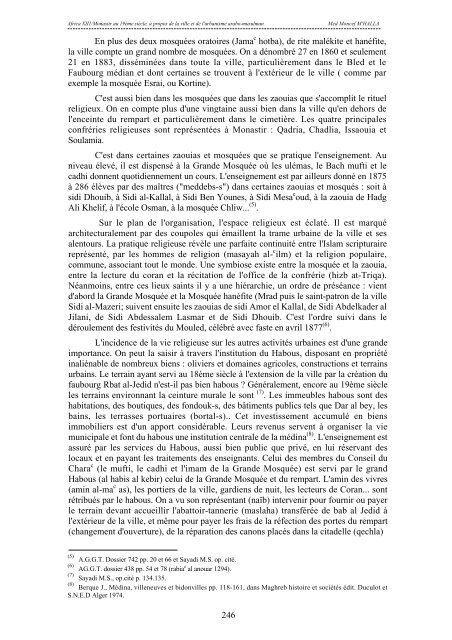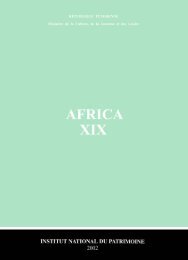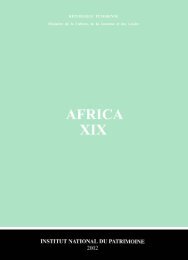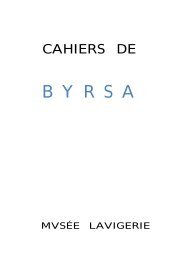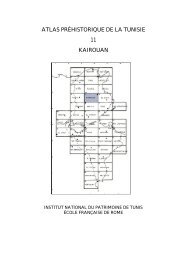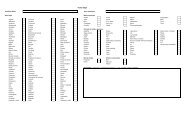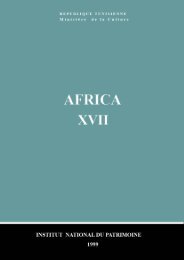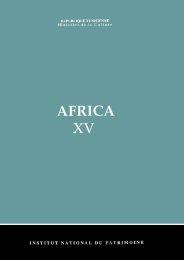africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Africa XII1/Monastir au 19ème siècle, à propos de la ville et de l'urbanisme arabo-musulman Med Moncef M'HALLA<br />
En plus des deux mosquées oratoires (Jama c hotba), de rite malékite et hanéfite,<br />
la ville compte un grand nombre de mosquées. On a dénombré 27 en 1860 et seulement<br />
21 en 1883, disséminées dans toute la ville, particulièrement dans le Bled et le<br />
Faubourg médian et dont certaines se trouvent à l'extérieur de le ville ( comme par<br />
exemple la mosquée Esrai, ou Kortine).<br />
C'est aussi bien dans les mosquées que dans les zaouias que s'accomplit le rituel<br />
religieux. On en compte plus d'une vingtaine aussi bien dans la ville qu'en dehors de<br />
l'enceinte <strong>du</strong> rempart et particulièrement dans le cimetière. Les quatre principales<br />
confréries religieuses sont représentées à Monastir : Qadria, Chadlia, Issaouia et<br />
Soulamia.<br />
C'est dans certaines zaouias et mosquées que se pratique l'enseignement. Au<br />
niveau élevé, il est dispensé à la Grande Mosquée où les ulémas, le Bach mufti et le<br />
cadhi donnent quotidiennement un cours. L'enseignement est par ailleurs donné en 1875<br />
à 286 élèves par des maîtres ("meddebs-s") dans certaines zaouias et mosqués : soit à<br />
sidi Dhouib, à Sidi al-Kallal, à Sidi Ben Younes, à Sidi Mesa c oud, à la zaouia de Hadg<br />
Ali Khelif, à l'école Osman, à la mosquée Chliw... (5) .<br />
Sur le plan de l'organisation, l'espace religieux est éclaté. Il est marqué<br />
architecturalement par des coupoles qui émaillent la trame urbaine de la ville et ses<br />
alentours. La pratique religieuse révèle une parfaite continuité entre l'Islam scripturaire<br />
représenté, par les hommes de religion (masayah al- c ilm) et la religion populaire,<br />
commune, associant tout le monde. Une symbiose existe entre la mosquée et la zaouia,<br />
entre la lecture <strong>du</strong> coran et la récitation de l'office de la confrérie (hizb at-Triqa).<br />
Néanmoins, entre ces lieux saints il y a une hiérarchie, un ordre de préséance : vient<br />
d'abord la Grande Mosquée et la Mosquée hanéfite (Mrad puis le saint-patron de la ville<br />
Sidi al-Mazeri; suivent ensuite les zaouias de sidi Amor el Kallal, de Sidi Abdelkader al<br />
Jilani, de Sidi Abdessalem Lasmar et de Sidi Dhouib. C'est l'ordre suivi dans le<br />
déroulement des festivités <strong>du</strong> Mouled, célébré avec faste en avril 1877 (6) .<br />
L'incidence de la vie religieuse sur les autres activités urbaines est d'une grande<br />
importance. On peut la saisir à travers l'institution <strong>du</strong> Habous, disposant en propriété<br />
inaliénable de nombreux biens : oliviers et domaines agricoles, constructions et terrains<br />
urbains. Le terrain ayant servi au 18ème siècle à l'extension de la ville par la création <strong>du</strong><br />
faubourg Rbat al-Jedid n'est-il pas bien habous ? Généralement, encore au 19ème siècle<br />
les terrains environnant la ceinture murale le sont (7) . Les immeubles habous sont des<br />
habitations, des boutiques, des fondouk-s, des bâtiments publics tels que Dar al bey, les<br />
bains, les terrasses portuaires (bortal-s).. Cet investissement accumulé en biens<br />
immobiliers est d'un apport considérable. Leurs revenus servent à organiser la vie<br />
municipale et font <strong>du</strong> habous une institution centrale de la médina (8) . L'enseignement est<br />
assuré par les services <strong>du</strong> Habous, aussi bien public que privé, en lui réservant des<br />
locaux et en payant les traitements des enseignants. Celui des membres <strong>du</strong> Conseil <strong>du</strong><br />
Chara c (le mufti, le cadhi et l'imam de la Grande Mosquée) est servi par le grand<br />
Habous (al habis al kebir) celui de la Grande Mosquée et <strong>du</strong> rempart. L'amin des vivres<br />
(amin al-ma c as), les portiers de la ville, gardiens de nuit, les lecteurs de Coran... sont<br />
rétribués par le habous. On a vu son représentant (naïb) intervenir pour fournir ou payer<br />
le terrain devant accueillir l'abattoir-tannerie (maslaha) transférée de bab al Jedid à<br />
l'extérieur de la ville, et même pour payer les frais de la réfection des portes <strong>du</strong> rempart<br />
(changement d'ouverture), de la réparation des canons placés dans la citadelle (qechla)<br />
(5)<br />
A.G.G.T. Dossier 742 pp. 20 et 66 et Sayadi M.S. op. cité.<br />
(6) c<br />
AG.G.T. dossier 438 pp. 54 et 78 (rabia al anouar 1294).<br />
(7)<br />
Sayadi M.S., op.cité p. 134.135.<br />
(8)<br />
Berque J., Médina, villeneuves et bidonvilles pp. 118-161, dans Maghreb histoire et sociétés édit. Duculot et<br />
S.N.E.D Alger 1974.<br />
246