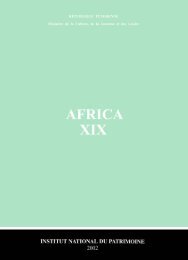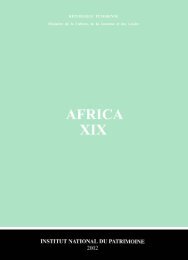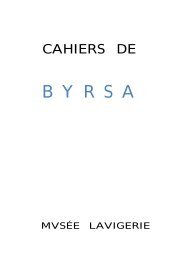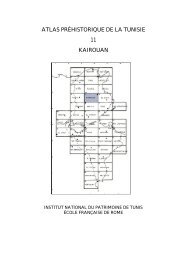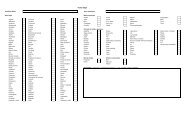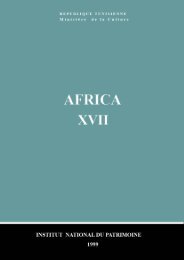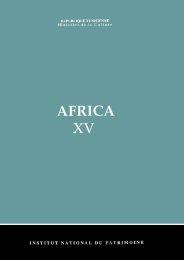africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Africa XIII/ Sacrifice, sacre et fête aux premiers temps de l'Islam Nabil GRISSA<br />
* Le Proche-Orient ancien<br />
Ce que nous venons de voir dans le domaine gréco-romain ne nous éloigne<br />
guère des Arabes; tout au contraire, puique nous voyons l'insistance sur deux types de<br />
sacrifice exactement comme chez les Arabes: le sacrifice expiatoire et celui de<br />
communion, malgré qu'ils ne paraissent pas être totalement distincts.<br />
Néanmoins, c'est dans le domaine proche-oriental que nous remarquons une<br />
insistance quasi systématique sur une conception plus développée <strong>du</strong> rapport à un<br />
"Sacré" qui se trouve accompli par des sacrifices de communion et surtout d'expiation.<br />
C'est ce que nous croyons savoir, par exemple, <strong>du</strong> sacrifice canaanéen que nous<br />
retrouvons décrit dans l'Ancien Testament (69) ; il s'agit d'un rite qui s'inscrit dans le<br />
cadre général de la croyance en une regénération <strong>du</strong> monde, de la vie et de la société<br />
grâce à des pratiques religieuses assez rigoureuses (70) .<br />
Cette conception n'était pas, bien sûr, propre aux Canaanéens puisqu'on la<br />
retrouve aussi en Egypte pharaonique (71) et en Mésopotamie où l'on voit, justement,<br />
s'articuler d'une manière claire Fête, Sacré et sacrifice dans un sens expiatoire à<br />
l'échelle de toute la société et ceci à l'occasion de la fête <strong>du</strong> Nouvel An (72) .<br />
Dans ces sociétés de Proche-Orient, le politique et le religieux étaient<br />
intimement liés de telle manière que c'est le Roi qui, tout en participant au divin et<br />
veillant à la sécurité et au bonheur des hommes, confère à tout ce qu'il fait, dit ou<br />
ordonne de faire un caractère sacré. Il est lui-même consacré à la divinité de telle sorte<br />
qu'il assume la fonction expiatoire à la place de toute la société (73) .<br />
Chez les Canaanéens - et notamment ceux de la côte méditerranéenne (les<br />
Phéniciens et les Carthaginois) - le rite <strong>du</strong> sacrifice nous rapproche davantage <strong>du</strong><br />
domaine arabe qui nous intéresse en particulier.<br />
Prenons, ici, l'exemple-type <strong>du</strong> sacrifice canaanéen, celui donné en l'honneur<br />
de Baal à Ugarit ( ou Baal Hammon à Carthage); il s'agit <strong>du</strong> dieu de l'orage et de la<br />
fertilité agraire appelé aussi "fils de Dagân" ("Dagân", dont le nom signifie "grain",<br />
était un dieu vénéré dans la région <strong>du</strong> Haut et <strong>du</strong> Moyen Euphrate) (74) ; Baal était aussi<br />
un dieu guerrier, il avait battu "El"( Seigneur de la Terre ) et affronté "Yam" (dieu des<br />
Eaux et Prince Mer) et notamment "Môt" ( dieu personnifiant la Mort et régnant sur le<br />
monde souterrain ) jusqu'à sa propre mort; ensuite, il est revenu à la vie et reconnu par<br />
"Môt" comme étant "Roi pour toujours" (75) .<br />
Cette résurrection de Baal était célébrée en Phénicie par des cultes de fertilité et<br />
par des sacrifices dont des holocaustes qu'on retrouvait, aussi, en Israël (76) .<br />
(69) Eliade, op.cit., p. 173 et p.430; à la note N° 52, il cite A. Caquot : Un sacrifice expiatoire à Ras Shamra, dans:<br />
Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses, 42, 1962, p.201-211.<br />
(70) Ibid, p.172-174.<br />
(71) Ibid, p.103-112; le rôle essentiel <strong>du</strong> Pharaon divinisé était justement d'assurer "la stabilité <strong>du</strong> Cosmos et de<br />
l'Etat et par conséquent la continuité de la vie".<br />
(72) lbid,p.71-88.<br />
(73) Ibid, p.85-89; le roi devient ainsi "Sôter" c'est-à- dire le Sauveur divin, la source <strong>du</strong> Salut des hommes, ce qui<br />
n'est pas- bien sûr- sans rappeler le rôle <strong>du</strong> Christ.<br />
(74) Ibid,p.l65-166etp.l71.<br />
(75) Ibid, p.170-172; voir aussi: Caquot A., et Sznycer M.,: Les religions <strong>du</strong> Proche-Orient antique. Textes et<br />
traditions sacrés babyloniens, ougaritiques, hittites, Paris, R. Labat, 1970, p.424-430.<br />
(76) Ibid, p.430, note N°52.<br />
147