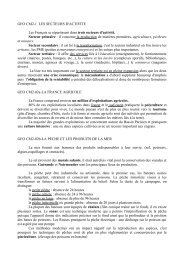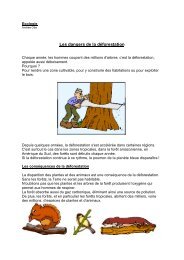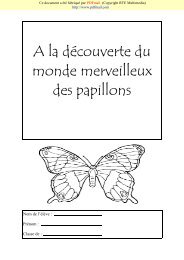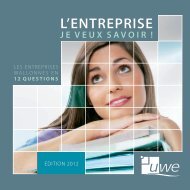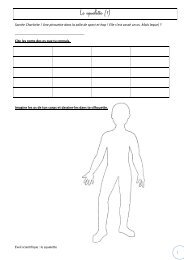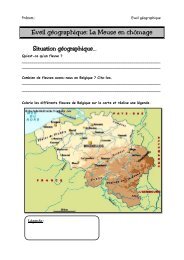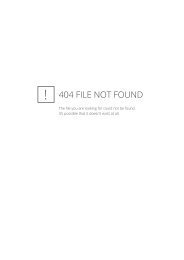APPROCHER D'AUTRES MONDES EST POSSIBLE - sudoc
APPROCHER D'AUTRES MONDES EST POSSIBLE - sudoc
APPROCHER D'AUTRES MONDES EST POSSIBLE - sudoc
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
320 HONOR, M., Enseigner et apprendre<br />
dans une classe multiculturelle.<br />
Méthodes et pratiques<br />
pour réussir, Lyon, 1996, p. 22.<br />
321 Ibid.<br />
322 Lors d’un entretien, la directrice<br />
du centre solaire des Dames<br />
de Marie insiste à quel point<br />
cela peut constituer un « crèvecœur<br />
» pour certains élèves.<br />
Pour ce qui est de la population<br />
scolaire musulmane, la situation<br />
est plus complexe encore<br />
pour les jeunes filles, par exemple<br />
en cas de projet d’excursion<br />
nécessitant de déloger.<br />
323 HONOR, M., op. cit., p. 22.<br />
324 GROOTAERS, D. (sous la coord.<br />
de), Approche sociologique des<br />
cultures populaires, Bruxelles-<br />
Lyon, 1984, pp. 138 et 139.<br />
325 HONOR, M., op. cit., p. 106.<br />
326 Ibid.<br />
327 Ibid.<br />
328 La conséquence en est un résultat<br />
final que M. Honor qualifie<br />
d’« obligatoirement aberrant<br />
» ; ibid.<br />
329 GROOTAERS, D., op. cit., p. 139.<br />
330 Il n’existe, dans notre pays,<br />
pour ainsi dire « aucune<br />
traduction au sens large du<br />
terme (c’est-à-dire une prise<br />
en compte de la langue maternelle<br />
mais aussi des cultures<br />
d’origine), et par conséquent,<br />
aucune possibilité de maintenir<br />
une identité propre »<br />
pour ces allochtones ; GROO-<br />
TAERS, D., op. cit., p. 139.<br />
331 « Le rôle assimilateur n’est<br />
pas une nouveauté à l’usage<br />
exclusif des immigrés », puisque<br />
« mises à part les caractéristiques<br />
de langue et de vécu<br />
culturel, les jeunes nés dans<br />
l’immigration endossent les<br />
difficultés vécues par les jeunes<br />
de milieu populaire » avant<br />
eux (et encore maintenant) ;<br />
ibid., pp. 139 et 140.<br />
Par ailleurs, une difficulté évidente pour les jeunes issus de l’immigration se rapporte au<br />
fait que, « très souvent, les contextes familiaux et scolaires se contredisent » 320 . En effet,<br />
fréquemment, « on ne valorise pas à la maison les mêmes savoirs qu’à l’école (…), les<br />
mêmes comportements (la notion d’horaire, le fait de regarder en face ou non celui qui<br />
parle, les rapports homme/femme, donc garçons/filles, l’importance des disciplines voire<br />
de l’école, etc.), les mêmes valeurs morales (par exemple le collectif prime l’individuel<br />
ou non) » 321 . La situation est donc particulièrement compliquée à gérer pour ces jeunes,<br />
puisqu’ils risquent, quelle que soit leur action, de déplaire forcément à l’une des deux<br />
parties 322 .<br />
De surcroît, il faut redouter que « la non-contextualisation d’une interaction débouche sur<br />
un sentiment de dévalorisation de l’autre, considéré comme vraiment bizarre au mieux,<br />
ou bête ou fou, selon l’échelle des valeurs » 323 . Enfin, ce dénominateur commun, qui déchire<br />
la plupart des immigrés « confrontés à un extérieur (école, rue, quartier, travail)<br />
étranger au mode de vie familial », perdure curieusement même quand ils sont en rupture<br />
avec celui-ci 324 .<br />
Parfois, une maîtrise insuffisante du français (ou du néerlandais) de la part du jeune<br />
immigré peut constituer un obstacle considérable. L’incompréhension peut tout autant<br />
survenir de « l’absence de sens due au manque de références culturelles communes » 325 .<br />
Dans certains cas limites, des élèves dépassés « ne créent dans leur tête aucune image à<br />
partir des mots, donc ils ne demandent aucune explication, et ne peuvent progresser » 326 .<br />
En outre, ils « répercutent cette attitude à l’oral et ne donnent plus aucun sens aux milliers<br />
d’informations qu’ils entendent en six heures de cours », ce qui transforme « la<br />
langue de l’école » en « une langue semi-étrangère » 327 . Comptant « peu de mots de vocabulaire<br />
à leur actif » et les mêmes termes n’ayant dès lors « pas le même sens pour eux<br />
que pour l’école », ces élèves en décalage complet « greffent donc un nouveau savoir sur<br />
un ancien qui n’est pas adéquat » 328 .<br />
En définitive, ce que la Belgique en tant que terre d’accueil « s’est contentée d’offrir aux<br />
jeunes issus de l’immigration, c’est une école assimilatrice » 329 . Selon ce modèle, « les<br />
enfants d’immigrés, comme la plupart des enfants des classes populaires d’ailleurs, n’ont<br />
pas trouvé grand-chose à leur mesure » 330 . Il faut dire que chez nous, dès l’âge « de 3 ou 6<br />
ans, les enfants de migrants n’ont qu’à s’adapter à un système scolaire tel qu’une société<br />
l’avait secrété » et à s’intégrer le mieux possible « dans une école qui ne considère ni leur<br />
histoire, ni leurs différences spécifiques et qui propose un savoir, des valeurs, un mode<br />
de socialisation présentés comme uniques et universels » 331 . Or, à partir du moment où<br />
« elle est assimilatrice, l’école est aussi discriminatrice », bien qu’en Belgique, « il s’agit<br />
bien sûr d’une discrimination subtile » 332 .<br />
332 Ibid., p. 140.<br />
52