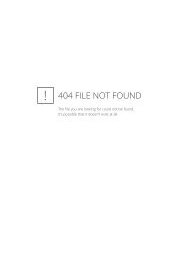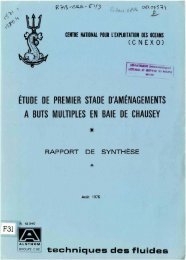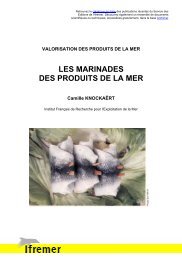Contribution à l'étude de virus de mollusques marins apparentés ...
Contribution à l'étude de virus de mollusques marins apparentés ...
Contribution à l'étude de virus de mollusques marins apparentés ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3 - Procaryotes<br />
Les <strong>mollusques</strong> bivalves sont <strong>de</strong>s animaux filtreurs. La filtration <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s quantités<br />
d'eau <strong>de</strong> mer résulte dans l'accumulation d'un grand nombre <strong>de</strong> microorganismes chez ces<br />
animaux. Cette flore bactérienne, extrêmement variée, est surtout constituée <strong>de</strong> germes <strong>à</strong><br />
Gram négatif tels que <strong>de</strong>s Achromobaler, Aeromonas, Alcaligenes, Pseudomonas et Vibrio<br />
(Laukner, 1983).<br />
La pathogénicité <strong>de</strong>s bactéries vis <strong>à</strong> vis <strong>de</strong>s <strong>mollusques</strong> n'est pas toujours clairement<br />
établie, les germes incriminés appartenant généralement <strong>à</strong> la flore commensale <strong>de</strong>s<br />
coquillages. Néanmoins, il apparaît que quelques espèces <strong>de</strong> Vibrio et <strong>de</strong> Pseudomonas sont<br />
pathogènes notamment chez les larves et le naissain où elles affectent plus particulièrement<br />
les productions d'écloseries, les conditions d'élevage étant généralement très favorables <strong>à</strong> la<br />
prolifération bactérienne (Prieur, 1987). De plus, <strong>de</strong>s infections <strong>à</strong> chlamydies et rickettsies ont<br />
été décrites chez quelques espèces <strong>de</strong> <strong>mollusques</strong> bivalves leur nature pathogène ou<br />
commensale n'étant pas toujours clairement établie.<br />
3.1 - La nécrose bacillaire<br />
Suite <strong>à</strong> <strong>de</strong> nombreux épiso<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mortalités survenus dans <strong>de</strong>s écloseries aux Etats<br />
Unis, chez <strong>de</strong>s larves <strong>de</strong> clam, Mercenaria mercenaria, et chez du naissain d'huître<br />
américaine, Crassoslrea virginica, une souche <strong>de</strong> Vibrio et une souche <strong>de</strong> Pseudomonas<br />
capables d'induire la maladie ont été isolées (Guillard, 1959). Plus tard, sept souches <strong>de</strong> Vibrio<br />
ayant <strong>de</strong>s caractéristiques biochimiques similaires <strong>à</strong> Vibrio anguillarum et Vibrio<br />
alginolylicus, ont été i<strong>de</strong>ntifiées <strong>à</strong> partir <strong>de</strong> larves moribon<strong>de</strong>s (Tubiash el al., 1965 et 1970).<br />
Les essais <strong>de</strong> reproduction <strong>de</strong> la maladie, réalisés sur <strong>de</strong>s larves <strong>de</strong> différentes espèces <strong>de</strong><br />
bivalves, Crassoslrea virginica, Oslrea edulis, Mercenaria mercenaria et Argopeclen<br />
irradians, ont permis <strong>de</strong> démontrer la pathogénicité <strong>de</strong> ces souches <strong>de</strong> Vibrio. Celle ci se<br />
traduit, après quatre <strong>à</strong> cinq heures <strong>de</strong> contact, par une réduction importante <strong>de</strong> l'activité <strong>de</strong><br />
nage et une sédimentation <strong>de</strong>s larves. Les premières mortalités apparaissent huit heures après<br />
l'inoculation <strong>de</strong>s bactéries, elles sont accompagnées d'une nécrose et <strong>de</strong> lésions au niveau du<br />
vélum, dont <strong>de</strong>s fragments se détachent <strong>de</strong>s larves.<br />
La pathogénicité <strong>de</strong> ces souches bactériennes a été testée chez <strong>de</strong>s individus adultes <strong>de</strong><br />
différentes espèces <strong>de</strong> <strong>mollusques</strong> bivalves. En l'absence <strong>de</strong> l'observation <strong>de</strong> phénomènes<br />
pathologiques chez ces animaux, la nécrose bacillaire est considérée comme une maladie<br />
affectant exclusivement les larves et le naissain <strong>de</strong> différentes espèces.<br />
3.2 - Maladie <strong>de</strong> l'anneau brun<br />
A partir <strong>de</strong> 1987, d'importantes mortalités ont décimé les palour<strong>de</strong>s japonaises,<br />
Rudi/apes phi/ippinarum, <strong>de</strong>s côtes atlantiques françaises.<br />
Cette maladie, caractérisée par la présence d'un dépôt brun <strong>de</strong> matériel organique sur la<br />
face interne <strong>de</strong>s valves, est attribuée <strong>à</strong> un Vibrio jusqu'alors non décrit dans la littérature et<br />
désigné comme Vibrio PI (VP 1) (Paillard el al. , 1989). Les étu<strong>de</strong>s menées ultérieurement par<br />
Paillard et Maes (1990) ont permis <strong>de</strong> vérifier que le VP1 est effectivement responsable du<br />
syndrome <strong>de</strong> l'anneau brun, bien que son effet pathogène n'ait jamais été démontré. Toutefois,<br />
il semble que le VP 1 soit indirectement responsable <strong>de</strong>s mortalités observées chez la palour<strong>de</strong>.<br />
En effet, la mort <strong>de</strong>s animaux semble être le résultat <strong>de</strong>s altérations <strong>de</strong> la croissance<br />
17