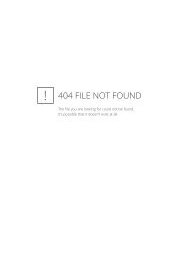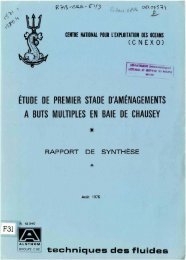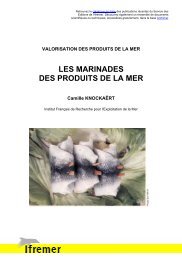Contribution à l'étude de virus de mollusques marins apparentés ...
Contribution à l'étude de virus de mollusques marins apparentés ...
Contribution à l'étude de virus de mollusques marins apparentés ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
t<br />
t<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
t<br />
1<br />
1<br />
t<br />
1<br />
1<br />
t<br />
1<br />
1<br />
t<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
t<br />
1<br />
1<br />
4.1 - Irit/oviridae<br />
Cette famille revêt une importance particulière chez les <strong>mollusques</strong> bivalves, car elle a<br />
été associée <strong>à</strong> plusieurs épizooties chez <strong>de</strong>ux espèces d'huîtres : Crassostrea angulata et<br />
Crassostrea gigas. Chez C. angulata, ces agents sont <strong>à</strong> l'origine <strong>de</strong> la maladie <strong>de</strong>s branchies<br />
(Comps, 1970a ; Comps et al., 1976 ; Comps et Duthoit, 1976), puis <strong>de</strong> la maladie<br />
hémocytaire (Comps, 1983a), conduisant <strong>à</strong> la disparition <strong>de</strong> cette espèce <strong>de</strong>s côtes françaises.<br />
De plus, d'autres irido<strong>virus</strong> ont été décrits chez les larves <strong>de</strong> C. gigas aux Etats-Unis<br />
(Leibovitz et al., 1978 ; Elston, 1979) et sur <strong>de</strong>s animaux adultes <strong>de</strong> la même espèce en<br />
France (Comps et Bonami, 1977).<br />
Maladie <strong>de</strong>s branchies<br />
Les premiers symptômes <strong>de</strong> la maladie <strong>de</strong>s branchies <strong>de</strong> l'huître portugaise,<br />
Crassostrea angulata, sont apparus en 1966 dans le Bassin <strong>de</strong> Marennes-Oléron (Charente<br />
Maritime, France), puis se sont étendus <strong>à</strong> toutes les zones d'élevage françaises en 1967. Cette<br />
épizootie a conduit <strong>à</strong> <strong>de</strong>s mortalités massives jusqu'en 1970. L'association <strong>de</strong> ces mortalités<br />
avec la présence d'un agent viral a pu être établie a posteriori, quelques années plus tard,<br />
grâce <strong>à</strong> <strong>de</strong>s pièces histologiques conservées (Comps et al., 1976). La morphologie, la taille<br />
<strong>de</strong>s particules virales et leur localisation intracytoplasmique ont permis d'apparenter le <strong>virus</strong><br />
observé <strong>à</strong> la famille <strong>de</strong>s Iridoviridae.<br />
Les symptômes <strong>de</strong> la maladie décrits par Al<strong>de</strong>rman et Gras (1969) débutent par<br />
l'apparition <strong>de</strong> pustules jaunes sur les branchies et parfois sur les palpes labiaux, ainsi que par<br />
<strong>de</strong> petites perforations dont l'extension aboutit <strong>à</strong> la formation d'in<strong>de</strong>ntations sur la bordure<br />
externe <strong>de</strong> ces organes.<br />
A l'examen histologique, les sites <strong>de</strong> l'infection sont caractérisés par <strong>de</strong>s phénomènes<br />
inflammatoires avec une infiltration hémocytaire et par la présence <strong>de</strong> nombreuses cellules <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong>s dimensions contenant une volumineuse inclusion basophile pouvant occuper la<br />
majeure partie du cytoplasme. En histochimie, ces inclusions se sont révélées contenir <strong>de</strong><br />
l'ADN, après coloration par la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> Feu1gen et Rossenbeck.<br />
Les examens en microscopie électronique <strong>à</strong> transmission ont montré <strong>de</strong>s particules<br />
virales dans les cellules hypertrophiées. Ces virions, semblent être assemblés au niveau <strong>de</strong><br />
l'inclusion basophile observée en microscopie photonique. Ils seraient ensuite émis dans le<br />
cytoplasme sous forme <strong>de</strong> particules polymorphes, présentant une structure complexe <strong>de</strong><br />
symétrie icosaédrique (380 nm <strong>de</strong> diamètre), contenant un nucléoï<strong>de</strong> sensiblement sphérique<br />
et d'aspect granuleux, l'ensemble étant délimité par un complexe membranaire constitué <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux membranes tri lamellaires, séparées par un espace granuleux.<br />
Le développement <strong>de</strong>s lésions virales proprement dites, s'accompagne d'un ensemble<br />
<strong>de</strong> symptômes cytopathogènes aboutissant <strong>à</strong> la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> la cellule infectée. L'effet<br />
pathogène se manifeste par un accroissement sensible <strong>de</strong> la taille du noyau, accompagné <strong>de</strong> la<br />
disparition <strong>de</strong> la chromatine.<br />
En matière <strong>de</strong> pathologie <strong>de</strong>s bivalves <strong>marins</strong>, cette maladie <strong>de</strong> l'huître portugaise<br />
représente le premier cas <strong>de</strong> virose mis en relation avec un phénomène <strong>de</strong> mortalité massive<br />
(Comps, 1970b ; Comps et al., 1976 ; Comps et Duthoit, 1976).<br />
23