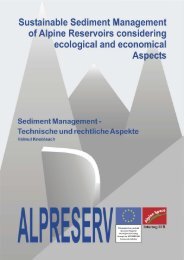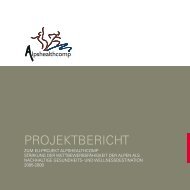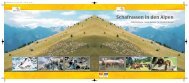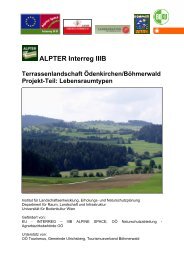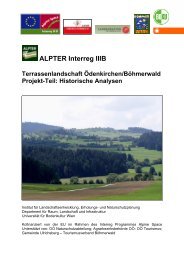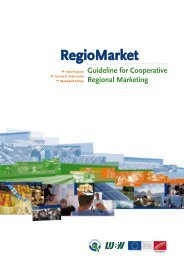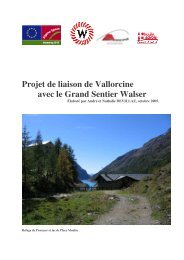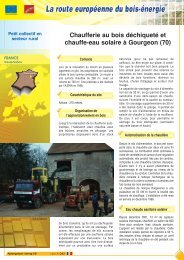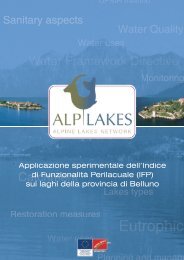WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
WALSERSPRACHE - The four main objectives of the Alpine Space ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
VERS UNE “LANGUE” DES WALSERS: LA PERSPECTIVE DIACHRONIQUE ET COMPARATIVE<br />
de l’infinitif peut également bien être employée: (dare ad intendere) geh z’ verstoh (geh z’ verstehn).<br />
On retrouve deux formes du verbe “faire” dans des expressions comme “tïan z’ baitu»<br />
(“faire attendre”) ou dans un nom dérivé d’un verbe, comme “a’steiser” (“voisin”), puisé d’une<br />
forme plus vielle de “stoh”, c’est-à-dire “stei” (“rester”).<br />
43 À la page 92 du manuel La colonia tedesca, op. cit., nous lisons: “L’infinito riceve pure le<br />
particelle z’, zu, quando esprime l’oggetto di qualche azione”. Et dans ce même paragraphe on<br />
reporte: “z’ gehenn, di andare”. Or, l’infinitif de “andare” dans le dictionnaire de M. Giordani est<br />
bien “goh” et non «gehenn». Ce verbe est en mhd. et ahd. “geen, gaan”, mais “go” an anglais et<br />
“ga” en suédois. Comment pourrait une même langue, le Titzschu, posséder en même temps la<br />
forme germanique et la forme anglo-saxonne-scandinave? Que s’est-il produit au juste? Comment<br />
se fait-il que pour la plupart des verbes (tels que “loh”, “permettre, consentir, laisser”) présentent<br />
une forme qui est plus proche du scandinave et de l’anglo-saxon que du proto-germanique? Il<br />
arrive que les deux formes sont phonétiquement fort éloignées entre elles, même si on se tient<br />
bien à l’intérieur de la famille des langues germaniques. Mais comment expliquer par la suite la<br />
cœxistence des deux formes dans le même verbe? Voilà les questions à être éclaircies si on veut<br />
sortir des bornes sans histoire et sans perspective diachronique de la pure et simple oralité.<br />
44 Autrement dit, on crée une liste de mots à partir du répertoire lexical d’une ou de plusieurs<br />
langues <strong>of</strong>ficielles, en y incluant ou en y excluant les mots appartenant à des catégories ou à des<br />
niveaux linguistiques préétablis. C’est seulement suite à un constat d’absence totale de certaines<br />
correspondances qu’on déclare une “case vide” et on déclanche le processus de néologie pour la<br />
remplir. Mais il doit demeurer tout à fait clair que dans cette façon de procéder il n’y a pas de répertoires<br />
“régionaux” et de répertoires “nationaux”, puisque une langue doit rendre la pareille à une<br />
autre en tout cas ou, du moins, démontrer qu’elle possède tout ce qu’il faut pour créer un nombre<br />
indéfini de néologismes. L’alternative, bien sûr, c’est de s’arrêter à la tire des vaches, peine l’extinction<br />
par obsolescence, ou encore la création d’une langue qui possède le mot pour “téléphone”,<br />
mais pas le mot pour “internet”, c’est-à-dire une langue du passé récent au lieu d’une langue du<br />
passé définitif. Mais en ce faisant, on se crée plus de problèmes qu’on en règle. Il n’y a plus d’espace<br />
aujourd’hui pour des presque-langues ou des langues périmées, puisque les médias nous forcent<br />
à faire face au jour le jour à la simultanéité et à la contemporanéité: ou on est là, où on ne l’est<br />
pas et si on rate ce rendez-vous on est émarginés à toujours.<br />
45 Tout le monde des Walsers est conscient de ce problème du renouveau du lexique et des<br />
risques auxquels on s’expose si on n’enrichit pas sa langue ancestrale. De l’article de Ugo Busso,<br />
dans ce même volume, nous puisons le constat suivant: «Oggi, l’uso delle parlate Walser a<br />
Gressoney ed Issime, per la comunicazione orale si riduce sempre di più non solo per la diminuzione<br />
della popolazione autoctona, ma anche e soprattutto per i radicali cambiamenti della vita<br />
odierna, difficilmente espressa in un linguaggio di mille anni fa.»<br />
46 À remarquer: nous nous sommes servis de la graphie historique de la langue piémontaise,<br />
et non de celle phonétique qu’on voit de temps à autres employée un peu partout au Piémont par<br />
ceux et celles qui ne connaissent pas l’histoire et la grammaire de cette langue millénaire et de ses<br />
nombreux dialectes, parmi lesquels le valsésien. En tout état de compte, la voyelle “o” se lit comme<br />
une “u” italienne, tandis que la voyelle “u” se lit comme une “ü” française. La voyelle “ò”, accentée,<br />
se lit exactement comme la correspondante voyelle “o” en italien. Voir Camillo Brero,<br />
Gramatica dla lenga piemontèisa, Turin: Piemonte in Bancarella, 1973.<br />
140