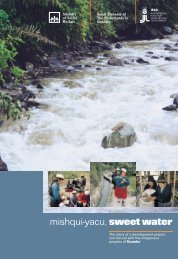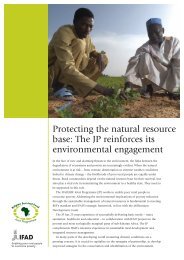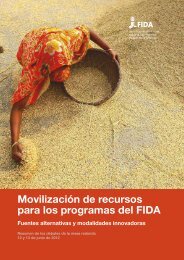L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Autonomisation <strong>des</strong> Ruraux Pauvres <strong>et</strong> Vo<strong>la</strong>tilité <strong>des</strong> Politiques de Développem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Tunisie<br />
Rapport de Synthèse, Mai 2006<br />
le financem<strong>en</strong>t c’est <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité <strong>et</strong> pour l’eau c’est <strong>la</strong> disponibilité. Pour l’obj<strong>et</strong> attitudinal<br />
administration c’est <strong>la</strong> proximité <strong>et</strong> <strong>en</strong>fin pour les organisations à <strong>la</strong> base c’est le miyâad. Ces<br />
différ<strong>en</strong>tes dim<strong>en</strong>sions constitu<strong>en</strong>t les nœuds sur lesquels on pourrait agir pour améliorer l’autonomie<br />
<strong>des</strong> individus, à <strong>la</strong> fois vis-à-vis de ces obj<strong>et</strong>s attitudinaux <strong>et</strong>, plus globalem<strong>en</strong>t, sur leur autonomie<br />
perçue.<br />
Parmi les leçons importantes, on doit noter les différ<strong>en</strong>ces <strong>en</strong>tre les attitu<strong>des</strong> individuelles <strong>et</strong> celles que<br />
l'on peut percevoir lorsque l'analyse est conduite au niveau <strong>des</strong> groupes <strong>et</strong> de leurs leaders (voir<br />
chapitres 3 <strong>et</strong> 4). C'est ainsi, par exemple, que le proj<strong>et</strong> PRODESUD est le principal obj<strong>et</strong> attitudinal<br />
dans le cadre de l'approche collective alors qu'il n'a pas beaucoup d'eff<strong>et</strong>s lorsque l'on se situe à<br />
l'échelle individuelle. Les mêmes remarques peuv<strong>en</strong>t être faites pour les GDA, ce qui n’est pas<br />
surpr<strong>en</strong>ant étant donné <strong>la</strong> g<strong>en</strong>èse <strong>et</strong> <strong>la</strong> jeunesse <strong>des</strong> groupem<strong>en</strong>ts. En revanche, les structures anci<strong>en</strong>nes<br />
<strong>et</strong> proches, le miyâad <strong>et</strong> le 'omda, sont perçus d'emblée par les individus comme <strong>des</strong> ag<strong>en</strong>ts contribuant<br />
effectivem<strong>en</strong>t à leur autonomisation.<br />
L’indice d’autonomie perçue est égal <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne à 49 sur 100. C<strong>et</strong>te valeur signifie que <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion, toutes catégories confondues, se situe à un niveau d’autonomie moy<strong>en</strong>. A l’exception <strong>des</strong><br />
jeunes qui ont un indice d’autonomie perçue s<strong>en</strong>siblem<strong>en</strong>t plus élevés, les autres catégories<br />
professionnelles s’équival<strong>en</strong>t <strong>et</strong> <strong>en</strong> particuliers les agriculteurs, les bergers <strong>et</strong> les éleveurs. L’id<strong>en</strong>tité<br />
tribale ou l’appart<strong>en</strong>ance à une fraction (arch) n’influ<strong>en</strong>ce pas l’autonomie perçu. Il <strong>en</strong> est de même du<br />
rev<strong>en</strong>u m<strong>en</strong>suel déc<strong>la</strong>ré qui ne semble pas affecter l’autonomie <strong>des</strong> suj<strong>et</strong>s, à l’exception de <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse<br />
« sans rev<strong>en</strong>u » qui inclue principalem<strong>en</strong>t les jeunes.<br />
Une analyse de <strong>la</strong> régression pr<strong>en</strong>ant l’indice d’autonomie perçue comme variable dép<strong>en</strong>dante, montre<br />
que <strong>la</strong> catégorie d’âge, <strong>la</strong> situation maritale, le nombre d’<strong>en</strong>fants, <strong>la</strong> m<strong>en</strong>sualité, les ressources, les<br />
catégories professionnelles, l’appart<strong>en</strong>ance tribale, <strong>et</strong> les scores d’attitu<strong>des</strong> sont <strong>des</strong> variables<br />
explicatives qui influ<strong>en</strong>t l’autonomie <strong>des</strong> individus. Les résultats montr<strong>en</strong>t cep<strong>en</strong>dant qu’on gagnerait<br />
<strong>en</strong> précision <strong>en</strong> déterminant les indices d’autonomisation par catégorie professionnelle. Les attitu<strong>des</strong>,<br />
particulièrem<strong>en</strong>t l’implication collective vis-à-vis du parcours, du financem<strong>en</strong>t <strong>et</strong> de <strong>la</strong> gestion,<br />
agiss<strong>en</strong>t sur l’autonomie perçue <strong>des</strong> individus.<br />
3. L'IMPACT DES STRUCTURES NOUVELLES SUR L'EMERGENCE DU LEADERSHIP<br />
ET SUR L'AUTONOMISATION COLLECTIVE<br />
Lorsqu'elle s'est intéressée aux attitu<strong>des</strong> d'appart<strong>en</strong>ance <strong>des</strong> popu<strong>la</strong>tions, <strong>la</strong> recherche s’est s'interrogée<br />
sur les communautés <strong>en</strong> tant qu'obj<strong>et</strong> attitudinal d'id<strong>en</strong>tification. Les communautés, auxquelles<br />
correspond l'institution traditionnelle du miyâad, serv<strong>en</strong>t de cadre à <strong>la</strong> socialisation <strong>des</strong> individus. La<br />
lecture <strong>des</strong> données (voir chapitre III) suggère que les structures sont perçues selon <strong>des</strong> registres<br />
différ<strong>en</strong>ts, le Myâad est perçu <strong>en</strong> référ<strong>en</strong>ce à son fonctionnem<strong>en</strong>t, le GDA selon un registre affectif, les<br />
conseils de gestion selon un registre d'intérêts matériels Ceux-ci y ont <strong>des</strong> statuts sociaux <strong>et</strong> <strong>des</strong> rôles<br />
diversifiés <strong>et</strong> leurs regroupem<strong>en</strong>ts internes peuv<strong>en</strong>t se manifester sous forme de t<strong>en</strong>dances<br />
différ<strong>en</strong>ciées au sein de <strong>la</strong> communauté. La communauté n'<strong>en</strong> forme pas moins un cadre global dans<br />
lequel tous ces membres se r<strong>et</strong>rouv<strong>en</strong>t. Elle est un cadre de référ<strong>en</strong>ce id<strong>en</strong>titaire <strong>et</strong> de référ<strong>en</strong>ce<br />
territoriale. Elle constitue un <strong>en</strong>jeu de pouvoir au sein du groupe social. Elle est le lieu d'activités <strong>et</strong> de<br />
régu<strong>la</strong>tions collectives plus ou moins affirmées. Elle est pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t un cadre de participation pour<br />
<strong>la</strong> conception <strong>et</strong> <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre de proj<strong>et</strong>s de développem<strong>en</strong>t. La communauté doit donc être<br />
comprise comme l'un <strong>des</strong> ag<strong>en</strong>ts à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> compte dans le processus d'autonomisation. Les<br />
communautés constituai<strong>en</strong>t <strong>des</strong> instances ess<strong>en</strong>tielles de <strong>la</strong> vie sociale lorsque le système pastoral était<br />
géré par les coutumes traditionnelles. L'évolution du pastoralisme ainsi que <strong>la</strong> surimposition <strong>des</strong><br />
structures administratives modernes <strong>et</strong> <strong>des</strong> règles de tutelle les ont <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t repliées dans <strong>des</strong><br />
fonctions sociales limitées. Les dynamiques nouvelles de développem<strong>en</strong>t participatif vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t par<br />
contre re<strong>la</strong>ncer leurs solidarités sociales <strong>et</strong> invit<strong>en</strong>t ces communautés à dev<strong>en</strong>ir <strong>des</strong> ferm<strong>en</strong>ts de<br />
l'autonomisation collective. Ces dynamiques nouvelles ne signifi<strong>en</strong>t pas de r<strong>et</strong>our au passé mais au<br />
contraire une valorisation, dans <strong>des</strong> cadres juridiques modernes (les GDA), de solidarités certes<br />
fondées sur <strong>des</strong> héritages indéniables de <strong>la</strong> culture <strong>et</strong> de l'histoire mais aussi r<strong>en</strong>ouvelées,<br />
réinterprétées <strong>et</strong> transformées au sein <strong>des</strong> cadres décisionnels contemporains.<br />
Chapitre V. Réflexions d’<strong>en</strong>semble, <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts <strong>et</strong> pistes de recherche 129