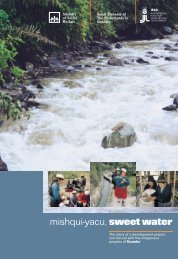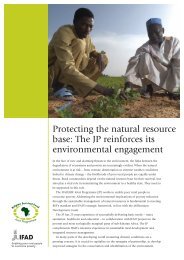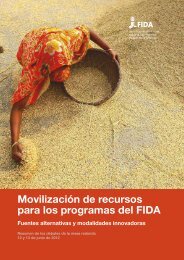L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Autonomisation <strong>des</strong> Ruraux Pauvres <strong>et</strong> Vo<strong>la</strong>tilité <strong>des</strong> Politiques de Développem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Tunisie<br />
Rapport de Synthèse, Mai 2006<br />
l’efficacité <strong>et</strong>, d’autre part, <strong>des</strong> processus psychiques de construction de l’autonomie individuelle dans<br />
<strong>des</strong> conditions difficiles <strong>et</strong> contraires à plusieurs de ses aspects. La psychosociologie est <strong>en</strong>trée <strong>en</strong><br />
scène <strong>en</strong> inv<strong>en</strong>tant <strong>des</strong> dispositifs d’interv<strong>en</strong>tion <strong>en</strong> organisation, dont <strong>la</strong> particu<strong>la</strong>rité est de solliciter<br />
les acteurs vers une posture d’autonomie, alors que <strong>des</strong> logiques institutionnelles leur impos<strong>en</strong>t <strong>des</strong><br />
lois, nécessairem<strong>en</strong>t contraignantes <strong>et</strong> dont certains aspects leur sont étrangers. Le but de c<strong>et</strong>te<br />
inv<strong>en</strong>tion est de r<strong>en</strong>ouveler <strong>la</strong> compréh<strong>en</strong>sion de ma<strong>la</strong>ises collectifs <strong>en</strong> y introduisant un paramètre<br />
plus individuel (Attitude, perception, cognition, implication, satisfaction, maîtrise, coping,<br />
<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t,…..). Le r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t visé passe par le fait de dépasser les seuls points de vue <strong>des</strong><br />
dét<strong>en</strong>teurs du pouvoir, <strong>en</strong> les comparant à d’autres.<br />
Dans notre proj<strong>et</strong> de recherche<br />
L’<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion suppose au préa<strong>la</strong>ble que <strong>la</strong> collectivité rurale <strong>en</strong> tant que groupe<br />
social opérant sur un espace soit reconnue comme un acteur à part <strong>en</strong>tière <strong>et</strong> se perçoive comme tel.<br />
L’<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t suppose <strong>en</strong> outre que l’acteur soit <strong>en</strong> situation de pouvoir choisir. L’autonomisation est<br />
ainsi définie comme une expansion <strong>des</strong> possibilités de choix d’un ag<strong>en</strong>t (individu ou collectivité) ou<br />
<strong>en</strong>core une capacité accrue de transformer <strong>des</strong> ressources <strong>en</strong> résultats. L’autonomie d’un acteur fait<br />
qu’il est un ag<strong>en</strong>t du changem<strong>en</strong>t <strong>et</strong> non simple bénéficiaire ou une victime de ce changem<strong>en</strong>t.<br />
L’instrum<strong>en</strong>t qui nous perm<strong>et</strong>tra de mesurer le degré d’autonomie de l’ag<strong>en</strong>t couvrira une partie <strong>des</strong><br />
états constituant le modèle théorique (Attitude, Ressource, Aspiration/Réalisation, perception)<br />
proposé par El Harizi (2004)<br />
Qu’est ce que l’attitude ?<br />
L’attitude peut être définie comme une t<strong>en</strong>dance psychologique, c’est un état interne du suj<strong>et</strong> qui<br />
s’inscrit dans une certaine durée, qui s’exprime par le biais de l’évaluation d’un obj<strong>et</strong> avec un certain<br />
degré de « favorabilité ». Avoir une attitude, c’est situer un obj<strong>et</strong> attitudinal sur une dim<strong>en</strong>sion<br />
évaluative. L’évaluation d’un obj<strong>et</strong> attitudinal se distingue par une direction (soit vers le pôle positif,<br />
soit vers le pôle négatif) <strong>et</strong> une int<strong>en</strong>sité (qui peut aller de « pas du tout » à extrêmem<strong>en</strong>t). La nature<br />
de l’obj<strong>et</strong> attitudinal est virtuellem<strong>en</strong>t infinie : il peut s’agir de choses bi<strong>en</strong> concrètes comme un<br />
olivier ou un puits d’eau, d’élém<strong>en</strong>ts abstraits tels que voter aux prochaines élections légis<strong>la</strong>tives ou<br />
effectuer un don <strong>en</strong> faveur d’une œuvre de bi<strong>en</strong>faisance. En tant que variable intermédiaire, l’attitude<br />
échappe donc à l’observation directe. Elle requiert <strong>la</strong> création d’instrum<strong>en</strong>ts de mesure spécifiques<br />
dont les développem<strong>en</strong>ts décisifs remont<strong>en</strong>t aux années 1930.<br />
La dim<strong>en</strong>sion affective recouvre les s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts, les émotions, les humeurs, <strong>et</strong>c., que suscite un obj<strong>et</strong><br />
attitudinal. Dire que <strong>la</strong> sécheresse fait peur r<strong>en</strong>voie sans nul doute à c<strong>et</strong>te catégorie de réponses. La<br />
dim<strong>en</strong>sion cognitive concerne les idées <strong>et</strong> les croyances d’un individu au suj<strong>et</strong> d’un obj<strong>et</strong> attitudinal.<br />
P<strong>en</strong>ser que l’écologie exige une nouvelle conception <strong>des</strong> mo<strong>des</strong> de production dans l’activité pastorale<br />
constitue un exemple de <strong>la</strong> composante cognitive de l’attitude face à l’écologie. Enfin, <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sion<br />
comportem<strong>en</strong>tale regroupe les comportem<strong>en</strong>ts observables <strong>et</strong> surtout leurs antécéd<strong>en</strong>ts directs, à savoir<br />
les int<strong>en</strong>tions.<br />
La re<strong>la</strong>tion <strong>en</strong>tre l’attitude <strong>et</strong> le comportem<strong>en</strong>t<br />
Si les psychologues sociaux ont consacré tant d’efforts à mesurer les attitu<strong>des</strong>, c’est avant tout parce<br />
que les réponses attitudinales sont c<strong>en</strong>sées perm<strong>et</strong>tre <strong>la</strong> prédiction du comportem<strong>en</strong>t. De toute<br />
évid<strong>en</strong>ce, le comportem<strong>en</strong>t n’est pas contraint par <strong>la</strong> seule attitude de son auteur. Dans un compter<strong>en</strong>du<br />
resté fameux, Fishbein <strong>et</strong> Ajz<strong>en</strong> (1974) insist<strong>en</strong>t sur le fait que le même soin doit être apporté à<br />
<strong>la</strong> mesure du comportem<strong>en</strong>t qu’à <strong>la</strong> mesure de l’attitude si l’on espère observer une forte re<strong>la</strong>tion <strong>en</strong>tre<br />
les deux <strong>en</strong>tités. En particulier, les principes psychométriques qui présid<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> détermination d’une<br />
mesure attitudinale fiable (rassembler un nombre substantiel d’items individuellem<strong>en</strong>t imparfaits mais<br />
conjointem<strong>en</strong>t efficaces) doiv<strong>en</strong>t guider le travail de mesure du comportem<strong>en</strong>t. Prédire un<br />
Chapitre III. Analyse <strong>et</strong> mesure <strong>des</strong> états <strong>des</strong> ag<strong>en</strong>ts individuels <strong>et</strong> leurs rapports avec l’autonomisation 38