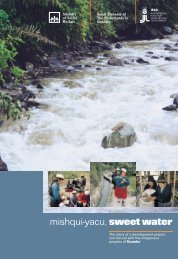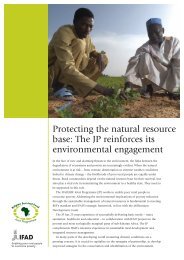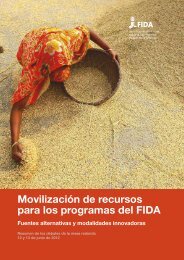L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Autonomisation <strong>des</strong> Ruraux Pauvres <strong>et</strong> Vo<strong>la</strong>tilité <strong>des</strong> Politiques de Développem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Tunisie<br />
Rapport de Synthèse, Mai 2006<br />
CHAPITRE III<br />
ANALYSE ET MESURE DES ÉTATS DES AGENTS<br />
INDIVIDUELS ET LEURS RAPPORTS AVEC<br />
L’AUTONOMISATION<br />
1. INTRODUCTION ET CONCEPTS<br />
Le concept d’autonomie est né <strong>en</strong> Grèce <strong>et</strong> <strong>en</strong> matière de concepts on ne prête qu’aux<br />
philosophes.<br />
Lorsque paraît le concept d’autonomie, il implique l’aptitude à émerger de situations conflictuelles <strong>en</strong><br />
se constituant <strong>des</strong> alliés <strong>en</strong> nombre suffisant. P<strong>en</strong>ser l’autonomie est p<strong>en</strong>ser ses rapports aux autres,<br />
dans le double but de ne pas leur être assuj<strong>et</strong>ti <strong>et</strong> de leur montrer les bénéfices qu’ils peuv<strong>en</strong>t tirer de<br />
l’autonomie. Plus que l’indép<strong>en</strong>dance, elle comporte une modalité re<strong>la</strong>tionnelle. Celle-là implique<br />
d’une part d’id<strong>en</strong>tifier les dangers dont certains m<strong>en</strong>ac<strong>en</strong>t l’exercice de l’autonomie <strong>et</strong>, d’autre part, de<br />
reconnaître <strong>la</strong> nécessité de s’accorder avec d’autres, dont les ressources sont indisp<strong>en</strong>sables à <strong>la</strong> mise<br />
<strong>en</strong> oeuvre <strong>et</strong> au respect <strong>des</strong> lois propres par lesquelles <strong>la</strong> cité se constitue autonome.<br />
Il est remarquable que les athéni<strong>en</strong>s, qui ont été capables de concevoir leur autonomie politique,<br />
n’ai<strong>en</strong>t pas développé une p<strong>en</strong>sée de l’autonomie personnelle. Jean-Pierre Vernant (1996) ∗ montre<br />
comm<strong>en</strong>t « leur représ<strong>en</strong>tation de l’individu ne traduit pas <strong>la</strong> singu<strong>la</strong>rité de notre être, son originalité<br />
foncière… L’âme est impersonnelle ou suprapersonnelle. En nous, elle est au-delà de nous, sa fonction<br />
n’étant pas d’assurer notre particu<strong>la</strong>rité d’être humain, mais de nous <strong>en</strong> libérer <strong>en</strong> nous intégrant à<br />
l’ordre cosmique ou divin ». Pour les Grecs anci<strong>en</strong>s, « <strong>la</strong> connaissance de soi <strong>et</strong> le rapport à soi-même<br />
ne peuv<strong>en</strong>t s’établir directem<strong>en</strong>t » car l’id<strong>en</strong>tité d’un individu ne se définit que par ce que les<br />
autres voi<strong>en</strong>t <strong>et</strong> dis<strong>en</strong>t de lui « pour se faire reconnaître, il faut l’emporter sur ses rivaux dans une<br />
incessante compétition pour <strong>la</strong> gloire. »<br />
Il faudra près de vingt siècles pour acquérir l’idée qu’une intériorité subjective consistante apparti<strong>en</strong>t,<br />
avec ses lois propres, à l’individu humain, lui conférant <strong>la</strong> possibilité de vivre sa vie d’une manière<br />
autonome, à son propre compte.<br />
Concernant <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue française, le dictionnaire étymologique Robert indique que les premières<br />
apparitions de l’autonomie avec sa signification individuelle dat<strong>en</strong>t du XIX e siècle. Même après, le<br />
concept est plus fréquemm<strong>en</strong>t utilisé <strong>en</strong> ses dim<strong>en</strong>sions sociales <strong>et</strong> <strong>politiques</strong>.<br />
Ce déca<strong>la</strong>ge dans le temps donne à réfléchir sur <strong>la</strong> difficulté de constituer l’individu comme<br />
autonome. Parmi les auteurs qui ont <strong>en</strong>trepris de donner un aperçu de l’histoire de l’individuation<br />
humaine, nous nous référons ici à <strong>la</strong> thèse d’Ignace Meyerson (1948) ∗∗ . Il y prés<strong>en</strong>te une histoire de <strong>la</strong><br />
notion de personne, dont il souligne <strong>la</strong> complexité, <strong>la</strong> non-linéarité, l’inachèvem<strong>en</strong>t. Il montre<br />
différ<strong>en</strong>ts aspects dont <strong>la</strong> converg<strong>en</strong>ce aide à é<strong>la</strong>borer le concept d’autonomie personnelle tandis que<br />
leurs mom<strong>en</strong>ts d’apparition, dans les <strong>la</strong>ngues <strong>et</strong> les œuvres, ont été très éloignés les uns <strong>des</strong> autres.<br />
∗ Vernant, J.-P.1996. Entre mythe <strong>et</strong> politique, Paris, Le Seuil.<br />
∗∗ Meyerson, I. 1948. Les fonctions psychologiques <strong>et</strong> les œuvres, Paris, Vrin ; Paris, Albin Michel, 1995.<br />
Chapitre III. Analyse <strong>et</strong> mesure <strong>des</strong> états <strong>des</strong> ag<strong>en</strong>ts individuels <strong>et</strong> leurs rapports avec l’autonomisation 36