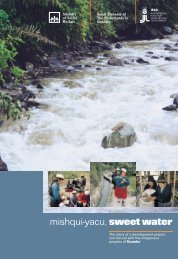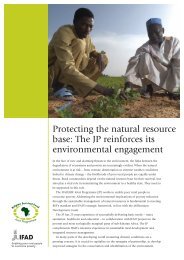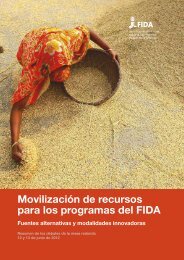L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
L'autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques en ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Autonomisation <strong>des</strong> Ruraux Pauvres <strong>et</strong> Vo<strong>la</strong>tilité <strong>des</strong> Politiques de Développem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Tunisie<br />
Rapport de Synthèse, Mai 2006<br />
2.1.2 Le pouvoir comme outil de coordination <strong>des</strong> activités collectives <strong>et</strong> de <strong>la</strong><br />
vie sociale<br />
La coordination <strong>en</strong>tre acteurs 11 <strong>en</strong>gagés dans un proj<strong>et</strong> commun s’impose pour <strong>la</strong> réalisation <strong>des</strong><br />
objectifs, <strong>la</strong> résolution de problèmes <strong>et</strong> <strong>la</strong> réduction <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s <strong>des</strong>tructeurs <strong>des</strong> conflits 12 pour <strong>la</strong> vie du<br />
groupe, de l’institution ou de l’organisation.<br />
Les instrum<strong>en</strong>ts employés pour <strong>la</strong> réalisation de c<strong>et</strong>te coordination sont compris <strong>en</strong>tre deux limites<br />
extrêmes al<strong>la</strong>nt du <strong>la</strong>isser-faire (abs<strong>en</strong>ce totale de coordination), à <strong>la</strong> contrainte du pouvoir absolu, <strong>en</strong><br />
passant par <strong>la</strong> participation organisée dans ses différ<strong>en</strong>tes formes (consultations, négociations<br />
informelles ou dans le cadre de structures formelles pour traiter <strong>en</strong> commun certaines questions).<br />
Le pouvoir attribué à une personne lui donne <strong>la</strong> capacité d’<strong>en</strong>gager <strong>des</strong> ressources matérielles,<br />
d’ori<strong>en</strong>ter <strong>et</strong> de contrôler les comportem<strong>en</strong>ts <strong>des</strong> autres. Pour ce faire, elle peut utiliser <strong>la</strong> contrainte de<br />
<strong>la</strong> sanction positive (récomp<strong>en</strong>se) ou négative (punition) ou bi<strong>en</strong> se prévaloir de <strong>la</strong> légitimité de son<br />
pouvoir. Mais perçu comme attribut, le pouvoir conduit à <strong>des</strong> désillusions quant à son efficacité. Car<br />
le pouvoir est aussi <strong>et</strong> surtout une re<strong>la</strong>tion où les individus déploi<strong>en</strong>t leurs stratégies propres pour <strong>en</strong><br />
tirer le meilleur profit. De ce point de vue l’influ<strong>en</strong>ce du dét<strong>en</strong>teur du pouvoir dép<strong>en</strong>d de sa<br />
légitimité 13 . Un pouvoir est considéré légitime lorsque les personnes reconnaiss<strong>en</strong>t à celui qui<br />
l’exerce le droit de commander <strong>et</strong> lui obéiss<strong>en</strong>t, ce qui lui confère une autorité.<br />
« Il y a trois types de domination légitime. La validité de c<strong>et</strong>te légitimité peut principalem<strong>en</strong>t revêtir :<br />
Un caractère rationnel reposant sur <strong>la</strong> croyance <strong>en</strong> <strong>la</strong> légalité <strong>des</strong> règlem<strong>en</strong>ts arrêtés <strong>et</strong> du droit de<br />
donner <strong>des</strong> directives qu’ont ceux qui sont appelés à exercer <strong>la</strong> domination par ces moy<strong>en</strong>s<br />
(domination légale) ;<br />
Un caractère traditionnel , reposant sur <strong>la</strong> croyance quotidi<strong>en</strong>ne <strong>en</strong> <strong>la</strong> saint<strong>et</strong>é <strong>des</strong> traditions va<strong>la</strong>bles<br />
de tout temps <strong>et</strong> <strong>en</strong> <strong>la</strong> légitimité de ceux qui sont appelés à exercer l’autorité par ces moy<strong>en</strong>s<br />
(domination traditionnelle) ;<br />
Un caractère charismatique, [reposant] sur <strong>la</strong> soumission extraordinaire au caractère sacré, à <strong>la</strong> vertu<br />
héroïque ou à <strong>la</strong> valeur exemp<strong>la</strong>ire d’une personne, ou <strong>en</strong>core [émanant] d’ordres révélés ou émis par<br />
celle-ci (domination charismatique) » 14<br />
La hiérarchie bureaucratique exerce un pouvoir fondé sur le savoir <strong>et</strong> <strong>la</strong> compét<strong>en</strong>ce <strong>et</strong> selon <strong>des</strong><br />
règles établies. Selon Weber c’est <strong>la</strong> forme d’organisation <strong>la</strong> plus perfectible puisqu’il est dans le<br />
pouvoir <strong>des</strong> hommes d’affiner les règles, de les préciser <strong>et</strong> de les adapter à <strong>la</strong> nature de l’organisation<br />
<strong>et</strong> de ses activités, contrairem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> domination traditionnelle figée par un héritage immuable <strong>et</strong> <strong>la</strong><br />
domination charismatique fort dép<strong>en</strong>dante de <strong>la</strong> personne qui exerce l’autorité.<br />
Les étu<strong>des</strong> m<strong>en</strong>ées <strong>en</strong> Tunisie dans <strong>des</strong> <strong>en</strong>treprises formellem<strong>en</strong>t structurées selon le modèle<br />
bureaucratique, suggèr<strong>en</strong>t que loin de s’exercer à travers les règles, le pouvoir t<strong>en</strong>te au contraire de<br />
créer <strong>des</strong> espaces a-règlem<strong>en</strong>taires, de défier les règles même s’il <strong>en</strong> est l’auteur. Des phénomènes<br />
culturels qui se prêt<strong>en</strong>t à un usage instrum<strong>en</strong>tal pour l’exercice du pouvoir ont été id<strong>en</strong>tifiés ; parmi<br />
eux celui que nous avons désigné par le concept de "flou". Les manifestations comportem<strong>en</strong>tales du<br />
flou résid<strong>en</strong>t dans une t<strong>en</strong>dance à créer l’ambiguïté <strong>en</strong> refusant de formuler <strong>des</strong> règles précises <strong>et</strong><br />
écrites pour traiter certains problèmes particuliers, <strong>en</strong> produisant <strong>des</strong> règles ambiguës appe<strong>la</strong>nt <strong>des</strong><br />
interprétations différ<strong>en</strong>tes selon le point de vue de l’intéressé, ou <strong>en</strong> fuyant devant <strong>la</strong> nécessité<br />
11 Nous <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dons par acteur à <strong>la</strong> fois <strong>des</strong> individus <strong>et</strong> <strong>des</strong> cadres organisés, qu’il s’agisse d’institutions sociales<br />
comme <strong>la</strong> famille, d’organisme administratif ou d’<strong>en</strong>treprise.<br />
12 J. R. Commons (1932) ‘The problem of corre<strong>la</strong>ting <strong>la</strong>w, economics, and <strong>et</strong>hics’ Wisconsin Law Review<br />
N° 8 pp3-26, cité par Williamson ‘According to Commons ‘The ultimate unit of activity … must<br />
contain in itself the three principles of conflict, mutuality, and order. This unit is a transaction’<br />
13 M. Weber (1971), Economie <strong>et</strong> Société, Tome Premier, ed. Plon<br />
14 M.Weber op.cit. p. 222<br />
Chapitre IV. Processus décisionnels déc<strong>en</strong>tralisés <strong>et</strong> leadership 87