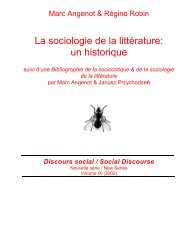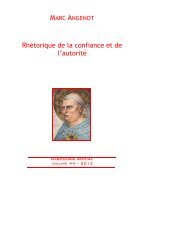Interventions critiques (Volume I) : Questions d ... - Marc Angenot
Interventions critiques (Volume I) : Questions d ... - Marc Angenot
Interventions critiques (Volume I) : Questions d ... - Marc Angenot
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
s’effondrent et qu’elles acquièrent de la notoriété en même temps que de l’acceptabilité. On<br />
peut former des hypothèse sur ces changements de statut qui sont concomitants à des<br />
changements de forme et de régions d’application: ces changements forment tendance et pour<br />
le meilleur ou le pire ils convergent et ils vont quelque part. On peut donc y lire une histoire<br />
anticipée. Et ici il ne s’agit plus évidemment d’innovations conçues comme liées à une<br />
quelconque idéologie du progrès, progrès social ou esthétique. (Mais liée encore – et c’est ce<br />
qui rapproche les deux paradigmes et permet parfois de les confondre – à une méfiance<br />
sceptique à l’égard de ce qui reçoit la légitimation, la caution soit des foules, des mouvements<br />
d’opinion, soit des arbitres établis, des establishments de diverses natures qui se sont automandatés<br />
pour légitimer au nom du Socius). Au contraire ici, l’idée d’innovation, le repérage<br />
de quelque chose comme nouveau et comme progressant à plus ou moins vive allure, est<br />
directement relié à l’idée de «malheur des temps». Quand on parle de «montée du fascisme»<br />
dans les années 1920, quand on étudie comme le fit Jean-Pierre Faye les Langages totalitaires<br />
de l’Allemagne de Weimar, quand on construit (à l’indignation d’autres historiens) comme<br />
l’a fait Zeev Sternhell, le concept de pré-fascisme – on lit aussi parfois proto-fascisme – on<br />
fabrique des idéaltypes tendanciels, des émergences qui conduisent à de résistibles ou selon<br />
le cas irrésistibles ascensions, des entités avant la lettre qui servent d’interprétants à des<br />
conjectures sur la conjoncture, sur la «pente de l’Histoire» à moyen terme. Je prends le cas<br />
de l’explication du fascisme parce que c’est le cas, le lieu d’application typique pour le XX ème<br />
siècle de ce paradigme et de cette historiosophie ad hoc, amis il ne faut aucunement croire<br />
que ce soit le cas unique. (Mais bien sûr cela marche très bien en ce domaine, il suffit de voir<br />
les historiques et chroniques de publicistes à l’égard de l’ascension de Le Pen en France au<br />
cours desdites années 1980). L’explication de la conjoncture en termes d’intersignes (sur quoi<br />
j’ai travaillé en étudiant notamment l’herméneutique européenne du drame de Meyerling) 7<br />
et de malheur des temps doit elle-même s’interpréter. Et pour la critiquer, il faut la<br />
rapprocher de ce que Albert Hirschmann dans un ouvrage magistral caractérise comme le<br />
rhétorique et l’herméneutique réactionnaires.<br />
4. Hétérogénéité «gnoséologique» ou mentalitaire: au delà de la diversité des opinions, des<br />
thèmes et des disciplines, une diversité de manières de penser coexistant dans la même<br />
société, mais n’appartenant pas à la «même planète». Question: les langages publics en<br />
7 «Le Drame de Meyerling: production narrative, acceptabilité et discours social», in WALTER MOSER ET<br />
FRANÇOIS LATRAVERSE, dir. Vienne au tournant du siècle. Montréal: Hurtubise / Brèches & Paris: Albin-<br />
Michel, 1988, pp. 67-90.<br />
55