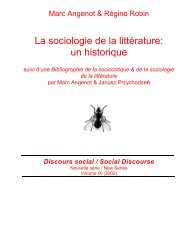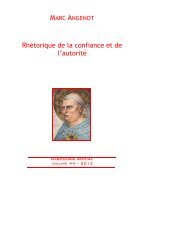Interventions critiques (Volume I) : Questions d ... - Marc Angenot
Interventions critiques (Volume I) : Questions d ... - Marc Angenot
Interventions critiques (Volume I) : Questions d ... - Marc Angenot
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Le «roman» conjectural qui va se développer s’appuie sur un coup de force sémiotique, qui,<br />
de sa naïveté, fonde l’activité du préhistorien. Une frénésie sémiotique était à l’œuvre dès<br />
Boucher de Perthes: il s’agissait d’identifier selon des catégories explicatives tout silex, tout<br />
ossement découvert. Or, par une évidente pétition de principe, cette identification fallacieuse<br />
présupposait une impossible familiarité avec les objets découverts. On ne peut voir dans des<br />
silex des poignards, pierres de jet, marteaux, masses, hachoirs, racloirs, grattoirs, hachereaux,<br />
pointes de lance, ni dans un bois de renne, un «bâton de commandement» (thèse de Lartet),<br />
qu’en incluant dans les prémisses de cette sémiotique sauvage ce qui va se retrouver dans les<br />
conclusions. Le risque de ce raisonnement circulaire est illustré par une gravure de Boucher<br />
de Perthes (planches du ch. XXIII, Antiquités celtiques et antédiluviennes, 1863): l’homme<br />
préhistorique a dû chercher à représenter la face humaine, pensait l’illustre Amiénois; d’où<br />
les silex où il distinguait des yeux, des nez, des oreilles et des bouches: simples curiosités<br />
naturelles transmuées par la «volonté de savoir» en preuves archéologiques. L’euphorie que<br />
détermine cette sorte d’Eureka Erlebnis correspond à une forme d’optimisme cognitif qui peut<br />
se résumer dans le verset de Matthieu: «Quiconque demande reçoit et qui cherche trouve»<br />
(Matth., VII, 8). Cette sémiotique triviale n’est pas étrangère à la doctrine scientifique: elle<br />
semble correspondre ici à une forme fruste de raisonnement lamarckien. Lorsque Fraipont<br />
et Lohest cherchent à expliquer les épaisses saillies sourcilières des Néanderthaliens, ils les<br />
attribuent au fait que l’homme de Néanderthal, vivant dans un milieu hostile, doit avoir<br />
froncé les sourcils pendant des millénaires jusqu’au jour où sa structure faciale a évolué selon<br />
cette adaptation fonctionnelle .<br />
6<br />
La sémiotique spontanée du préhistorien semble opérer par cette double sémiosis<br />
appelée par Hjelmslev «connotation». Mais à l’examen, on voit le caractère réducteur du<br />
modèle hjelmslevien quand il est appliqué à ces opérations signifiantes où le signifié second<br />
ne se trouve aucunement homologue à la constitution du signe premier. Si le premier effet<br />
de sens est toujours une inférence indicielle, le second se produit à travers un récit implicite,<br />
c’est-à-dire l’évocation d’une topique narrative. Le préhistorien qui découvre les cendres d’un<br />
ancien foyer postule un premier indiqué, l’usage du feu: c’est ici un indice dont la double face<br />
s’articule en un continuum naturel. Mais, par «connotation», il tire de l’indiqué/feu/, sans<br />
trop de peine, l’institution familiale, le raffinement progressif des mœurs. Nous ne sommes<br />
6 Julien Fraipoint et Max Lohest, La Race humaine de Néanderthal ou de Canstadt en Belgique: Recherches<br />
ethnographiques sur les ossements humains découverts [...] à Spy, Gand, Vanderpoorten, 1887, p. 661.<br />
66