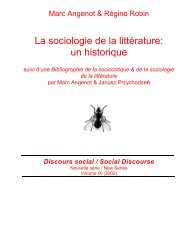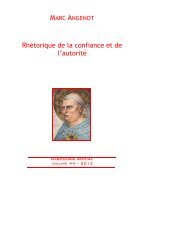Interventions critiques (Volume I) : Questions d ... - Marc Angenot
Interventions critiques (Volume I) : Questions d ... - Marc Angenot
Interventions critiques (Volume I) : Questions d ... - Marc Angenot
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
scientificité, mais il est aussi largement imprégné par le modèle de la littérature romanesque.<br />
Par là, nous n’entendons pas seulement que, de l’argumentation savante, de la description<br />
et de la classification, bourgeonnent des développements narratifs qui finissent par envahir<br />
la trame du discours; pas seulement que ces développements sont des «fictions», c’est-à-dire<br />
pour le lecteur moderne des dérives conjecturales non falsifiables, mais bien que les traits<br />
axiomatiques de ces récits (sur l’origine du feu, de la famille et de la propriété, par exemple)<br />
sont de caractère romanesque, qu’ils sont empruntés à la fiction littéraire devenue au XIX e<br />
siècle forme hégémonique de la narration. Cette narration romanesque n’est pas à nos yeux<br />
l’irruption aberrante d’un discours hétérogène à la perspective scientifique. Le romanesque<br />
devra être traité comme compatible avec les finalités cognitives poursuivies. Le type de<br />
conjecture rationnelle qui s’y déploie, fondé sur une sémiotique du sens commun, divers<br />
préceptes de la narration littéraire et les préconstruits du vraisemblable de fiction, c’est ce<br />
que nous nous donnons d’abord à circonscrire et à illustrer.<br />
En premier examen, trois éléments composent la stratégie discursive des ouvrages<br />
d’anthropologie préhistorique: une rhétorique de la rigueur scientifique conférant au texte<br />
sa légitimité et son statut, une projection sémiotique sauvage et un bourgeonnement narratif<br />
qui découle de cette «sémiosis» et envahit de ses conjectures le discours.<br />
Rhétorique cognitive<br />
La rhétorique savante est essentiellement fondée sur l’activité taxinomique. Il s’agit<br />
d’imposer au désordre tellurique des fouilles, au disparate des découvertes archéologiques<br />
une illusion de logique et avant tout de continuité chronologique surdéterminée. D’où ces<br />
séries: acheuléen, chelléen, moustérien, solutréen, aurignacien, magdalénien, azilien... Le lieu<br />
et le temps sont mis en paramètres et l’idéologie du progrès s’empare de la classification des<br />
industries lithiques. Aux noms vulgaires se substituent des termes savants: le mammouth est<br />
identifié comme Elephas primigenius; le renne comme Cervus tarandus, la marmotte comme<br />
Arctomys marmota. Comme il arrive fréquemment dans les stratégies rhétoriques, une<br />
stratégie contraire vient confirmer la légitimation opérée par l’assertivité taxinomique: il<br />
s’agit de l’ostentation de prudence scientifique comme moyen paradoxal de conférer au texte<br />
sa véracité.<br />
Sémiotique sauvage<br />
65