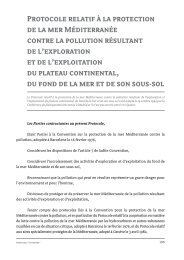- Page 1 and 2:
In cooperation with: En coopératio
- Page 3 and 4:
- i - This volume is the one-hundre
- Page 5 and 6:
TABLE OF CONTENTS Page No. 1. INTRO
- Page 7 and 8:
Page No. 6.2.2 Effect of the oxygen
- Page 9 and 10:
Page No. 8. MANAGEMENT OF EUTROPHIC
- Page 11 and 12:
- 2 - The document describes the pr
- Page 13 and 14:
- 4 - Visibly, eutrophication and i
- Page 15 and 16:
- 6 - It is to be noted that aspect
- Page 17 and 18:
- 8 - A significant number of macro
- Page 19 and 20:
- 10 - Because of incomplete transf
- Page 21 and 22:
3.2.2 Metabolic processes - 12 - 3.
- Page 23 and 24:
- 14 - mineralization occurs essent
- Page 26 and 27:
or, - 17 - SO 4 2- [S] S2 - SO 4
- Page 28 and 29:
- 19 - specific algal blooms. Also
- Page 30 and 31:
- 21 - and oxygen consumption due t
- Page 32:
- 23 - conditions, the geochemical
- Page 38 and 39:
- 29 - confounded with source emiss
- Page 40 and 41:
- 31 - Table 2 Export Coefficients
- Page 43 and 44:
- 34 - Table 3 Origin of Nitrogen a
- Page 45 and 46:
- 36 - Table 4 Estimated Nitrogen a
- Page 47 and 48:
- 38 - Table 5 River Po: Nitrogen a
- Page 49 and 50:
- 40 - In conclusion, the procedure
- Page 51 and 52:
- 42 - Mapping of this sort could b
- Page 53:
- 44 - and flux pattern of nitrogen
- Page 56 and 57:
Albania France 2 Greece Italy 2 Mal
- Page 59 and 60:
- 50 - Table 9 Land Use and Trend i
- Page 61 and 62:
- 52 - A generalized Model. Essenti
- Page 63 and 64:
- 54 - Table 12a Livestock Populati
- Page 65 and 66:
- 56 - Table 13a Estimated Total Ni
- Page 67 and 68:
- 58 - representing about 50 to 60%
- Page 69 and 70:
- 60 - otherwise natural yet low su
- Page 71 and 72:
- 62 - Transfer through, and exchan
- Page 73 and 74:
- 64 - the required deficit to acco
- Page 75 and 76:
A) Morphometry Surface sqkm Mediter
- Page 78:
- 69 - winter months (Del Rio et al
- Page 81 and 82:
- 72 - widespread, with secondary e
- Page 83 and 84:
Sardinia - 74 - In general, the coa
- Page 86:
- 77 - soluble nitrogen salts and a
- Page 90 and 91:
- 81 - bloom of Noctiluca miliaris
- Page 92:
- 83 - in 1984 (Pucher-Petkovic et
- Page 95:
- 86 - dead), etc. are occluded. As
- Page 98 and 99:
- 89 - Bay of Thessaloniki (north-w
- Page 100 and 101:
- 91 - Southern coasts. Basturk et
- Page 102 and 103:
- 93 - Since the '60s the inputs fr
- Page 104 and 105:
- 95 - which occur in all the seas
- Page 107 and 108:
- 98 - Initially, there is a revers
- Page 109 and 110:
- 100 - (c) Acute toxicity tests on
- Page 111 and 112:
- 102 - 6.2.1 Effect of oxygen defi
- Page 113 and 114:
- 104 - Naticarius millepunctatus (
- Page 115:
- 106 - Observations in the field h
- Page 118:
- 109 - This environmental disturba
- Page 121 and 122:
- 112 - In regard to considering th
- Page 125 and 126:
- 116 - was recorded in Spain (63 c
- Page 127:
- 118 - 7.2.1.8 Human intoxication:
- Page 130:
7.2.2 Diarrhetic Shellfish Poisonin
- Page 133 and 134:
- 124 - 7.2.2.4 DSP occurrence in t
- Page 135 and 136:
- 126 - Transplantation of mussels
- Page 137 and 138:
- 128 - shellfish production sites
- Page 139:
- 130 - 7.3.1.4 Occurrence of Proro
- Page 142:
- 133 - act to open membrane channe
- Page 147 and 148:
- 137 - Mechanism of action. While
- Page 150 and 151:
- 140 - 7.4 General facts on eutrop
- Page 153 and 154:
- 143 - Cycle B: refers to aspects
- Page 155 and 156:
- 145 - - Protection of human healt
- Page 157 and 158:
- 147 - coverage of the sources of
- Page 159 and 160:
- 149 - Forcing functions such as i
- Page 161 and 162:
10.1 Elimination of nutrients at so
- Page 163 and 164:
- 153 - presents also a risk, parti
- Page 165 and 166:
- 155 - - inland water management;
- Page 167 and 168:
- 157 - The Shores Act, therefore,
- Page 169 and 170:
13.2 Assessment of the present stat
- Page 171 and 172:
- 161 - Appendix I MEASUREMENTS OF
- Page 173 and 174:
- 163 - biogenic sestonic organic m
- Page 175 and 176:
- 165 - Alam, M., Y. Shimizu, M. Ik
- Page 177 and 178:
- 167 - Ballantine, D. and B.C. Abb
- Page 179 and 180:
- 169 - Bombace, G. (1985). Eutrofi
- Page 181 and 182:
- 171 - Capria A. (1988). Direttive
- Page 183 and 184:
- 173 - Chiaudani, G., G. Gaggino,
- Page 185 and 186:
- 175 - Cummins, J.M., A.C. Jones a
- Page 187 and 188: - 177 - Doyle, J. M. Parker, T. Dun
- Page 189 and 190: - 179 - Franco, P. and A. Michelato
- Page 191 and 192: - 181 - Giovanardi, G. and E. Trome
- Page 193 and 194: - 183 - Hickel, W. (1991). Long-ter
- Page 195 and 196: - 185 - Justic, D. (1987). Long-ter
- Page 197 and 198: - 187 - Krogh, P., L. Edlar, E. Gra
- Page 199 and 200: - 189 - Lüthy, J. (1979). Epidemic
- Page 201 and 202: - 191 - Martin, D.F. and A.B. Chatt
- Page 203 and 204: - 193 - Moro, I. and C. Andreoli (1
- Page 205 and 206: - 195 - Pagou, K. and L. Ignatiades
- Page 207 and 208: - 197 - Precali, R. (1995). Analysi
- Page 209 and 210: - 199 - Revelante, N., W.T. William
- Page 211 and 212: - 201 - Sampayo, M.A. de M., P. Alv
- Page 213 and 214: - 203 - Skagshaug, E. and Y. Olsen
- Page 215 and 216: - 205 - Takai, A., C. Bialojan, M.
- Page 217 and 218: - 207 - Vatova, A. (1949). La fauna
- Page 219 and 220: - 209 - Vollenweider, R.A. and A.A.
- Page 221 and 222: - 211 - Yentch, C.S. and R.F. Vacca
- Page 223 and 224: TABLE DES MATIERES Page No. 1. INTR
- Page 225 and 226: Page No. 6.2 Dommages occasionnés
- Page 227 and 228: Page No. 7.3.6 Les toxines de cyano
- Page 229 and 230: 1. INTRODUCTION - 221 - Aux termes
- Page 231 and 232: - 223 - - élimination/réduction d
- Page 233 and 234: - 225 - bien au-delà, alors que l'
- Page 235 and 236: - 227 - 3. CAUSES ET MECANISMES DE
- Page 237: 3.1.2 Producteurs secondaires - 229
- Page 241 and 242: - 233 - C 106N 16H 180O 44(PO 4)SH
- Page 243 and 244: - 235 - qui excèdent l'unité 4 .
- Page 245: - 237 - Azote. La séquence est com
- Page 248 and 249: - 240 - L'agrégation hiérarchique
- Page 250 and 251: - 242 - brassage en profondeur, des
- Page 252 and 253: - 244 - la méthode retenue pour ca
- Page 256: - 248 - de traitement secondaire, c
- Page 260 and 261: - 252 - kg/jour, t/année, etc., ma
- Page 262 and 263: 4.3.3 Voies de cheminement et flux
- Page 265 and 266: - 257 - l'ammoniaque et de l'urée
- Page 267 and 268: - 259 - Tableau 4 Exportations esti
- Page 269 and 270: - 261 - Tableau 5 Le Pô: exportati
- Page 271 and 272: - 263 - correcte à la question, on
- Page 273 and 274: - 265 - Val d'Aoste, Lombardie, Emi
- Page 275: - 267 - La comparaison entre ces es
- Page 278 and 279: - 270 - Tableau 7 Population par pa
- Page 280: - 272 - des polyphosphates des dét
- Page 283 and 284: Albanie France Grèce Italie Malte
- Page 285 and 286: - 277 - ii) sur la charge domestiqu
- Page 287 and 288: - 279 - sont retenus dans le bassin
- Page 289 and 290:
- 281 - Tableau 13b Estimation de l
- Page 291 and 292:
- 283 - Tableau 14 Régions et fleu
- Page 293 and 294:
Région 1 Alboran 2 Nord-ouest 3 Su
- Page 295 and 296:
- 287 - d'éléments nutritifs d'or
- Page 297 and 298:
- 289 - Une autre perspective qu'on
- Page 299:
- 291 - En raison de cet afflux et
- Page 302:
- 294 - ont été observées en div
- Page 305 and 306:
- 297 - périodes; on l'observe par
- Page 307 and 308:
Sardaigne - 299 - Dans l'ensemble,
- Page 310:
- 302 - La situation des eaux côti
- Page 314 and 315:
- 306 - des courants à direction s
- Page 316 and 317:
- 308 - bassins hydrographiques de
- Page 319 and 320:
- 311 - Les causes de la grave dét
- Page 322 and 323:
- 314 - Cependant, dans des diverse
- Page 324 and 325:
- 316 - dominants ont tendance à s
- Page 326 and 327:
5.2.10 Israël. Méditerranée orie
- Page 328 and 329:
- 320 - reçoit 75% des apports dus
- Page 330 and 331:
6.1.1 Dinophycées - 322 - Les pull
- Page 333 and 334:
- 325 - polysaccharide, 26 groupeme
- Page 335 and 336:
- 327 - d'"eaux anormalement color
- Page 337 and 338:
- 329 - 6.2 Dommages occasionnés a
- Page 339 and 340:
- 331 - Lors de l'épisode de morta
- Page 341 and 342:
- 333 - dans la recolonisation des
- Page 344 and 345:
- 336 - L'étude d'impact sur l'env
- Page 347 and 348:
- 339 - naturelle et anthropique so
- Page 349:
- 341 - Des données récentes indi
- Page 353 and 354:
- 345 - Des échantillons de planct
- Page 355:
- 347 - sur les canaux ioniques. Le
- Page 358:
- 350 - sacculus, Prorocentrum lima
- Page 361 and 362:
- 353 - algales liposolubles, confo
- Page 363 and 364:
- 355 - Des moules toxiques du nord
- Page 365 and 366:
- 357 - encore procédé à une év
- Page 367 and 368:
- 359 - l'expansion progressive ver
- Page 370:
- 362 - canadienne actuelle, s'appl
- Page 374 and 375:
- 366 - éliminent 60% de la toxine
- Page 376:
- 368 - des proliférations de phyt
- Page 379:
- 371 - En dehors des effets négat
- Page 382 and 383:
- 374 - autrement dit le temps néc
- Page 384 and 385:
- 376 - l'eutrophisation, sauf prè
- Page 386 and 387:
- 378 - Quand des aspects important
- Page 388 and 389:
- 380 - Le type de traitement et de
- Page 390 and 391:
- 382 - d'épuration. L'épandage e
- Page 392 and 393:
- 384 - moyen de canalisations pos
- Page 394 and 395:
Espagne - 386 - - La loi relative a
- Page 396 and 397:
Turquie - 388 - La loi sur l'enviro
- Page 398 and 399:
- 390 - POL - Phase II), mené dans
- Page 400 and 401:
- 392 - Appendice I MESURES DE LA B
- Page 402 and 403:
- 394 - La détermination respectiv
- Page 404 and 405:
- 396 - Alam, M., N.M. Trieff, S.M.
- Page 406 and 407:
- 398 - Balci, A., F. Kucuksezgin,
- Page 408 and 409:
- 400 - Bodeanu, N. and M. Usurelu
- Page 410 and 411:
- 402 - Capelli F. and E. Friz (198
- Page 412 and 413:
- 404 - Chiaudani, G, R. Marchetti
- Page 414 and 415:
- 406 - Cummins, J.M., A.A. Stevens
- Page 416 and 417:
- 408 - Dowidar, N.M. and T.A. Abou
- Page 418 and 419:
- 410 - Fraga, S., J. Marino, I. Br
- Page 420 and 421:
- 412 - Giordani, P. (1990b). Il mo
- Page 422 and 423:
- 414 - Hescheler, J., G. Mieskes,
- Page 424 and 425:
- 416 - Jørgensen, B.B. (1980). Se
- Page 426 and 427:
- 418 - Krogh, P. (1989). Report of
- Page 428 and 429:
- 420 - Lüthy, J. (1979). Epidemic
- Page 430 and 431:
- 422 - Martin, J.-M., F. Elbaz-Pou
- Page 432 and 433:
- 424 - Morton, B. (1989). Pollutio
- Page 434 and 435:
- 426 - Paulmier, G. (1977). Note s
- Page 436 and 437:
- 428 - Provini, A., G.F. Gaggino a
- Page 438 and 439:
- 430 - Riggio, S., G. D'Anna and M
- Page 440 and 441:
- 432 - Sato, S., P. Nogueira, M. P
- Page 442 and 443:
- 434 - Solomon, A.E. and R.B. Stou
- Page 444 and 445:
- 436 - Taylor, F.Y.R. (1990). Toxi
- Page 446 and 447:
- 438 - Viviani, R. (1977a). Aspett
- Page 448 and 449:
- 440 - Vukadin, I. (1992). Impact
- Page 450 and 451:
- 442 - Zevenboom, W., M. Rademaker
- Page 452 and 453:
- 444 - 14. UNEP: Experience of Med
- Page 454 and 455:
- 446 - 46. UNEP/WHO: Epidemiologic
- Page 456 and 457:
- 448 - 75. UNEP/WHO: Development a
- Page 458 and 459:
- 450 - PUBLICATIONS "MAP TECHNICAL
- Page 460 and 461:
- 452 - 28. PNUE: Etat du milieu ma
- Page 462 and 463:
- 454 - 59. PNUE/FAO/AIEA: Actes de
- Page 464 and 465:
- 456 - 90. PNUE: Projet de la Baie