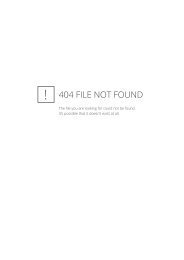Chauffage Compressionnel de l'Environnement des Disques ...
Chauffage Compressionnel de l'Environnement des Disques ...
Chauffage Compressionnel de l'Environnement des Disques ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.3 Discussion 33<br />
on trouve que la vitesse thermique doit être inférieure à 500 km/s. Dans ce cas, l’hélium<br />
n’est pas confiné et doit s’échapper. Cependant, en physique <strong>de</strong>s plasmas, lorsque l’on peut<br />
approcher l’équation <strong>de</strong> fermeture avec un indice γ, celui-ci vaut rarement 5/3. Un équation<br />
<strong>de</strong> fermeture adiabatique a été proposée par Chew et al. (1956) qui suggère non pas un indice,<br />
mais <strong>de</strong>ux pour gar<strong>de</strong>r la nature anisotrope <strong>de</strong>s plasmas magnétisés, avec γ ‖ = 3 et γ ⊥ = 2.<br />
Avec cette équation <strong>de</strong> fermeture, la vitesse thermique limite pour l’hélium est <strong>de</strong> 800 km s −1 ,<br />
ce qui permettrait à l’hélium <strong>de</strong> rester confiné dans le plan Galactique. Le mieux serait en fait<br />
<strong>de</strong> remplacer l’équation <strong>de</strong> fermeture par l’observation simultanée <strong>de</strong>s profils <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité et <strong>de</strong><br />
température. Les observations montrent une très gran<strong>de</strong> homogénéité <strong>de</strong> la température sur<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s échelles que ne suit probablement pas la <strong>de</strong>nsité puisque l’émission chute à haute<br />
altitu<strong>de</strong>. Une fermeture <strong>de</strong> type isotherme (γ ‖ = γ ⊥ = 1), pourrait donc décrire au mieux le<br />
plasma à 8 keV, sans que nous puissions mieux la justifier. Dans ce cas, comme nous l’avons<br />
vu dans la section précé<strong>de</strong>nte, l’hélium est confiné.<br />
2.3.3 Structure à gran<strong>de</strong> échelle du champ magnétique<br />
tel-00011431, version 1 - 20 Jan 2006<br />
La structure du champ magnétique à gran<strong>de</strong> échelle est un paramètre essentiel <strong>de</strong> notre<br />
modèle. L’échappement les protons se fait le long <strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> champ magnétique. Si elles<br />
sont inclinées notoirement, l’échappement ne peut plus s’effectuer verticalement et le temps<br />
pour s’échapper <strong>de</strong>s 100 premiers parsecs est allongé d’autant. Cet allongement du temps<br />
<strong>de</strong> fuite pourrait laisser le temps aux protons d’interagir avec les ions d’hélium et <strong>de</strong> les<br />
entraîner. Cependant, pour que le temps d’échappement <strong>de</strong>vienne comparable avec le temps<br />
<strong>de</strong> collision, il faudrait une inclinaison <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 70 <strong>de</strong>grés par rapport à la verticale, un<br />
champ presque horizontal donc. Un champ horizontal structuré à gran<strong>de</strong> échelle confinerait<br />
certainement les protons, ce qui résoudrait le problème énergétique mais un tel champ a peu<br />
<strong>de</strong> chance <strong>de</strong> rester stable vis-à-vis <strong>de</strong> l’instabilité <strong>de</strong> Parker (Parker 1966) sur <strong>de</strong>s échelles <strong>de</strong><br />
temps Galactiques. De plus, il serait très difficile à concilier avec la verticalité <strong>de</strong>s filaments<br />
non-thermiques observés. Si ces filaments tracent bien le champ magnétique, ils pourraient<br />
effectivement indiquer une légère divergence à gran<strong>de</strong> échelle, mais les angles observés sont<br />
inférieurs à 20 <strong>de</strong>grés, ce qui est très insuffisant pour permettre aux protons d’entraîner les<br />
autres espèces.<br />
La linéarité <strong>de</strong> ces filaments exclut également un champ similaire à celui <strong>de</strong>s régions plus<br />
externes <strong>de</strong> la Galaxie, c’est-à-dire très turbulent et en moyenne toroïdal (modèle proposé<br />
par Tanuma et al. 1999).<br />
2.3.4 Turbulence<br />
La question <strong>de</strong> la turbulence est en fait intéressante. Une forte turbulence, même avec un<br />
champ principalement vertical, retiendrait en effet probablement les protons et les empêcherait<br />
<strong>de</strong> s’échapper, ou tout au moins ralentirait significativement leur fuite. Cependant, plusieurs<br />
raisons font penser qu’effectivement, le milieu est assez calme.<br />
On peut distinguer <strong>de</strong>ux échelles limites <strong>de</strong> turbulence : <strong>de</strong> la turbulence à gran<strong>de</strong> échelle<br />
qui affecterait la structure du champ magnétique sur une échelle comparable à la taille <strong>de</strong> la<br />
région qui nous intéresse, et une turbulence à petite échelle, c’est-à-dire à l’échelle du rayon<br />
<strong>de</strong> Larmor <strong>de</strong>s particules. Dans le MIS standard, plus loin dans le disque, la turbulence en<br />
général est engendrée par les supernovae, les mouvements <strong>de</strong>s nuages. Le champ magnétique<br />
étant principalement toroïdal, elle peut tordre et enrouler ses lignes <strong>de</strong> champ au point <strong>de</strong><br />
le rendre turbulent aussi. Dès lors, toute perturbation turbulente créée dans le disque doit<br />
suivre les lignes <strong>de</strong> champ et donc y rester, ce qui lui permet d’interagir à nouveau nonlinéairement<br />
avec d’autres perturbations et autorise ainsi une casca<strong>de</strong> à toutes les échelles<br />
et un fort niveau turbulence. Ici, avec un champ principalement vertical, toute perturbation





![[tel-00726959, v1] Caractériser le milieu interstellaire ... - HAL - INRIA](https://img.yumpu.com/50564350/1/184x260/tel-00726959-v1-caractacriser-le-milieu-interstellaire-hal-inria.jpg?quality=85)