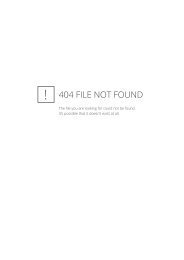Chauffage Compressionnel de l'Environnement des Disques ...
Chauffage Compressionnel de l'Environnement des Disques ...
Chauffage Compressionnel de l'Environnement des Disques ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
70 Binaires X et microquasars<br />
Leur première particularité est la nature <strong>de</strong> leur émission lumineuse : ces sources émettent<br />
la plus gran<strong>de</strong> part <strong>de</strong> leur rayonnement dans le domaine <strong>de</strong> rayons X, contrairement aux<br />
étoiles classiques qui émettent surtout en lumière visible. C’est la raison pour laquelle il a<br />
fallu attendre l’avènement <strong>de</strong> l’astronomie X pour les découvrir. Les mécanismes nécessaires<br />
à la production d’un tel rayonnement sont en général bien plus énergétiques que ceux responsables<br />
<strong>de</strong>s émissions à plus basse fréquence. Ensuite, ces sources possè<strong>de</strong>nt une luminosité<br />
exceptionnelle : chacune d’elles émet typiquement comme 10 000 soleils (L ∼ 10 37 erg s −1<br />
= 10 4 L ⊙ ) 1 . Enfin, ces nouvelles sources sont caractérisées par une variabilité très marquée<br />
et très rapi<strong>de</strong>. Les variations d’intensité se font souvent sur <strong>de</strong>s échelles aussi courtes que<br />
quelques millisecon<strong>de</strong>s, signe que les sources sont <strong>de</strong>s objets <strong>de</strong> petite taille, bien plus petites<br />
que la taille typique d’une étoile.<br />
4.1.2 Les objets compacts<br />
tel-00011431, version 1 - 20 Jan 2006<br />
Toutes ces informations pointent en fait <strong>de</strong> concert pour désigner les objets compacts<br />
comme responsables <strong>de</strong> cette émission hors du commun. Par définition, ces objets sont <strong>de</strong>s<br />
astres extrêmement <strong>de</strong>nses, si <strong>de</strong>nses même, que dans leur voisinage, le temps, l’espace et le<br />
comportement global <strong>de</strong> la matière ne peuvent plus être décrits par la physique habituelle, dite<br />
newtonienne. Cette <strong>de</strong>rnière cè<strong>de</strong> alors la place à la physique relativiste. Les objets compacts<br />
sont donc le lieu idéal pour appréhen<strong>de</strong>r, tester et comprendre la relativité générale.<br />
Les objets compacts <strong>de</strong> taille stellaire sont <strong>de</strong> manière générique le sta<strong>de</strong> ultime <strong>de</strong> la vie<br />
<strong>de</strong>s étoiles standard. Selon leur masse initiale et leurs conditions d’évolution, ces <strong>de</strong>rnières<br />
peuvent former trois types d’objets compacts : <strong>de</strong>s naines blanches, <strong>de</strong>s étoiles à neutrons<br />
ou <strong>de</strong>s trous noirs. Pour caractériser un objet compact, on définit souvent le paramètre <strong>de</strong><br />
relativité ou <strong>de</strong> compacité :<br />
Ξ = GM<br />
Rc 2 (4.1)<br />
où M et R sont respectivement la masse et le rayon <strong>de</strong> l’objet compact, c est la vitesse <strong>de</strong> la<br />
lumière et G la constante <strong>de</strong> gravitation. Ce paramètre Ξ représente l’énergie gravitationnelle<br />
<strong>de</strong> l’objet ramenée à son énergie <strong>de</strong> masse. Plus l’objet est massif et <strong>de</strong> petite taille, plus Ξ<br />
est grand et plus l’objet est dit compact. La compacité <strong>de</strong>s trois types d’objets compacts est<br />
donnée dans le tableau 4.1. Des trois, les naines blanches sont les moins <strong>de</strong>nses et les trous<br />
noirs sont les objets les plus compacts que l’on connaisse.<br />
Astre<br />
compacité Ξ<br />
Terre<br />
Soleil<br />
10 −6<br />
Naine blanche 10 −3 − 10 −4<br />
Etoile à neutrons 0.2<br />
Trou noir a 1<br />
10 −10<br />
Tab. 4.1 – Valeurs du paramètre <strong>de</strong> relativité pour quelques objets. a Le rayon d’un trou noir<br />
est une notion plus délicate, et par convention, on prend Ξ = 1.<br />
4.1.3 Le compagnon et le disque d’accrétion<br />
En 1967, la contrepartie optique d’une source X, Cyg-X1, est i<strong>de</strong>ntifiée pour la première<br />
fois et montre que la lumière visible <strong>de</strong> cette source provient d’une étoile standard (Giacconi<br />
1 1 L ⊙ = 3.83 × 10 33 erg s −1 .





![[tel-00726959, v1] Caractériser le milieu interstellaire ... - HAL - INRIA](https://img.yumpu.com/50564350/1/184x260/tel-00726959-v1-caractacriser-le-milieu-interstellaire-hal-inria.jpg?quality=85)