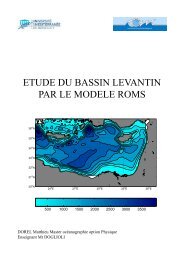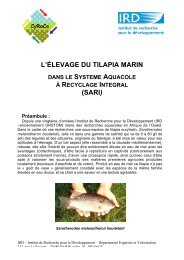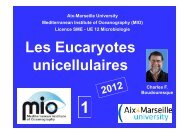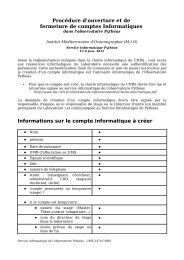invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
l'introduction du moustique Culex quinquefasciatus a apporté la malaria aviaire, qui constitue<br />
une menace pour les manchots endémiques <strong>de</strong> l'archipel (environ 500-1 000 individus), Spheniscus<br />
mendiculus, menace s'ajoutant à d'autres menaces (compétition avec l'homme pour<br />
l'accès à la ressource alimentaire) (Vargas <strong>et</strong> al., 2006).<br />
Extinctions quaternaires : l'hypothèse <strong>de</strong> la guerre-éclair<br />
En Australie, l'extinction <strong>de</strong> la plupart <strong>de</strong>s grands vertébrés (entre 51 000 <strong>et</strong> 40 000 BP) coïnci<strong>de</strong> avec l'arrivée<br />
<strong>de</strong> l'homme (entre 60 000 <strong>et</strong> 52 000 BP) ; parmi les dizaines d'espèces <strong>de</strong> vertébrés qui ont alors brusquement<br />
disparu, on peut citer un kangourou géant, une chauve-souris géante (Diprotodon), une sorte <strong>de</strong> lion marsupial,<br />
le plus grand oiseau ayant jamais existé (Genyornis newtoni), qui mesurait 3 m <strong>de</strong> hauteur, <strong>et</strong> un lézard <strong>de</strong> 8 m <strong>de</strong><br />
longueur (Megalania) (Roberts <strong>et</strong> al., 2001 ; Johnson, 2005 ; Miller <strong>et</strong> al., 2005) ; au total, 90% <strong>de</strong>s espèces <strong>de</strong><br />
grands vertébrés ont disparu (Wyatt <strong>et</strong> Carlton, 2002). En Amérique du Nord, 75% <strong>de</strong>s grands mammifères ont<br />
disparu il y a 12 000-13 000 ans ou un peu plus tôt ; c<strong>et</strong>te date coïnci<strong>de</strong> également avec une <strong>de</strong>s dates avancées<br />
pour l'arrivée <strong>de</strong>s hommes à partir <strong>de</strong> la Sibérie (Berger <strong>et</strong> al., 2001 ; Shabel, 2006) 110 . En Corse, <strong>de</strong> grands<br />
cervidés (Megaloceros cazoti) <strong>et</strong> Cynotherium sardous ont disparu vers 10 000 ans BP, ce qui coïnci<strong>de</strong> avec<br />
l'arrivée <strong>de</strong>s hommes. Il en va <strong>de</strong> même aux Antilles (5 000 ans BP) <strong>et</strong> à Madagascar (2 300 ans BP) (Shabel,<br />
2006). Enfin, en Nouvelle-Zélan<strong>de</strong>, une vague d'extinctions coïnci<strong>de</strong> avec l'arrivée <strong>de</strong>s hommes, venus <strong>de</strong> Polynésie,<br />
il y a environ 500 ans (Shabel, 2006). Contrairement à l'Afrique, où la gran<strong>de</strong> faune a co-évolué avec<br />
l'homme, la faune d'Australie, d'Amérique, <strong>de</strong> Corse, <strong>de</strong> Nouvelle-Zélan<strong>de</strong>, <strong>et</strong>c. était ‘naïve’ à l'arrivée <strong>de</strong><br />
l'homme, <strong>et</strong> s'est laissée rapi<strong>de</strong>ment massacrer 111 . On désigne ce phénomène d'extinctions <strong>de</strong> la méga-faune sous<br />
le nom d'hypothèse <strong>de</strong> la guerre-éclair (‘blitzkrieg hypothesis’ ; Berger <strong>et</strong> al.,2001). Il est intéressant <strong>de</strong> faire le<br />
parallèle entre l'arrivée <strong>de</strong> l'homme dans <strong>de</strong> nouvelles régions <strong>et</strong> les introductions d'espèces : dans les <strong>de</strong>ux cas,<br />
la faune <strong>et</strong> la flore indigènes, qui n'ont pas co-évolué avec le nouvel arrivant, se révèlent ‘naïfs’, avec pour conséquence<br />
l'extinction dans un certain nombre <strong>de</strong> cas.<br />
L'impact <strong>de</strong>s espèces introduites ne se limite pas aux milieux insulaires. Aux USA, 68% <strong>de</strong>s<br />
extinctions <strong>de</strong> téléostéens d'eau douce sont dues à <strong>de</strong>s espèces introduites (Bright, 1998).<br />
Aux USA également, les espèces introduites ont contribué au déclin <strong>de</strong> 42% <strong>de</strong>s espèces menacées<br />
ou en danger (Schmitz <strong>et</strong> Simberloff, 1997). La fougère aquatique Salvinia molesta,<br />
extraordinairement prolifique, forme en surface un tapis continu qui intercepte la lumière,<br />
gène la circulation <strong>de</strong> l’eau <strong>et</strong> la diffusion <strong>de</strong> l’oxygène, gène l’alimentation <strong>de</strong>s oiseaux limicoles<br />
<strong>et</strong> favorise la prolifération <strong>de</strong>s moustiques <strong>et</strong> du paludisme qu’ils véhiculent (Paradis,<br />
2011 ; Paradis <strong>et</strong> Miniconi, 2011). Le silure, téléostéen originaire d'Europe <strong>de</strong> l'Est (Danube),<br />
qui peut mesurer 5 m <strong>de</strong> long <strong>et</strong> peser 400 kg, est un redoutable prédateur en Europe occi<strong>de</strong>ntale.<br />
La tortue <strong>de</strong> Flori<strong>de</strong> Trachemys scripta, extrêmement vorace, risque <strong>de</strong> remplacer la tortue<br />
cistu<strong>de</strong> indigène d'Europe ; il y en aurait déjà 200 000 individus en France continentale ;<br />
elle est également présente dans les cours d'eau <strong>de</strong> Corse (Destandau, 2010). L'écrevisse <strong>de</strong><br />
Louisiane, introduite vers 1980, <strong>et</strong> déjà présente dans une trentaine <strong>de</strong> départements français,<br />
remplace les <strong>de</strong>ux espèces indigènes. Dans le bassin <strong>de</strong> la Garonne, l'esturgeon <strong>de</strong> Sibérie<br />
110 Guthrie (2006) <strong>et</strong> d'autres auteurs considèrent que l'homme n'est pas responsable <strong>de</strong> ces extinctions, ou que<br />
son rôle a été secondaire, la cause principale étant le changement climatique (réchauffement après le <strong>de</strong>rnier<br />
maximum glaciaire), <strong>et</strong> la modification dans les ressources qu'il a entraînée. Leur thèse est toutefois très naïve <strong>et</strong><br />
peu crédible dans la mesure où elle n'explique pas pourquoi ces espèces ont surmonté les 29 premiers cycles<br />
glaciaire-interglaciaire du Pléistocène, pour ne succomber qu'au <strong>de</strong>rnier (qui n'est pas plus marqué que les<br />
autres), quand l'homme arrive en Amérique du Nord. Dans le cas <strong>de</strong> l'Australie, la phase d'extinctions massives<br />
ne correspond du reste avec aucun évènement climatique particulier (Miller <strong>et</strong> al., 2005). Voir également Berger<br />
<strong>et</strong> al. (2001) <strong>et</strong> Planhol (2004), qui défen<strong>de</strong>nt l'hypothèse climatique à l'échelle mondiale.<br />
111 Dans le cas <strong>de</strong> l'Australie, la disparition <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> faune (mégafaune) semble également due à la modification<br />
<strong>de</strong> l'habitat par l'homme. Le feu a en eff<strong>et</strong>, à la même époque, transformé un paysage d'arbres, arbustes <strong>et</strong><br />
prairies adaptés à la sécheresse en un semi-désert auquel beaucoup d'espèces n'ont pas pu s'adapter (Miller <strong>et</strong> al.,<br />
2005).<br />
113