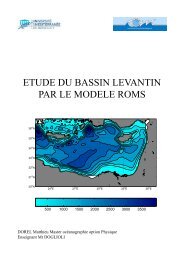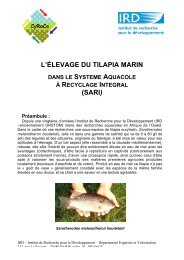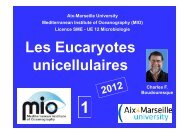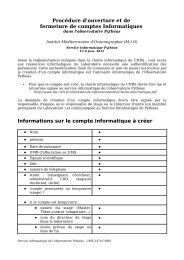invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2009 à Nice (Por, 2009 ; Noël <strong>et</strong> Meunier, 2010 ; Francour, 2011) ; en 2009, il a également<br />
atteint la Corse (Miniconi, 2010). Le réchauffement actuel <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> la Méditerranée favorise<br />
probablement la progression vers l'Ouest <strong>et</strong> le Nord <strong>de</strong>s espèces lessepsiennes (Por,<br />
2009), même si l'on ne peut pas exclure, pour certaines d'entre elles, que c<strong>et</strong>te progression<br />
s'inscrive simplement dans leur phase naturelle d'expansion, encore inachevée (Boudouresque<br />
<strong>et</strong> Verlaque, 2010 ; Lejeusne <strong>et</strong> al., 2010).<br />
Le cas du chlorobionte Caulerpa racemosa, souvent considéré comme un immigrant lessepsien,<br />
présent à Livorno (Italie ; Piazzi <strong>et</strong> al.,1994), à Marseille (Jousson <strong>et</strong> al., 1998) <strong>et</strong> dans<br />
une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> la Méditerranée nord-occi<strong>de</strong>ntale <strong>et</strong> nord-orientale, doit être reconsidéré,<br />
à la lumière <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> Verlaque <strong>et</strong> al. (2000) : la souche qui colonise le Nord <strong>de</strong> la Méditerranée<br />
appartient en eff<strong>et</strong> à un taxon différent (Caulerpa cylindracea, = C. racemosa var.<br />
cylindracea) <strong>de</strong> celui qui colonise <strong>de</strong>puis le début du 20 ième siècle le Sud <strong>et</strong> l'Est <strong>de</strong> la Méditerranée<br />
(C. racemosa var. uvifera), <strong>et</strong> correspond à un taxon introduit plus récemment, en provenance<br />
du Sud-Ouest <strong>de</strong> l'Australie, par une autre voie que le canal <strong>de</strong> Suez (Verlaque <strong>et</strong> al.,<br />
2003).<br />
Les passages dans le sens Méditerranée-mer Rouge (immigrants anti-lessepsiens) ont été<br />
beaucoup plus rares que dans le sens mer Rouge-Méditerranée (Por, 1978 ; Boudouresque,<br />
1999b)<br />
Curieusement, le canal <strong>de</strong> Panama, qui relie les Caraïbes au Pacifique, n'a été franchi que par<br />
très peu d'espèces (Galil <strong>et</strong> al., 2007). Une <strong>de</strong>s rares espèces à l'avoir franchi est le téléostéen<br />
Megalops atlanticus, installé au débouché en mer du canal, côté Pacifique (Galil <strong>et</strong> al., 2007).<br />
Une <strong>de</strong>s raisons en est que le canal n’est pas au niveau <strong>de</strong> la mer, contrairement au canal <strong>de</strong><br />
Suez. Il doit remonter la pente, grâce à <strong>de</strong>s écluses, <strong>et</strong> emprunte <strong>de</strong>s voies d’eau douce (rivières<br />
<strong>et</strong> lacs). La traversée <strong>de</strong> tronçons en eau douce constitue une barrière insurmontable<br />
pour la plupart <strong>de</strong>s espèces marines ; une autre raison, peut-être la principale dans le sens Caraïbes-Pacifique,<br />
serait la pression d'herbivores côté Pacifique (voir plus loin) (Hay <strong>et</strong> Gaines,<br />
1984).<br />
En Europe <strong>de</strong> l'Est, la construction <strong>de</strong> canaux a mis en relation, <strong>de</strong>puis la fin du 18 ième siècle,<br />
la mer Baltique, la mer Noire <strong>et</strong> la mer Caspienne, via leurs réseaux fluviaux respectifs (Olenin,<br />
2002 ; Galil <strong>et</strong> al., 2007). S'agissant <strong>de</strong> mers saumâtres à douces, le passage par les<br />
fleuves <strong>et</strong> les canaux est possible pour beaucoup d'espèces. La moule zébrée Dreissena polymorpha,<br />
originaire <strong>de</strong> la mer Caspienne,a été la première espèce recensée à utiliser ce corridor<br />
fluvial, sans doute attachée à <strong>de</strong>s ra<strong>de</strong>aux <strong>de</strong> bois : elle a été signalée au début du 19 ième siècle<br />
dans les lagunes <strong>de</strong> la Baltique (Olenin, 2002). Ce réseau reste actif : <strong>de</strong>s téléostéens gobiidés<br />
du genre Neogobius <strong>de</strong> mer Noire ont été signalés dans les années 1990s dans <strong>de</strong>s lagunes<br />
associées à la mer Baltique (Olenin, 2002). Des canaux relient également les bassins <strong>de</strong> l'Est<br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong> l'Ouest <strong>de</strong> l'Europe, <strong>et</strong> <strong>de</strong> là à la Méditerranée <strong>et</strong> à l'Atlantique, ainsi que la Méditerranée,<br />
à la mer du Nord (Fig. 32 ; Galil <strong>et</strong> al., 2007). Le mollusque Corbicula fluminea, originaire<br />
d'Asie <strong>et</strong> introduit en 1990 dans le port <strong>de</strong> Rotterdam, progresse actuellement vers l'Est<br />
par les voies d'eau <strong>et</strong> canaux d'Europe occi<strong>de</strong>ntale (Fig. 33 ; Galil <strong>et</strong> al., 2007). Au total, le<br />
réseau <strong>de</strong> canaux en Europe représente 28 000 km <strong>et</strong> quatre grands corridors : le corridor du<br />
Nord, le Corridor central, le corridor du Sud <strong>et</strong> le corridor <strong>de</strong> l'Ouest (Fig. 32 ; Galil <strong>et</strong> al.,<br />
2007). Le nombre d'espèces qui ont emprunté ce réseau en Europe est estimé à 65 (Galil <strong>et</strong> al.,<br />
2007).<br />
53