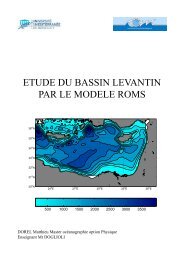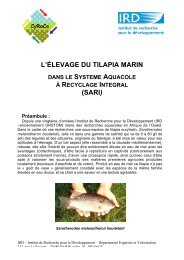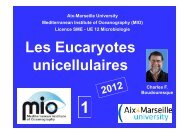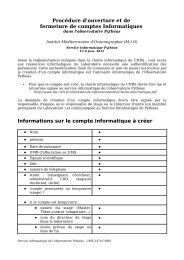invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
10. Les conséquences culturelles <strong>de</strong>s introductions d'espèces<br />
Les introductions d'espèces ont longtemps constitué un élément culturel : l'homme, dans ses<br />
migrations, a cherché à recréer autour <strong>de</strong> lui le paysage qui lui était familier dans sa terre<br />
d'origine (Bright, 1998). Introduire dans le mon<strong>de</strong> entier les espèces européennes (forcément<br />
‘supérieures’) a constitué un corollaire <strong>de</strong> la supériorité <strong>de</strong> la civilisation européenne (Crosby,<br />
1986). Par la suite, au 19 ième siècle, se sont développées en Europe <strong>de</strong>s ‘Sociétés d'Acclimatation’<br />
dont l'objectif était inverse : introduire en Europe <strong>et</strong> aux USA le meilleur <strong>de</strong>s espèces<br />
exotiques. Ce comportement fait référence à un sentiment <strong>de</strong> supériorité <strong>de</strong> l'homme sur la<br />
nature : l'améliorer, lui imprimer sa marque indélébile. Acclimater une espèce exotique <strong>de</strong>venait<br />
une marque <strong>de</strong> civisme (Bright, 1998). En France, Geoffroy <strong>de</strong> Saint-Hilaire a ainsi<br />
créé la ‘Société Impériale Zoologique d'Acclimatation’ en 1854 ; en Gran<strong>de</strong> Br<strong>et</strong>agne, la ‘Soci<strong>et</strong>y<br />
for the Acclimatization of Animals, Birds, Fishes, Insects and veg<strong>et</strong>ables within the United<br />
Kingdom’ a été créée en 1860 ; dans la secon<strong>de</strong> moitié du 19 ième siècle, ce type <strong>de</strong> sociétés<br />
s'est multiplié à travers le mon<strong>de</strong> (Lefeuvre, 2004 ; Planhol, 2004 ; Fag<strong>et</strong>, 2007).<br />
Les conséquences culturelles <strong>de</strong>s introductions d'espèces font référence à l'extermination <strong>de</strong><br />
certaines populations humaines (<strong>et</strong> <strong>de</strong> leurs cultures) par <strong>de</strong>s maladies introduites (rougeole,<br />
variole), ainsi qu'à la dimension éthique <strong>de</strong>s introductions d'espèces <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'érosion <strong>de</strong> la biodiversité<br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong> l'écodiversité qui peut en découler.<br />
Les espèces, les écosystèmes, les paysages <strong>et</strong> leur diversité font partie du patrimoine <strong>de</strong> l'humanité<br />
; ce patrimoine nous a été légué par les générations antérieures, <strong>et</strong> bien sûr par l'évolution,<br />
<strong>et</strong> nous <strong>de</strong>vons le léguer aux générations futures. Nous <strong>de</strong>vons donc préserver ce patrimoine<br />
biologique au même titre que Lascaux <strong>et</strong> Altamira, l'Alhambra <strong>de</strong> Granada <strong>et</strong> Nôtre-<br />
Dame <strong>de</strong> Paris, un tableau <strong>de</strong> Goya ou la Neuvième Symphonie <strong>de</strong> Be<strong>et</strong>hoven.<br />
Dans le cas <strong>de</strong>s espèces introduites, le risque <strong>de</strong> banalisation mondiale <strong>de</strong>s paysages, pour<br />
une latitu<strong>de</strong> <strong>et</strong> un climat donné, est également un problème éthique : voulons-nous une forêt<br />
d'eucalyptus à la place <strong>de</strong>s sansouires <strong>de</strong> Camargue, <strong>de</strong>s garrigues à romarin ou <strong>de</strong> la forêt <strong>de</strong><br />
hêtre <strong>de</strong> la Sainte-Baume ? Voulons-nous une prairie à Caulerpa taxifolia à la place <strong>de</strong>s herbiers<br />
à Posidonia oceanica, <strong>de</strong>s peuplements à Cystoseira <strong>et</strong> <strong>de</strong>s tombants à gorgones ? Voulons-nous<br />
<strong>de</strong>s tours <strong>de</strong> béton, aluminium <strong>et</strong> verre à la place du Barrio Gótico <strong>de</strong> Barcelone, <strong>de</strong><br />
la Plaza Mayor <strong>de</strong> Madrid <strong>et</strong> du forum <strong>de</strong> Rome ? (<strong>et</strong> ceci indépendamment <strong>de</strong> la valeur présente<br />
ou future, pour le tourisme, <strong>de</strong> ces quartiers ou <strong>de</strong> ces monuments).<br />
Outre la banalisation, il convient <strong>de</strong> se poser la question <strong>de</strong> l'artificialisation <strong>de</strong>s paysages.<br />
Dans <strong>de</strong> nombreuses régions du mon<strong>de</strong>, la plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s paysages sont déjà artificialisés,<br />
soit par l'agriculture, soit par les espèces introduites. En Nouvelle-Zélan<strong>de</strong>, par<br />
exemple, les 2/3 du territoire terrestre sont occupés par <strong>de</strong>s magnoliophytes introduites<br />
(Bright, 1998). Nous ne savons pas quelles seront les conséquences psychologiques, <strong>et</strong> donc<br />
culturelles, d'un mon<strong>de</strong> dont tout paysage naturel aurait disparu (Bright, 1998).<br />
‘L'homme a assez <strong>de</strong> raisons objectives pour s'attacher à la sauvegar<strong>de</strong> du mon<strong>de</strong> sauvage. Mais la<br />
nature ne sera en définitive sauvée que par notre cœur’.<br />
Jean Dorst<br />
156