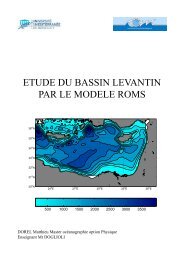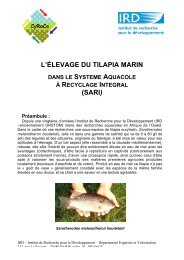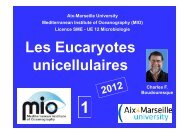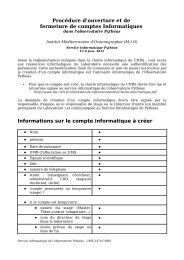invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
la diversité spécifique élevée <strong>et</strong> la complexité du réseau trophique favorisaient la stabilité d’un<br />
écosystème, <strong>et</strong> donc sa résistance aux introductions d’espèces <strong>et</strong> aux <strong>invasions</strong>. Inversement,<br />
les perturbations accroitraient la susceptibilité <strong>de</strong> l’écosystème aux introductions (‘introductibilité’<br />
<strong>et</strong> aux <strong>invasions</strong> (‘invasibilité’). C<strong>et</strong> ensemble conceptuel a été nommé Ecological Resistance<br />
Theory (ERT). Ces idées étaient en accord avec la vision idylique <strong>et</strong> plus ou moins<br />
‘biblique’ <strong>de</strong> l’écologie à l’époque d’Elton ; les communautés y étaient perçues comme un<br />
analogue <strong>de</strong>s sociétés humaines, avec la division du travail, <strong>de</strong>s niches écologiques bien séparées,<br />
<strong>et</strong>c. ; la communauté idéale était stable <strong>et</strong> ‘en équilibre’. Les concepts, en écologie, ont<br />
beaucoup changé, <strong>et</strong> l’ERT sera analysée, ci-<strong>de</strong>ssous, <strong>de</strong> façon critique (Richardson <strong>et</strong> Pyšek,<br />
2007 ; Boudouresque <strong>et</strong> Verlaque, 2012).<br />
5.3.1. La faible biodiversité, facteur <strong>de</strong> succès <strong>de</strong>s <strong>invasions</strong> ?<br />
La faible biodiversité du milieu récepteur a été traditionnellement considérée comme favorisant<br />
le succès <strong>de</strong>s introductions, dans le cadre <strong>de</strong> l’ERT (Elton, 1958) ; les ports <strong>et</strong> les lagunes<br />
littorales, milieux où la diversité spécifique est relativement faible, constitueraient donc <strong>de</strong>s<br />
milieux favorables aux introductions 76 (Tabl. VII <strong>et</strong> VIII; Ribera <strong>et</strong> Boudouresque, 1995 ;<br />
GESAMP, 1997 ; Boudouresque, 1999a ; Reise, 1999 ; Wolff, 1999 ; Occhipinti Ambrogi,<br />
2000a ; Minchin <strong>et</strong> Eno, 2002 ; Occhipinti <strong>et</strong> Savini, 2003). Le succès <strong>de</strong> Codium fragile en<br />
Nouvelle Ecosse <strong>et</strong> en Nouvelle Angl<strong>et</strong>erre, où l'espèce connaît un très grand développement,<br />
alors qu'elle est discrète <strong>de</strong> l'autre côté <strong>de</strong> l'Atlantique, en Europe, pourrait être dû au fait que<br />
la diversité spécifique y est 3 fois plus faible que le long <strong>de</strong>s côtes d'Europe ; en outre, le<br />
genre Codium n’y est représenté par aucune espèce indigène, contre cinq en Europe (Chapman,<br />
1999). En Méditerranée orientale, la diversité spécifique relativement faible qui caractérise<br />
ce bassin (par rapport à la Méditerranée occi<strong>de</strong>ntale) pourrait constituer une explication<br />
au succès <strong>de</strong>s espèces lessepsiennes (Boudouresque, 1999b). De même, en région tropicale, la<br />
diversité spécifique plus faible à Hawaiï (en raison <strong>de</strong> son isolement) qu'en Australie du Nord<br />
pourrait expliquer que les introductions sont nombreuses à Hawaiï alors que l'Australie du<br />
Nord semble relativement résistante aux <strong>invasions</strong> <strong>biologiques</strong> (Hutchings <strong>et</strong> al., 2002).<br />
Tableau VII. Pourcentage d'espèces introduites dans les eaux saumâtres <strong>de</strong>s Pays-Bas. D'après Wolff (1999).<br />
Nombre total d'espèces Nombre d'espèces introduites %<br />
Eaux saumâtres peu salées 80 16 20%<br />
Eaux saumâtres salées 250 14 6%<br />
De même, dans le domaine continental, le succès <strong>de</strong>s espèces introduites dans les milieux<br />
insulaires pourrait être lié à leur mo<strong>de</strong>ste diversité spécifique. Aux îles <strong>de</strong> la Société (Polynésie<br />
française), où l'on connaît 623 espèces <strong>de</strong> magnoliophytes indigènes (dont 273 endémiques),<br />
80 espèces ont été apportées anciennement par les polynésiens <strong>et</strong> 1 500 espèces par<br />
les européens. Parmi celles qui se sont naturalisées, Cypreus rotundus, Lanthana camara,<br />
Mimosa invisa, Rubus rosifolius, Psidium cattleianum, P. gnajava, Merremia peltata <strong>et</strong> surtout<br />
Micomia calvescens (voir plus loin) sont considérées comme <strong>de</strong>s ‘pestes’, c'est-à-dire <strong>de</strong>s<br />
espèces invasives (Meyer, 1996). La relation entre succès <strong>de</strong>s introductions <strong>et</strong> faible biodiversité<br />
a été confirmée expérimentalement, dans le cas d'une communauté <strong>de</strong> micro-organismes,<br />
76 Les perturbations <strong>et</strong> stress qui caractérisent ou peuvent caractériser ces milieux peuvent également jouer un<br />
rôle : voir plus loin (§ 5.3.5).<br />
63