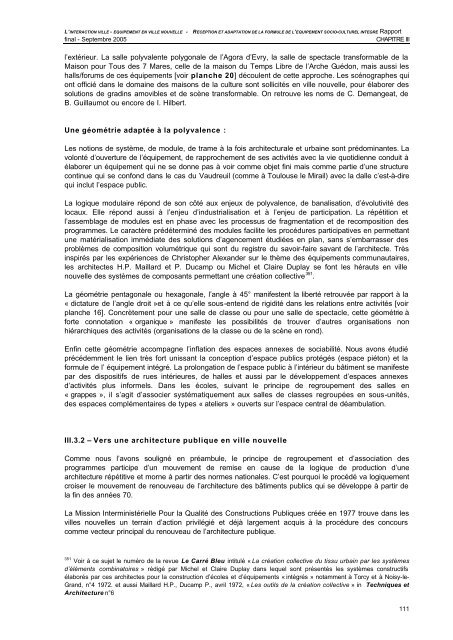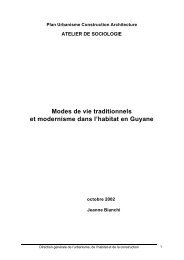L’INTERACTION VILLE - EQUIPEMENT EN VILLE NOUVELLE - RECEPTION ET ADAPTATION DE LA FORMULE DE L’EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL INTEGRE Rapportfinal - Septembre 2005CHAPITRE IIILe principe initial d’implication systématique d’un programme scolaire, collège ou école, dans lesopérations intégrées associe au départ étroitem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>ville</strong> <strong>nouvelle</strong> les <strong>de</strong>ux <strong>en</strong>jeux expérim<strong>en</strong>taux, celui<strong>de</strong> l’école et celui <strong>de</strong> l’éducation populaire (sous ses appellations d’éducation perman<strong>en</strong>te ou d’animationsocioculturelle).En fait la plupart <strong>de</strong>s <strong>ville</strong>s <strong>nouvelle</strong>s (Marne-la-Vallée, Cergy, l’Isle d’Abeau, etc.) ont investil’équipem<strong>en</strong>t scolaire comme étant le domaine d’action privilégié dans lequel sont développées unepolitique dérogatoire et une politique <strong>de</strong> promotion d’une architecture publique <strong>de</strong> qualité. L‘équipem<strong>en</strong>tintégré ne constitue <strong>de</strong> ce point <strong>de</strong> vue qu’une petite partie <strong>de</strong> cet aspect très important <strong>de</strong> la production<strong>de</strong> formes <strong>en</strong> <strong>ville</strong> <strong>nouvelle</strong>. L’expérim<strong>en</strong>tation et le développem<strong>en</strong>t d’une politique spécifique tant dans ledomaine <strong>de</strong> la pédagogie que dans celui <strong>de</strong> l’architecture scolaire pr<strong>en</strong>dront du reste assez rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>tleur autonomie par rapport au domaine socioculturel.Que ce soit sur l’architecture <strong>de</strong>s collèges ou sur celle <strong>de</strong>s écoles, on assiste après 68 à une véritableinflation <strong>de</strong> recherches tous azimuts. On ne compte plus les numéros <strong>de</strong> revue, les projets théoriquesconsacrés aux solutions ouvertes, flui<strong>de</strong>s, évolutives à même d’apporter un cadre adapté au nouveaucrédo éducatif.Le numéro <strong>de</strong> la revue AMC consacré <strong>en</strong> 1972 aux « Espaces collectifs <strong>de</strong>s <strong>en</strong>fants » s’inscrittotalem<strong>en</strong>t dans cette perspective. L’ouverture <strong>de</strong> l’école est au c<strong>en</strong>tre <strong>de</strong>s réflexions, ouverture intérieureavec la « pédagogie décloisonnée » et ouverture sur l’extérieur.Ce numéro <strong>de</strong> AMC r<strong>en</strong>d compte du congrès du cinquant<strong>en</strong>aire <strong>de</strong> l’Association <strong>de</strong>s Institutricesd’Ecoles Maternelles et <strong>de</strong> Classes Enfantines Publiques <strong>en</strong> 1970 (dit « congrès <strong>de</strong> Vichy ») quiconstitue un <strong>de</strong>s mom<strong>en</strong>ts forts <strong>de</strong> cette effervesc<strong>en</strong>ce autour du thème <strong>de</strong> l’ouverture <strong>de</strong> l’école. A cetteoccasion l’association avait lancé un concours d’architecture national pour la conception d’un <strong>en</strong>semblematernelle/crèche.Le même numéro <strong>de</strong> AMC prés<strong>en</strong>te par ailleurs plusieurs projets architecturaux <strong>de</strong> c<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>fance,étudiés par <strong>de</strong>s équipes pluridisciplinaires associant architectes et pédagogues, <strong>en</strong> particulier, celuiétabli pour le compte <strong>de</strong> Françoise L<strong>en</strong>oble-Prédiné dont nous avons précé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t parlé. Lesarchitectes du projet (Girard, Pastrana) se sont adjoints les services <strong>de</strong> Jean Prouvé (qui a pu poursuivreainsi son intérêt pour l’architecture scolaire et socio-éducative) pour élaborer un prototype préfabriqué quidécline les thèmes chers à l’architecture industrielle, le thème du module, le thème du continuum spatialpartitionné par <strong>de</strong>s cloisons légères [voir planche 18]. L’équipem<strong>en</strong>t intégré <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t le royaume <strong>de</strong>s« coins », justifié par une psychologie <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>fant et pas les ori<strong>en</strong>tations pédagogiques qui s’y rapport<strong>en</strong>t:« la continuité (…) dans le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>fant doit conduire à organiser ses activités dans unecontinuité matérielle et spatiale qui lui permette à tout mom<strong>en</strong>t un choix correspondant à son niveau <strong>de</strong>développem<strong>en</strong>t. C’est pourquoi le parti architectural s’est ori<strong>en</strong>té vers la définition d’un espace continu,au sein duquel les <strong>en</strong>fants seuls ou <strong>en</strong> groupe, peuv<strong>en</strong>t passer d’une façon très flui<strong>de</strong> et simultanéed’une activité à l’autre » 349 .De façon plus limitée que l’école mais néanmoins bi<strong>en</strong> effective, la salle <strong>de</strong> spectacle constitue lesecond tropisme architectural <strong>de</strong> l’équipem<strong>en</strong>t socioculturel <strong>en</strong> <strong>ville</strong> <strong>nouvelle</strong>.Que ce soit sous la forme d’une gran<strong>de</strong> machine mobile (sous l’influ<strong>en</strong>ce du théâtre révolutionnaire russeet allemand 350 ) ou sous la forme d’une scène rudim<strong>en</strong>taire développée par une certaine tradition théâtralefrançaise (celle <strong>de</strong> Copeau et <strong>de</strong> Vilar), la salle <strong>de</strong> spectacle populaire <strong>en</strong> rupture avec « le théâtrebourgeois à l’itali<strong>en</strong>ne » constitue une autre figure incontournable <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rnité qu’ont développé<strong>de</strong>puis les années 20 les héros français <strong>de</strong> l’architecture.Dans la continuité <strong>de</strong>s solutions imaginées pour les maisons <strong>de</strong> la culture ou pour les MJC, leséquipem<strong>en</strong>ts intégrés <strong>en</strong> <strong>ville</strong> <strong>nouvelle</strong> accueill<strong>en</strong>t ces salles <strong>de</strong> spectacle et autres dispositifs <strong>de</strong> gradinsmarqués, <strong>de</strong> même que l’école, par <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> polyval<strong>en</strong>ce, d’ouverture, d’interaction avecdans les années soixante par Jean Prouvé au Conservatoire National <strong>de</strong>s Arts et Métier manifest<strong>en</strong>t cet attachem<strong>en</strong>t:“ L’école ne <strong>de</strong>vrait-elle pas révéler aux <strong>en</strong>fants l’architecture <strong>de</strong> leur temps plutôt que celle du passé honteusem<strong>en</strong>tplagié ? ” in Prouvé - cours du CNAM - 1957-1970 ; “ essai <strong>de</strong> reconstitution du cours à partir <strong>de</strong>s archives <strong>de</strong> J.Prouvé. ” Liège, ed. Mardaga, 1990, p178.349 Dominique Girard, Marina Pastrana, Raoul Pastrana et Daniel Bourdon, notice du prototype <strong>de</strong> C<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> la Petite Enfancein AMC, « Espaces collectifs <strong>de</strong>s <strong>en</strong>fants », n°26, juin 1972350 “ J’avais imaginé une sorte <strong>de</strong> machine théâtrale, parfaitem<strong>en</strong>t ag<strong>en</strong>cée comme une machine à écrire, un appareil muni<strong>de</strong>s procédés les plus mo<strong>de</strong>rnes d’éclairage, <strong>de</strong> translation ou <strong>de</strong> rotations horizontale et verticale avec d’innombrablescabines <strong>de</strong> projection, <strong>de</strong>s installations <strong>de</strong> haut-parleurs etc. ” in Erwin Picastor, Le Théâtre politique. Paris, ed. L’Arche,1962 (1 ère ed 1929), p119.110
L’INTERACTION VILLE - EQUIPEMENT EN VILLE NOUVELLE - RECEPTION ET ADAPTATION DE LA FORMULE DE L’EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL INTEGRE Rapportfinal - Septembre 2005CHAPITRE IIIl’extérieur. La salle polyval<strong>en</strong>te polygonale <strong>de</strong> l’Agora d’Evry, la salle <strong>de</strong> spectacle transformable <strong>de</strong> laMaison pour Tous <strong>de</strong>s 7 Mares, celle <strong>de</strong> la maison du Temps Libre <strong>de</strong> l’Arche Guédon, mais aussi leshalls/forums <strong>de</strong> ces équipem<strong>en</strong>ts [voir planche 20] découl<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cette approche. Les scénographes quiont officié dans le domaine <strong>de</strong>s maisons <strong>de</strong> la culture sont sollicités <strong>en</strong> <strong>ville</strong> <strong>nouvelle</strong>, pour élaborer <strong>de</strong>ssolutions <strong>de</strong> gradins amovibles et <strong>de</strong> scène transformable. On retrouve les noms <strong>de</strong> C. Demangeat, <strong>de</strong>B. Guillaumot ou <strong>en</strong>core <strong>de</strong> I. Hilbert.Une géométrie adaptée à la polyval<strong>en</strong>ce :Les notions <strong>de</strong> système, <strong>de</strong> module, <strong>de</strong> trame à la fois architecturale et urbaine sont prédominantes. Lavolonté d’ouverture <strong>de</strong> l’équipem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> rapprochem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> ses activités avec la vie quotidi<strong>en</strong>ne conduit àélaborer un équipem<strong>en</strong>t qui ne se donne pas à voir comme objet fini mais comme partie d’une structurecontinue qui se confond dans le cas du Vaudreuil (comme à Toulouse le Mirail) avec la dalle c’est-à-direqui inclut l’espace public.La logique modulaire répond <strong>de</strong> son côté aux <strong>en</strong>jeux <strong>de</strong> polyval<strong>en</strong>ce, <strong>de</strong> banalisation, d’évolutivité <strong>de</strong>slocaux. Elle répond aussi à l’<strong>en</strong>jeu d’industrialisation et à l’<strong>en</strong>jeu <strong>de</strong> participation. La répétition etl’assemblage <strong>de</strong> modules est <strong>en</strong> phase avec les processus <strong>de</strong> fragm<strong>en</strong>tation et <strong>de</strong> recomposition <strong>de</strong>sprogrammes. Le caractère prédéterminé <strong>de</strong>s modules facilite les procédures participatives <strong>en</strong> permettantune matérialisation immédiate <strong>de</strong>s solutions d’ag<strong>en</strong>cem<strong>en</strong>t étudiées <strong>en</strong> plan, sans s’embarrasser <strong>de</strong>sproblèmes <strong>de</strong> composition volumétrique qui sont du registre du savoir-faire savant <strong>de</strong> l’architecte. Trèsinspirés par les expéri<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> Christopher Alexan<strong>de</strong>r sur le thème <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts communautaires,les architectes H.P. Maillard et P. Ducamp ou Michel et Claire Duplay se font les hérauts <strong>en</strong> <strong>ville</strong><strong>nouvelle</strong> <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> composants permettant une création collective 351 .La géométrie p<strong>en</strong>tagonale ou hexagonale, l’angle à 45° manifest<strong>en</strong>t la liberté retrouvée par rapport à la« dictature <strong>de</strong> l’angle droit »et à ce qu’elle sous-<strong>en</strong>t<strong>en</strong>d <strong>de</strong> rigidité dans les relations <strong>en</strong>tre activités [voirplanche 16]. Concrètem<strong>en</strong>t pour une salle <strong>de</strong> classe ou pour une salle <strong>de</strong> spectacle, cette géométrie àforte connotation « organique » manifeste les possibilités <strong>de</strong> trouver d’autres organisations nonhiérarchiques <strong>de</strong>s activités (organisations <strong>de</strong> la classe ou <strong>de</strong> la scène <strong>en</strong> rond).Enfin cette géométrie accompagne l’inflation <strong>de</strong>s espaces annexes <strong>de</strong> sociabilité. Nous avons étudiéprécé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t le li<strong>en</strong> très fort unissant la conception d’espace publics protégés (espace piéton) et laformule <strong>de</strong> l’ équipem<strong>en</strong>t intégré. La prolongation <strong>de</strong> l’espace public à l’intérieur du bâtim<strong>en</strong>t se manifestepar <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> rues intérieures, <strong>de</strong> halles et aussi par le développem<strong>en</strong>t d’espaces annexesd’activités plus informels. Dans les écoles, suivant le principe <strong>de</strong> regroupem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s salles <strong>en</strong>« grappes », il s’agit d’associer systématiquem<strong>en</strong>t aux salles <strong>de</strong> classes regroupées <strong>en</strong> sous-unités,<strong>de</strong>s espaces complém<strong>en</strong>taires <strong>de</strong> types « ateliers » ouverts sur l’espace c<strong>en</strong>tral <strong>de</strong> déambulation.III.3.2 – Vers une architecture publique <strong>en</strong> <strong>ville</strong> <strong>nouvelle</strong>Comme nous l’avons souligné <strong>en</strong> préambule, le principe <strong>de</strong> regroupem<strong>en</strong>t et d’association <strong>de</strong>sprogrammes participe d’un mouvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> remise <strong>en</strong> cause <strong>de</strong> la logique <strong>de</strong> production d’unearchitecture répétitive et morne à partir <strong>de</strong>s normes nationales. C’est pourquoi le procédé va logiquem<strong>en</strong>tcroiser le mouvem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> r<strong>en</strong>ouveau <strong>de</strong> l’architecture <strong>de</strong>s bâtim<strong>en</strong>ts publics qui se développe à partir <strong>de</strong>la fin <strong>de</strong>s années 70.La Mission Interministérielle Pour la Qualité <strong>de</strong>s Constructions Publiques créée <strong>en</strong> 1977 trouve dans les<strong>ville</strong>s <strong>nouvelle</strong>s un terrain d’action privilégié et déjà largem<strong>en</strong>t acquis à la procédure <strong>de</strong>s concourscomme vecteur principal du r<strong>en</strong>ouveau <strong>de</strong> l’architecture publique.351 Voir à ce sujet le numéro <strong>de</strong> la revue Le Carré Bleu intitulé « La création collective du tissu urbain par les systèmesd’élém<strong>en</strong>ts combinatoires » rédigé par Michel et Claire Duplay dans lequel sont prés<strong>en</strong>tés les systèmes constructifsélaborés par ces architectes pour la construction d’écoles et d’équipem<strong>en</strong>ts « intégrés » notamm<strong>en</strong>t à Torcy et à Noisy-le-Grand, n°4 1972. et aussi Maillard H.P., Ducamp P., avril 1972, « Les outils <strong>de</strong> la création collective » in Techniques etArchitecture n°6111