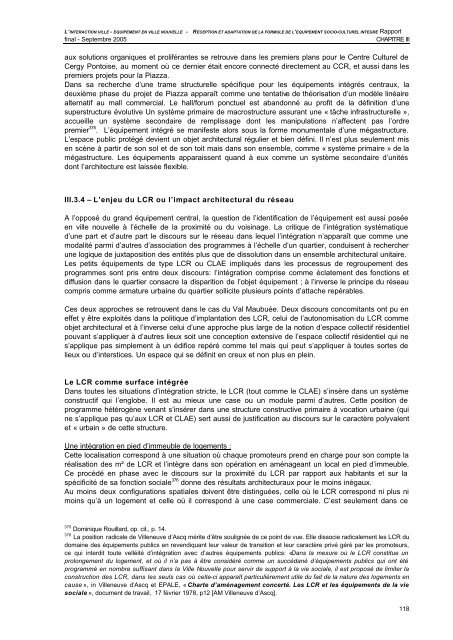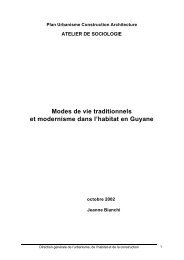l'interaction ville - equipement en ville nouvelle - Centre de ...
l'interaction ville - equipement en ville nouvelle - Centre de ...
l'interaction ville - equipement en ville nouvelle - Centre de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’INTERACTION VILLE - EQUIPEMENT EN VILLE NOUVELLE - RECEPTION ET ADAPTATION DE LA FORMULE DE L’EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL INTEGRE Rapportfinal - Septembre 2005CHAPITRE IIIaux solutions organiques et proliférantes se retrouve dans les premiers plans pour le C<strong>en</strong>tre Culturel <strong>de</strong>Cergy Pontoise, au mom<strong>en</strong>t où ce <strong>de</strong>rnier était <strong>en</strong>core connecté directem<strong>en</strong>t au CCR, et aussi dans lespremiers projets pour la Piazza.Dans sa recherche d’une trame structurelle spécifique pour les équipem<strong>en</strong>ts intégrés c<strong>en</strong>traux, la<strong>de</strong>uxième phase du projet <strong>de</strong> Piazza apparaît comme une t<strong>en</strong>tative <strong>de</strong> théorisation d’un modèle linéairealternatif au mall commercial. Le hall/forum ponctuel est abandonné au profit <strong>de</strong> la définition d’unesuperstructure évolutive Un système primaire <strong>de</strong> macrostructure assurant une « tâche infrastructurelle »,accueille un système secondaire <strong>de</strong> remplissage dont les manipulations n’affect<strong>en</strong>t pas l’ordrepremier 375 . L’équipem<strong>en</strong>t intégré se manifeste alors sous la forme monum<strong>en</strong>tale d’une mégastructure.L’espace public protégé <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t un objet architectural régulier et bi<strong>en</strong> défini. Il n’est plus seulem<strong>en</strong>t mis<strong>en</strong> scène à partir <strong>de</strong> son sol et <strong>de</strong> son toit mais dans son <strong>en</strong>semble, comme « système primaire » <strong>de</strong> lamégastructure. Les équipem<strong>en</strong>ts apparaiss<strong>en</strong>t quand à eux comme un système secondaire d’unitésdont l’architecture est laissée flexible.III.3.4 – L’<strong>en</strong>jeu du LCR ou l’impact architectural du réseauA l’opposé du grand équipem<strong>en</strong>t c<strong>en</strong>tral, la question <strong>de</strong> l’id<strong>en</strong>tification <strong>de</strong> l’équipem<strong>en</strong>t est aussi posée<strong>en</strong> <strong>ville</strong> <strong>nouvelle</strong> à l’échelle <strong>de</strong> la proximité ou du voisinage. La critique <strong>de</strong> l’intégration systématiqued’une part et d’autre part le discours sur le réseau dans lequel l’intégration n’apparaît que comme unemodalité parmi d’autres d’association <strong>de</strong>s programmes à l’échelle d’un quartier, conduis<strong>en</strong>t à rechercherune logique <strong>de</strong> juxtaposition <strong>de</strong>s <strong>en</strong>tités plus que <strong>de</strong> dissolution dans un <strong>en</strong>semble architectural unitaire.Les petits équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> type LCR ou CLAE impliqués dans les processus <strong>de</strong> regroupem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>sprogrammes sont pris <strong>en</strong>tre <strong>de</strong>ux discours: l’intégration comprise comme éclatem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s fonctions etdiffusion dans le quartier consacre la disparition <strong>de</strong> l’objet équipem<strong>en</strong>t ; à l’inverse le principe du réseaucompris comme armature urbaine du quartier sollicite plusieurs points d’attache repérables.Ces <strong>de</strong>ux approches se retrouv<strong>en</strong>t dans le cas du Val Maubuée. Deux discours concomitants ont pu <strong>en</strong>effet y être exploités dans la politique d’implantation <strong>de</strong>s LCR, celui <strong>de</strong> l’autonomisation du LCR commeobjet architectural et à l’inverse celui d’une approche plus large <strong>de</strong> la notion d’espace collectif résid<strong>en</strong>tielpouvant s’appliquer à d’autres lieux soit une conception ext<strong>en</strong>sive <strong>de</strong> l’espace collectif résid<strong>en</strong>tiel qui nes’applique pas simplem<strong>en</strong>t à un édifice repéré comme tel mais qui peut s’appliquer à toutes sortes <strong>de</strong>lieux ou d’interstices. Un espace qui se définit <strong>en</strong> creux et non plus <strong>en</strong> plein.Le LCR comme surface intégréeDans toutes les situations d’intégration stricte, le LCR (tout comme le CLAE) s’insère dans un systèmeconstructif qui l’<strong>en</strong>globe. Il est au mieux une case ou un module parmi d’autres. Cette position <strong>de</strong>programme hétérogène v<strong>en</strong>ant s’insérer dans une structure constructive primaire à vocation urbaine (quine s’applique pas qu’aux LCR et CLAE) sert aussi <strong>de</strong> justification au discours sur le caractère polyval<strong>en</strong>tet « urbain » <strong>de</strong> cette structure.Une intégration <strong>en</strong> pied d’immeuble <strong>de</strong> logem<strong>en</strong>ts :Cette localisation correspond à une situation où chaque promoteurs pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> charge pour son compte laréalisation <strong>de</strong>s m² <strong>de</strong> LCR et l’intègre dans son opération <strong>en</strong> aménageant un local <strong>en</strong> pied d’immeuble.Ce procédé <strong>en</strong> phase avec le discours sur la proximité du LCR par rapport aux habitants et sur laspécificité <strong>de</strong> sa fonction sociale 376 donne <strong>de</strong>s résultats architecturaux pour le moins inégaux.Au moins <strong>de</strong>ux configurations spatiales doiv<strong>en</strong>t être distinguées, celle où le LCR correspond ni plus nimoins qu’à un logem<strong>en</strong>t et celle où il correspond à une case commerciale. C’est seulem<strong>en</strong>t dans ce375 Dominique Rouillard, op. cit., p. 14.376 La position radicale <strong>de</strong> Vill<strong>en</strong>euve d’Ascq mérite d’être soulignée <strong>de</strong> ce point <strong>de</strong> vue. Elle dissocie radicalem<strong>en</strong>t les LCR dudomaine <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts publics <strong>en</strong> rev<strong>en</strong>diquant leur valeur <strong>de</strong> transition et leur caractère privé géré par les promoteurs,ce qui interdit toute velléité d’intégration avec d’autres équipem<strong>en</strong>ts publics: «Dans la mesure où le LCR constitue unprolongem<strong>en</strong>t du logem<strong>en</strong>t, et où il n’a pas à être considéré comme un succédané d’équipem<strong>en</strong>ts publics qui ont étéprogrammé <strong>en</strong> nombre suffisant dans la Ville Nouvelle pour servir <strong>de</strong> support à la vie sociale, il est proposé <strong>de</strong> limiter laconstruction <strong>de</strong>s LCR, dans les seuls cas où celle-ci apparaît particulièrem<strong>en</strong>t utile du fait <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong>s logem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong>cause », in Vill<strong>en</strong>euve d’Ascq et EPALE, « Charte d’aménagem<strong>en</strong>t concerté. Les LCR et les équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> la viesociale », docum<strong>en</strong>t <strong>de</strong> travail, 17 février 1978, p12 [AM Vill<strong>en</strong>euve d’Ascq].118