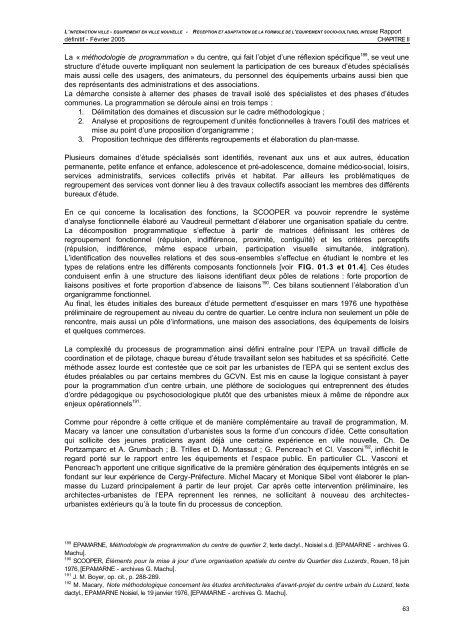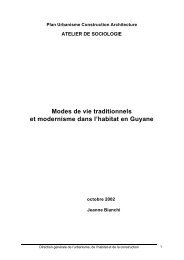l'interaction ville - equipement en ville nouvelle - Centre de ...
l'interaction ville - equipement en ville nouvelle - Centre de ...
l'interaction ville - equipement en ville nouvelle - Centre de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’INTERACTION VILLE - EQUIPEMENT EN VILLE NOUVELLE - RECEPTION ET ADAPTATION DE LA FORMULE DE L’EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL INTEGRE Rapportdéfinitif - Février 2005CHAPITRE IILa « méthodologie <strong>de</strong> programmation » du c<strong>en</strong>tre, qui fait l’objet d’une réflexion spécifique 189 , se veut unestructure d’étu<strong>de</strong> ouverte impliquant non seulem<strong>en</strong>t la participation <strong>de</strong> ces bureaux d’étu<strong>de</strong>s spécialisésmais aussi celle <strong>de</strong>s usagers, <strong>de</strong>s animateurs, du personnel <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts urbains aussi bi<strong>en</strong> que<strong>de</strong>s représ<strong>en</strong>tants <strong>de</strong>s administrations et <strong>de</strong>s associations.La démarche consiste à alterner <strong>de</strong>s phases <strong>de</strong> travail isolé <strong>de</strong>s spécialistes et <strong>de</strong>s phases d’étu<strong>de</strong>scommunes. La programmation se déroule ainsi <strong>en</strong> trois temps :1. Délimitation <strong>de</strong>s domaines et discussion sur le cadre méthodologique ;2. Analyse et propositions <strong>de</strong> regroupem<strong>en</strong>t d’unités fonctionnelles à travers l’outil <strong>de</strong>s matrices etmise au point d’une proposition d’organigramme ;3. Proposition technique <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts regroupem<strong>en</strong>ts et élaboration du plan-masse.Plusieurs domaines d’étu<strong>de</strong> spécialisés sont id<strong>en</strong>tifiés, rev<strong>en</strong>ant aux uns et aux autres, éducationperman<strong>en</strong>te, petite <strong>en</strong>fance et <strong>en</strong>fance, adolesc<strong>en</strong>ce et pré-adolesc<strong>en</strong>ce, domaine médico-social, loisirs,services administratifs, services collectifs privés et habitat. Par ailleurs les problématiques <strong>de</strong>regroupem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s services vont donner lieu à <strong>de</strong>s travaux collectifs associant les membres <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>tsbureaux d’étu<strong>de</strong>.En ce qui concerne la localisation <strong>de</strong>s fonctions, la SCOOPER va pouvoir repr<strong>en</strong>dre le systèmed’analyse fonctionnelle élaboré au Vaudreuil permettant d’élaborer une organisation spatiale du c<strong>en</strong>tre.La décomposition programmatique s’effectue à partir <strong>de</strong> matrices définissant les critères <strong>de</strong>regroupem<strong>en</strong>t fonctionnel (répulsion, indiffér<strong>en</strong>ce, proximité, contiguïté) et les critères perceptifs(répulsion, indiffér<strong>en</strong>ce, même espace urbain, participation visuelle simultanée, intégration).L’id<strong>en</strong>tification <strong>de</strong>s <strong>nouvelle</strong>s relations et <strong>de</strong>s sous-<strong>en</strong>sembles s’effectue <strong>en</strong> étudiant le nombre et lestypes <strong>de</strong> relations <strong>en</strong>tre les différ<strong>en</strong>ts composants fonctionnels [voir FIG. 01.3 et 01.4]. Ces étu<strong>de</strong>sconduis<strong>en</strong>t <strong>en</strong>fin à une structure <strong>de</strong>s liaisons id<strong>en</strong>tifiant <strong>de</strong>ux pôles <strong>de</strong> relations : forte proportion <strong>de</strong>liaisons positives et forte proportion d’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> liaisons 190 . Ces bilans souti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t l’élaboration d’unorganigramme fonctionnel.Au final, les étu<strong>de</strong>s initiales <strong>de</strong>s bureaux d’étu<strong>de</strong> permett<strong>en</strong>t d’esquisser <strong>en</strong> mars 1976 une hypothèsepréliminaire <strong>de</strong> regroupem<strong>en</strong>t au niveau du c<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> quartier. Le c<strong>en</strong>tre inclura non seulem<strong>en</strong>t un pôle <strong>de</strong>r<strong>en</strong>contre, mais aussi un pôle d’informations, une maison <strong>de</strong>s associations, <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> loisirset quelques commerces.La complexité du processus <strong>de</strong> programmation ainsi défini <strong>en</strong>traîne pour l’EPA un travail difficile <strong>de</strong>coordination et <strong>de</strong> pilotage, chaque bureau d’étu<strong>de</strong> travaillant selon ses habitu<strong>de</strong>s et sa spécificité. Cettemétho<strong>de</strong> assez lour<strong>de</strong> est contestée que ce soit par les urbanistes <strong>de</strong> l’EPA qui se s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t exclus <strong>de</strong>sétu<strong>de</strong>s préalables ou par certains membres du GCVN. Est mis <strong>en</strong> cause la logique consistant à payerpour la programmation d’un c<strong>en</strong>tre urbain, une pléthore <strong>de</strong> sociologues qui <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>sd’ordre pédagogique ou psychosociologique plutôt que <strong>de</strong>s urbanistes mieux à même <strong>de</strong> répondre aux<strong>en</strong>jeux opérationnels 191 .Comme pour répondre à cette critique et <strong>de</strong> manière complém<strong>en</strong>taire au travail <strong>de</strong> programmation, M.Macary va lancer une consultation d’urbanistes sous la forme d’un concours d’idée. Cette consultationqui sollicite <strong>de</strong>s jeunes pratici<strong>en</strong>s ayant déjà une certaine expéri<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> <strong>ville</strong> <strong>nouvelle</strong>, Ch. DePortzamparc et A. Grumbach ; B. Trilles et D. Montassut ; G. P<strong>en</strong>creac’h et Cl. Vasconi 192 , infléchit leregard porté sur le rapport <strong>en</strong>tre les équipem<strong>en</strong>ts et l’espace public. En particulier CL. Vasconi etP<strong>en</strong>creac’h apport<strong>en</strong>t une critique significative <strong>de</strong> la première génération <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts intégrés <strong>en</strong> sefondant sur leur expéri<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> Cergy-Préfecture. Michel Macary et Monique Sibel vont élaborer le planmassedu Luzard principalem<strong>en</strong>t à partir <strong>de</strong> leur projet. Car après cette interv<strong>en</strong>tion préliminaire, lesarchitectes-urbanistes <strong>de</strong> l’EPA repr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t les r<strong>en</strong>nes, ne sollicitant à nouveau <strong>de</strong>s architectesurbanistesextérieurs qu’à la toute fin du processus <strong>de</strong> conception.189 EPAMARNE, Méthodologie <strong>de</strong> programmation du c<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> quartier 2, texte dactyl., Noisiel s.d. [EPAMARNE - archives G.Machu].190 SCOOPER, Élém<strong>en</strong>ts pour la mise à jour d’une organisation spatiale du c<strong>en</strong>tre du Quartier <strong>de</strong>s Luzards, Rou<strong>en</strong>, 18 juin1976, [EPAMARNE - archives G. Machu].191 J. M. Boyer, op. cit., p. 288-289.192 M. Macary, Note méthodologique concernant les étu<strong>de</strong>s architecturales d’avant-projet du c<strong>en</strong>tre urbain du Luzard, textedactyl., EPAMARNE Noisiel, le 19 janvier 1976, [EPAMARNE - archives G. Machu].63