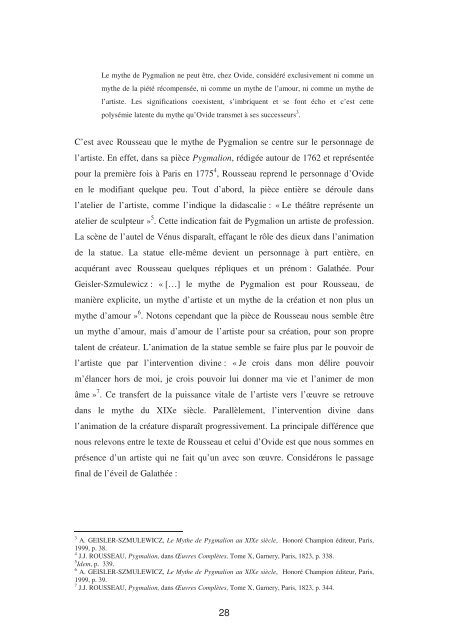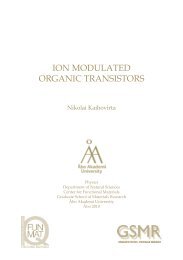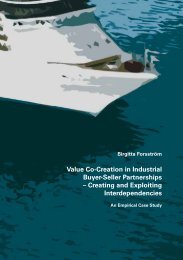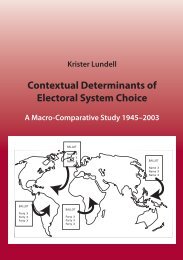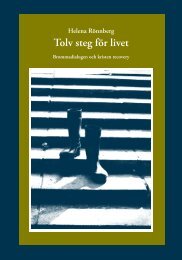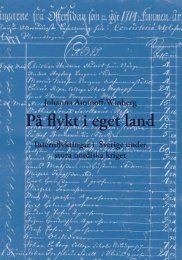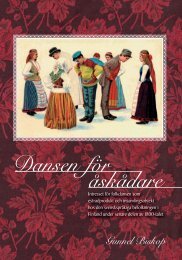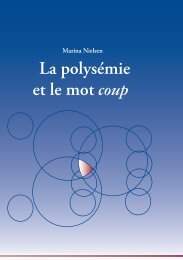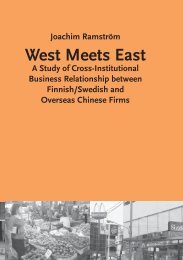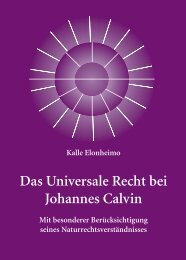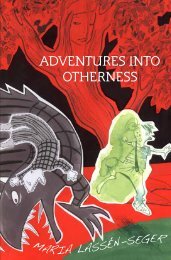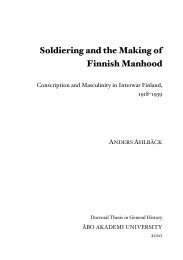- Page 7 and 8: AVANT-PROPOSJe tiens tout d’abord
- Page 9 and 10: TABLE DES MATIÈRESINTRODUCTION 1PA
- Page 11 and 12: 3. LA STRUCTURE 1143.1 Structure na
- Page 13 and 14: « L’histoire est un roman qui a
- Page 15 and 16: cependant être limité dans deux d
- Page 17 and 18: fiction: a critical essay » 8 , a
- Page 19 and 20: l’artiste semble bien correspondr
- Page 21 and 22: 1928, souligne le fait que « la ce
- Page 24 and 25: de clarté, dès que nous changeron
- Page 26 and 27: Avant de commencer l’étude de la
- Page 28 and 29: capable de surmonter ou de réconci
- Page 30 and 31: finira sa vie en exil à Bruxelles
- Page 32 and 33: 1850 variant entre 900 et 3000 fran
- Page 34 and 35: dont le nombre se multiplie de faç
- Page 36 and 37: Dès 1837, nous trouvons un poème
- Page 38 and 39: mythe, lui reconnaissant, comme à
- Page 42 and 43: au sens spirituel de l’humanité,
- Page 44 and 45: Le dix-neuvième siècle ne pas fai
- Page 46 and 47: vies exemplaires. Il semble qu’il
- Page 48 and 49: prudence, tempérant son imaginatio
- Page 50 and 51: XIXe siècle est donc un héritier
- Page 52 and 53: Philosophie et Art, écrit que la s
- Page 54 and 55: mundum 42 . Ce qui se traduit par u
- Page 56 and 57: par exemple le cas de Frenhofer ou
- Page 58 and 59: 2. SOURCES CONTEMPORAINESLes source
- Page 60 and 61: l’artiste est au bourgeois ce que
- Page 62 and 63: fiction. De même, Balzac utilise p
- Page 64 and 65: sur un texte fondateur, issu d’un
- Page 66 and 67: CHAPITRE IIILES INDICES DE L’OSSA
- Page 68 and 69: Remarquons tout d’abord la dualit
- Page 70 and 71: Passons maintenant en revue les dif
- Page 72 and 73: morcellement des sculptures donnent
- Page 74 and 75: idéales » 20 , trop réfléchi, t
- Page 76 and 77: lanche » (G216) ; un masque de sar
- Page 78 and 79: de prix de Rome » (G220). Nous tro
- Page 80 and 81: l’artiste. L’atelier d’Anatol
- Page 82 and 83: peintres de la nouvelle peinture, i
- Page 84 and 85: Ainsi le premier atelier de Claude
- Page 86 and 87: 1.1.6 Évolution de l’atelier mir
- Page 88 and 89: - Oh ! tout a été vendu quand nou
- Page 90 and 91:
Cette maison semble l’espace parf
- Page 92 and 93:
Langibout est « un immense atelier
- Page 94 and 95:
eaucoup de personnages au XIXe siè
- Page 96 and 97:
grand vivier de types humains pour
- Page 98 and 99:
1.2.2 Le voyage exotiqueL’intér
- Page 100 and 101:
est donc de copier l’art antique
- Page 102 and 103:
carrière et la technique de Claude
- Page 104 and 105:
Mais l’artiste gardait, de sa jeu
- Page 106 and 107:
coucher qu’avec son œuvre » (Z3
- Page 108 and 109:
epousses, […] et pour aimer quoi
- Page 110 and 111:
défauts, il n’atteint jamais la
- Page 112 and 113:
La première possibilité est que l
- Page 114 and 115:
Les enfants ratés sont donc un sym
- Page 116 and 117:
L’échec du peintre est la norme
- Page 118 and 119:
montagnes. Quitte ton lit de grand
- Page 120 and 121:
écurrent dans nos romans. La folie
- Page 122 and 123:
(ou maintiennent ou ferment) une al
- Page 124 and 125:
de Balzac, Frenhofer, ce public ave
- Page 126 and 127:
2.2.3 Les modèles et l’idéalZeu
- Page 128 and 129:
dans une foire. Chaîne n’emprunt
- Page 130 and 131:
3.3 Notre conception du mythe de l
- Page 132 and 133:
Dans notre première partie, nous a
- Page 134 and 135:
pauvreté et l’acharnement au tra
- Page 136 and 137:
l’enseignement de Frenhofer ne se
- Page 138 and 139:
écit mi-fantastique, mi-philosophi
- Page 140 and 141:
illants, pétillants, qui éclairai
- Page 142 and 143:
silhouette noire […] », « […]
- Page 144 and 145:
comme un masque chiffonné, se prê
- Page 146 and 147:
d’artiste. Comme Anatole est le p
- Page 148 and 149:
médical de l’artiste qui semble
- Page 150 and 151:
aux frontières de la folie, poussa
- Page 152 and 153:
à la nature et l’exactitude méd
- Page 154 and 155:
mythe de l’artiste, de l’idée
- Page 156 and 157:
2. LE PROCESSUS DE CRÉATION« La p
- Page 158 and 159:
des Muses […] » 57 . Diderot, qu
- Page 160 and 161:
le personnage de Porbus, le peintre
- Page 162 and 163:
sensibilité physique extrême de l
- Page 164 and 165:
imaginaire, le Pierrot pendu. Le Pi
- Page 166 and 167:
Puis, il attaqua la gorge, indiqué
- Page 168 and 169:
l’obsession de la création de la
- Page 170 and 171:
il ne peut plus le garder : il le v
- Page 172 and 173:
monde, le plus important. --- Puis
- Page 174 and 175:
nous est présenté. Ainsi, pour ce
- Page 176 and 177:
comme l’a souligné Ricatte 84 ,
- Page 178 and 179:
lumière vraie et du réel comme un
- Page 180 and 181:
CHAPITRE II :LA RELATION LITTÉRATU
- Page 182 and 183:
une surprotection de l’artiste pa
- Page 184 and 185:
eprésentant le drame de la créati
- Page 186 and 187:
artistes au sens large du terme, qu
- Page 188 and 189:
période, à cause ou grâce à la
- Page 190 and 191:
Nous voyons dans ces romans d’art
- Page 192 and 193:
proprement dite et intersémiotique
- Page 194 and 195:
Les romans d’art sont des œuvres
- Page 196 and 197:
L’emploi de la référence artist
- Page 198 and 199:
au marbre et au Louvre fait de Mane
- Page 200 and 201:
plus précisément ce à quoi aspir
- Page 202 and 203:
La composition est précise, les se
- Page 204 and 205:
Goncourt un système d’écriture.
- Page 206 and 207:
sur la gloire enflammée du couchan
- Page 208 and 209:
Les théories fondamentales sur l
- Page 210 and 211:
3.2 Rapprochement critique des aute
- Page 212 and 213:
paysage, la lumière et l’instant
- Page 214 and 215:
Ainsi, le peintre se transforme en
- Page 216 and 217:
plus précise possible, en analysan
- Page 218 and 219:
par les différents auteurs étudi
- Page 220 and 221:
ZOLA, EmileZOLA, EmileLe Ventre de
- Page 222 and 223:
BERSTEIN, Serge et MILZA, Pierre Hi
- Page 224 and 225:
GENETTE, GérardGENETTE, GérardFig
- Page 226 and 227:
RÜMANN, ArthurDas Illustrierte Buc
- Page 228 and 229:
DELAVEAU, Philippe « Eugène Delac
- Page 230 and 231:
nineteenth-century France, ORWICZ,
- Page 232 and 233:
ROUVERET, Agnès « De l’artisan
- Page 234 and 235:
INDEX DES AUTEURS ET ARTISTES RÉEL
- Page 236 and 237:
Giotto · 110, 111Girard · 5Girode
- Page 238 and 239:
Poussin · 11, 15, 34, 37, 48, 50,