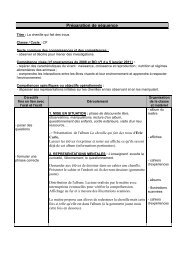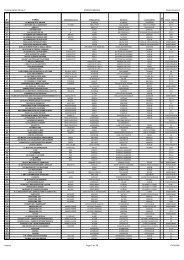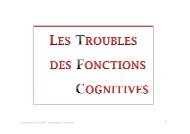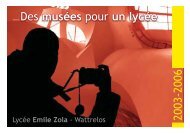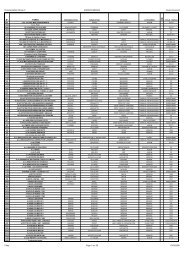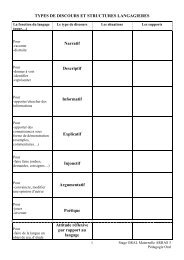Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
II – Exemples d’approches du programmeLe point de départ :cartes du monde actuelLa cohérence de l’enseignement conjoint del’histoire et la géographie est affirmée clairementdès le début du programme puisqu’il s’agit de« partir de cartes du monde actuel pour montrercomment l’histoire et la géographie peuventensemble aider à le comprendre ». Selon lesfinalités choisies par les enseignants, des planisphèressimples, présentant le « pavage » politiquedu monde, les contrastes de développement, lesorganisations régionales, etc., constituent unbon point de départ. La carte politique dumonde actuel est une première approche desproblèmes géopolitiques. Une carte descontrastes de l’indice de développement humaindans le monde met en évidence les phénomènesd’inégalités de développement et de p<strong>au</strong>vreté.Elle peut être confrontée à une carte des zonesde tensions et de conflits pour faire apparaître lesliens entre ces zones et les problèmes de développement.Une carte des puissances économiqueset des organisations régionales permetde souligner la place de premier plan de la triadeÉtats-Unis/Japon/Union européenne dans lemaillage économique du monde. Ce ne sont quedes exemples parmi d’<strong>au</strong>tres. Ces cartes doiventamener les élèves à se poser des questions :quelle est l’organisation du monde actuel ?Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses déséquilibres? Est-il construit par l’histoire ? Dans cemonde, quelle est la place de la France ?A. 1914-1945, guerres,démocratie et totalitarismeCette période est marquée par deux guerresmondiales et par la montée du totalitarisme dansle monde. Mais la démocratie résiste et, en 1945,le totalitarisme nazi est vaincu. Cette défaite estellepour <strong>au</strong>tant une victoire de la démocratie ?La présence de l’URSS stalinienne dans le campdes vainqueurs rend cette question pertinente,d’<strong>au</strong>tant plus que, bientôt, dans le cadre de leuraffrontement avec le monde communiste, lesÉtats-Unis n’hésitent pas à soutenir des dictatures.Les rapports entre guerre, démocratie ettotalitarisme sont donc bien le fil conducteur decette période.1. La Première Guerre mondialeet ses conséquencesOn doit renoncer <strong>au</strong> récit chronologique desphases du conflit et privilégier la mise en évidencede ses grandes caractéristiques : sonaspect total et la brutalisation des rapportshumains qu’il a impliquée. Cela permet de fairecomprendre, par delà les conséquences plusimmédiates de la guerre, étudiées dans sonbilan, sa résonance profonde et tr<strong>au</strong>matique surle siècle qui commence. La notion de brutalisation(mal traduite du terme anglais brutalizationque le néologisme « ens<strong>au</strong>vagement » <strong>au</strong>raitmieux fait comprendre) reflète la place fondatricede la violence liée à la guerre. Desrecherches récentes ont mis en évidence cetteviolence d’un conflit marqué par le premiergénocide du siècle, celui des Arméniens, et pendantlequel, pour la première fois en Europe,s’ouvrent des camps de concentration ; cettepratique, partagée par tous les belligérants pourles ressortissants de pays ennemis, atteint desgroupes entiers de population (tels ces Françaiset surtout ces Françaises de la région de Lille quiont été déportés en Prusse orientale). Si l’exterminationdes Juifs et des Tziganes n’est pas directementissue de la Première Guerre mondiale,certains des hommes qui ont vécu ce conflitdeviennent capables d’appliquer une haineexterminatrice : à deux reprises, en 1931 et en1939, Hitler invoque la déportation desArméniens pour justifier sa politique antisémite.Il f<strong>au</strong>t donc envisager le conflit dans son aspectfondateur d’une violence totale (totalitaire ?) quimarque le XX e siècle.2. L’URSS de StalineL’histoire chronologique « classique » de l’Unionsoviétique a montré ses limites. Comment est-onpassé de la grande espérance de 1917 à laconstruction d’un type de régime totalitaire ?C’est la question majeure qui centre l’étude surcette construction. Le choix de la collectivisationforcée et de la planification impérative (qui permetl’industrialisation du pays et de grandesmutations sociales et culturelles) débouche sur lamise <strong>au</strong> pas d’une paysannerie réticente, sur undurcissement des contraintes de travail jusqu’à laforme extrême de l’exploitation de la maind’œuvre <strong>au</strong> sein du Goulag, sur un encadrementde l’individu et de la société par le parti unique,HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE Accompagnement des programmes de 3 e ■ 165