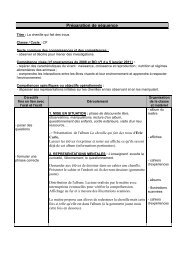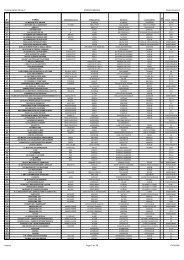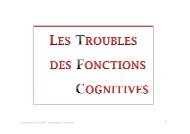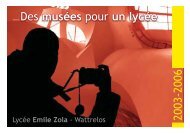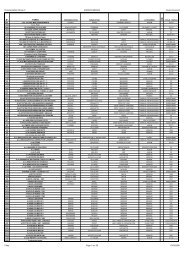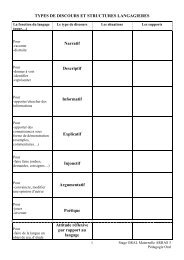Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
sa propagande et sa police politique. On peutrappeler que, si les grandes purges de 1936-1938ont été spectaculaires parce qu’elles ont frappéde vieux bolcheviks et des intellectuels, la répressionmassive contre la paysannerie a été plusmeurtrière mais s’est faite à bas bruit (les paysans« dékoulakisés » n’ont pas pu décrire leur martyre).Sur tous ces points, l’ouverture récente desarchives soviétiques a permis d’ouvrir de nouve<strong>au</strong>xchantiers historiographiques.3. Les crises des années 1930La crise de 1929 ne doit pas être étudiée endétail en tant que telle. Les crises des années 30sont multiformes, elles sont présentées à traversdeux exemples : celui de la France, une démocratiequi résiste malgré des remises en c<strong>au</strong>se, etcelui de l’Allemagne, pays qui sombre dans ladictature. Ces exemples permettent de montrerce qu’ont été les crises des années 30 en Europedans toutes leurs dimensions : économiques,sociales, culturelles et politiques. Une approchetechnique (l’effondrement de Wall Street, sesconditions, ses facteurs et les détails de l’enchaînementmondial de la dépression) ne rendraitpas compte de la complexité des crises qui ontmarqué les années 30. Les aspects économiques,soci<strong>au</strong>x, politiques et culturels de ces crises sontinterdépendants : il f<strong>au</strong>t expliquer, par exemple,les effets de la montée du chômage et de lamisère en Allemagne (6 millions de chômeurs <strong>au</strong>début de 1933, soit 33 % de la populationactive) dans la crise politique qui amène Hitler<strong>au</strong> pouvoir, comment cette crise débouche surun totalitarisme fondé sur le mythe de la racepure et l’expansion guerrière. Il f<strong>au</strong>t montrer lafaçon dont, en France, l’enlisement dans les difficultésdébouche sur une poussée d’antiparlementarismeet une crise des valeurs et commentle Front populaire a pu donner une brèveimpression d’embellie <strong>au</strong> cours de ces « annéestristes ». Mais, en France, la démocratie résiste.Cette histoire alimente notre mémoire collectiveet rejoint les préoccupations du présent.Une fois ces deux exemples analysés, on peutproposer, dans le cadre européen, une visionplus globale des crises des années 1930. Partird’exemples permet d’éviter les démarches abusivementdéterministes.Il f<strong>au</strong>t noter que le professeur, qui doit traiterl’intégralité du programme, est libre de choisirses itinéraires. Ainsi il peut opérer un rapprochement,<strong>au</strong>tour du thème du totalitarisme, entrel’étude de l’URSS stalinienne et celle del’Allemagne nazie. Il s’agit de faire réfléchir lesélèves sur ces deux grands types de totalitarisme,les modalités de leur mise en place, leurs buts etleurs pratiques. Dans la quatrième partie, un rapprochementavec la politique d’exterminationdes Juifs et des Tziganes permet de bien montrerque comparaison ne signifie pas identification etque cette politique d’extermination est unesinistre singularité du totalitarisme nazi. Commel’a montré H. Arendt, le concept de totalitarismene vise pas à banaliser le nazisme mais à soulignerle caractère criminel du stalinisme.4. La Seconde Guerre mondialeL’étude de la Seconde Guerre mondiale, commecelle de la première, ne doit pas se perdre dansun récit chronologique. Elle doit insister sur lescatastrophes qu’ont engendrées la dominationnazie et tout particulièrement la politique d’exterminationdes Juifs et des Tziganes, sur les résistanceset les collaborations face à cettedomination, en insistant notamment sur le cas dela France. Un second thème permet de mettre enévidence le rôle des États-Unis et celui del’URSS. L’étude débouche donc naturellementsur un bilan de la guerre et une présentation dumonde en 1945 qui sert de point de départ àl’étude de l’élaboration du monde d’<strong>au</strong>jourd’huidepuis cette date.B. Élaboration et organisationdu monde d’<strong>au</strong>jourd’huiCette partie affirme la cohérence de l’enseignementconjoint de l’histoire et de la géographie.Pour comprendre le monde d’<strong>au</strong>jourd’hui, sonorganisation et son élaboration, la complémentaritédes deux disciplines s’avère particulièrementéclairante. On peut commencer parl’étude géographique de ce monde puis passer àl’étude historique pour l’expliquer ou, inversement,partir de cette étude historique pour aboutir<strong>au</strong> table<strong>au</strong> géographique du monde actuel.Quel que soit l’ordre adopté, c’est la mise en évidencedes phénomènes historiques depuis 1945qui permet de comprendre ce monde ; la croissanceéconomique et démographique, les transformationssociales et culturelles accompagnentles bouleversements du paysage géopolitiquemondial : depuis la constitution de blocs, puisl’émergence du tiers monde, et enfin la dislocationdu monde communiste, on arrive, <strong>au</strong> termedu parcours, à un nouve<strong>au</strong> « pavage » du monde166 ■ HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE Accompagnement des programmes de 3 e