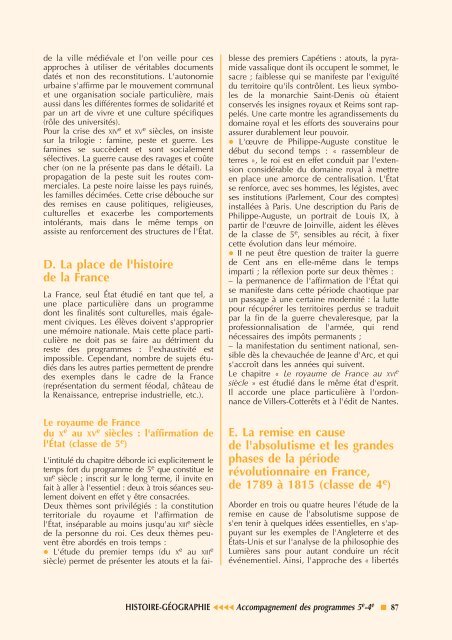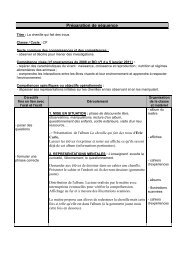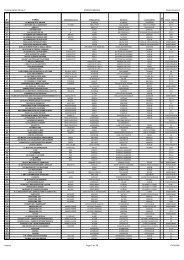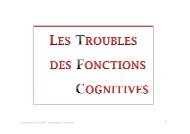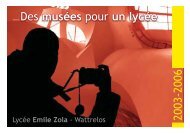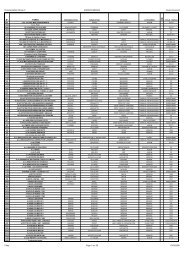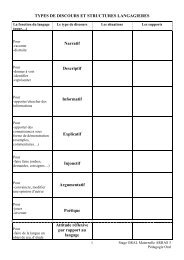Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
de la ville médiévale et l'on veille pour cesapproches à utiliser de véritables documentsdatés et non des reconstitutions. L'<strong>au</strong>tonomieurbaine s'affirme par le mouvement communalet une organisation sociale particulière, mais<strong>au</strong>ssi dans les différentes formes de solidarité etpar un art de vivre et une culture spécifiques(rôle des universités).Pour la crise des XIV e et XV e siècles, on insistesur la trilogie : famine, peste et guerre. Lesfamines se succèdent et sont socialementsélectives. La guerre c<strong>au</strong>se des ravages et coûtecher (on ne la présente pas dans le détail). Lapropagation de la peste suit les routes commerciales.La peste noire laisse les pays ruinés,les familles décimées. Cette crise débouche surdes remises en c<strong>au</strong>se politiques, religieuses,culturelles et exacerbe les comportementsintolérants, mais dans le même temps onassiste <strong>au</strong> renforcement des structures de l'État.D. La place de l'histoirede la FranceLa France, seul État étudié en tant que tel, <strong>au</strong>ne place particulière dans un programmedont les finalités sont culturelles, mais également<strong>civique</strong>s. Les élèves doivent s'approprierune mémoire nationale. Mais cette place particulièrene doit pas se faire <strong>au</strong> détriment dureste des programmes : l'exh<strong>au</strong>stivité estimpossible. Cependant, nombre de sujets étudiésdans les <strong>au</strong>tres parties permettent de prendredes exemples dans le cadre de la France(représentation du serment féodal, châte<strong>au</strong> dela Renaissance, entreprise industrielle, etc.).Le roy<strong>au</strong>me de Francedu X e <strong>au</strong> XV e siècles : l'affirmation del'État (classe de 5 e )L'intitulé du chapitre déborde ici explicitement letemps fort du programme de 5 e que constitue leXIII e siècle ; inscrit sur le long terme, il invite enfait à aller à l'essentiel : deux à trois séances seulementdoivent en effet y être consacrées.Deux thèmes sont privilégiés : la constitutionterritoriale du roy<strong>au</strong>me et l'affirmation del'État, inséparable <strong>au</strong> moins jusqu'<strong>au</strong> XIII e sièclede la personne du roi. Ces deux thèmes peuventêtre abordés en trois temps : L'étude du premier temps (du X e <strong>au</strong> XIII esiècle) permet de présenter les atouts et la faiblessedes premiers Capétiens : atouts, la pyramidevassalique dont ils occupent le sommet, lesacre ; faiblesse qui se manifeste par l'exiguïtédu territoire qu'ils contrôlent. Les lieux symbolesde la monarchie Saint-Denis où étaientconservés les insignes roy<strong>au</strong>x et Reims sont rappelés.Une carte montre les agrandissements dudomaine royal et les efforts des souverains pourassurer durablement leur pouvoir. L'œuvre de Philippe-Auguste constitue ledébut du second temps : « rassembleur deterres », le roi est en effet conduit par l'extensionconsidérable du domaine royal à mettreen place une amorce de centralisation. L'Étatse renforce, avec ses hommes, les légistes, avecses institutions (Parlement, Cour des comptes)installées à Paris. Une description du Paris dePhilippe-Auguste, un portrait de Louis IX, àpartir de l'œuvre de Joinville, aident les élèvesde la classe de 5 e , sensibles <strong>au</strong> récit, à fixercette évolution dans leur mémoire. II ne peut être question de traiter la guerrede Cent ans en elle-même dans le tempsimparti ; la réflexion porte sur deux thèmes :– la permanence de l'affirmation de l'État quise manifeste dans cette période chaotique parun passage à une certaine modernité : la luttepour récupérer les territoires perdus se traduitpar la fin de la guerre chevaleresque, par laprofessionnalisation de l'armée, qui rendnécessaires des impôts permanents ;– la manifestation du sentiment national, sensibledès la chev<strong>au</strong>chée de Jeanne d'Arc, et quis'accroît dans les années qui suivent.Le chapitre « Le roy<strong>au</strong>me de France <strong>au</strong> XVI esiècle » est étudié dans le même état d'esprit.Il accorde une place particulière à l'ordonnancede Villers-Cotterêts et à l'édit de Nantes.E. La remise en c<strong>au</strong>sede l'absolutisme et les grandesphases de la périoderévolutionnaire en France,de 1789 à 1815 (classe de 4 e )Aborder en trois ou quatre heures l'étude de laremise en c<strong>au</strong>se de l'absolutisme suppose des'en tenir à quelques idées essentielles, en s'appuyantsur les exemples de l'Angleterre et desÉtats-Unis et sur l'analyse de la philosophie desLumières sans pour <strong>au</strong>tant conduire un récitévénementiel. Ainsi, l'approche des « libertésHISTOIRE-GÉOGRAPHIE Accompagnement des programmes 5 e -4 e ■ 87