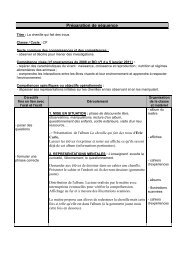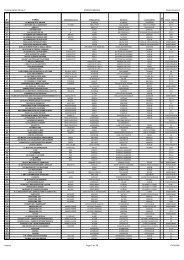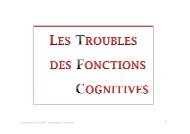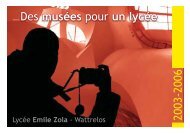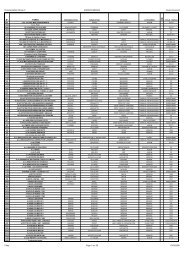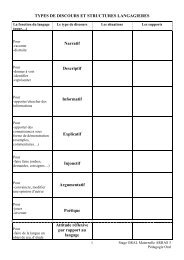Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
– AGULHON M<strong>au</strong>rice, BONTE Pierre, Marianne :les visages de la République, Paris, Gallimard,coll. « Découvertes <strong>Histoire</strong> », 1992.– BERSTEIN Serge, La République sur le fil : entretienavec Jean Lebrun, Textuel, 1998.D. La laïcitéObjectifs– Montrer la relation de la laïcité avec la philosophiedes Lumières, la Révolution française, laIII e République et la Constitution de 1946.– Définir la séparation du politique et du religieux,la neutralité de l’État, dans les grandsdomaines de la vie publique et, particulièrement,dans le système éducatif.– Souligner la valeur éthique de la laïcité et laplace de la « morale laïque » dans l’éducation etdans la vie publique.– Montrer la diversité des solutions apportées parla laïcité pour respecter les libertés de conscience,de conviction et de culte, d’expression et d’opinion,<strong>au</strong> nom du pluralisme démocratique.Problématique– La laïcité est peu connue et souvent mal comprisedes collégiens. Elle est entendue comme la négationdu fait religieux ou réduite à un anticléricalismemilitant dirigé contre une église(catholique) ou contre une religion (l’islam, parexemple). La laïcité est donc à expliquer dans sesfondements, c’est-à-dire les libertés démocratiqueset le respect de l’égalité des citoyensquelles que soient leurs convictions ou leurscroyances.– Originale dans sa construction institutionnelle,la laïcité est fréquemment réduite à « une exceptionfrançaise », qui ne serait ni comprise nitransposable dans les pays étrangers. Il convient,dès lors, de montrer la relation de la laïcité avecle pluralisme démocratique, ce qui justifie sondéveloppement récent dans d’<strong>au</strong>tres États (<strong>au</strong>Portugal, par exemple).– L’islam est souvent cité comme une religion enconflit avec la laïcité. Comme toute croyance, lareligion musulmane comporte des fanatiques,réfractaires à toute philosophie laïque, mais denombreux musulmans se réclament de la laïcité.Des témoignages littéraires ou sociologiquesdémentent la vision caricaturale d’un face-à-faceislam-laïcité. Plus largement, il s’agit de montrerque la laïcité ne privilégie, ne salarie ni ne subventionne<strong>au</strong>cun culte de préférence ou contreun <strong>au</strong>tre.Démarche– L’histoire de la laïcité permet de comprendrel’évolution des idées et des institutions démocratiquesà travers la relation d’<strong>au</strong>tonomie dupolitique et du religieux. La légitimité venue du« peuple souverain » s’oppose à une légitimitéde droit divin. Plus qu’une simple démarche, ellesignifie le respect de la diversité des convictionset l’égalité des citoyens.– Le rappel des institutions dans lesquelles la laïcitédoit être observée, et notamment à l’écolepublique, favorise la distinction entre viepublique et vie privée. Mais cette séparationn’est pas étanche : les libertés fondamentales,comme la liberté de conscience et la liberté deculte, sont garanties par la Constitution y comprislors de certaines manifestations publiques (processionet pèlerinages, par exemple). C’est donc<strong>au</strong> regard de la neutralité de l’État que la laïcitéacquiert sa pleine signification.– La laïcité est rapportée, par son origine philosophiqueet son développement <strong>au</strong> XX e siècle,<strong>au</strong>x droits de l’homme. Elle n’est donc pas seulementun produit de l’histoire nationale française,mais une valeur et un principe qui se réclamentde l’universalité des droits fondament<strong>au</strong>x, garantissantla dignité des personnes, sans distinctionde race, d’ethnie, de sexe ou de religion.Propositions– Pour rendre perceptible ce que la laïcité aapporté dans l’histoire de la démocratie,l’exemple de l’état civil laïque, qui enregistre lesévénements importants de la vie de tout citoyenquelle que soit sa confession ou son absence deconfession, celui de l’école « publique, laïque etobligatoire », de l’évolution du droit des personnesdélié des prescriptions religieuses(contraception, divorce, IVG, par exemple),celui de la liberté d’expression qui garantitcontre l’obligation d’imprimatur, l’<strong>au</strong>todafé delivres, la poursuite pour blasphème ou la fatwavisant des intellectuels « renégats », éclairent lesprogrès réalisés contre les dogmatismes. À l’inverse,certains ont voulu, dans des États totalitaires,se réclamer de la laïcité pour interdirel’expression religieuse.– Les solutions adoptées, dans la France laïque,pour garantir la pluralité des convictions sontrécapitulées et expliquées : respect des principalesfêtes religieuses ainsi que des interdits ouprescriptions alimentaires (dans les écoles, hôpit<strong>au</strong>x,armées, prisons), <strong>au</strong>torisations d’abattagerituel délivrées par le préfet, <strong>au</strong>torisations par lesÉDUCATION CIVIQUE Accompagnement du programme de 3 e ■ 207