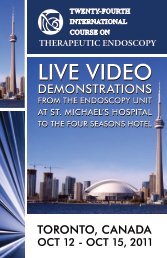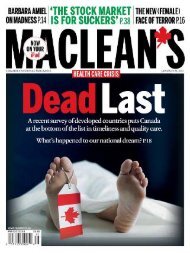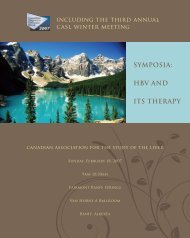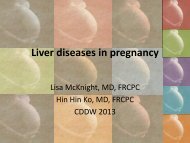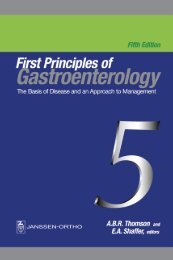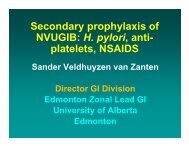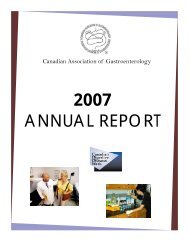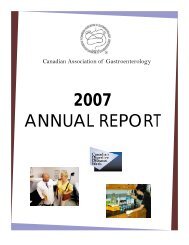Untitled - The Canadian Association of Gastroenterology
Untitled - The Canadian Association of Gastroenterology
Untitled - The Canadian Association of Gastroenterology
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
636 PRINCIPES FONDAMENTAUX DE GASTRO-ENTÉROLOGIE<br />
7.4 Hépatite alcoolique<br />
Cette affection est habituellement facile à diagnostiquer en fonction des<br />
signes cliniques (voir la section 8). Le tableau 31 compare ces caractéristiques<br />
à celles de l’hépatite virale. L’hépatite alcoolique peut être grave et mortelle.<br />
8. HÉPATOPATHIE ALCOOLIQUE / F. Wong<br />
Au Canada, l’hépatopathie est la quatrième cause de décès chez les adultes de<br />
20 à 70 ans. Dans ce pays, l’alcool demeure la cause la plus fréquente de<br />
maladie hépatique chronique. Mais la consommation d’alcool en quantités<br />
excessives ne provoque pas de lésions hépatiques dans tous les cas. L’incidence<br />
de cirrhose chez les alcooliques se situe en effet entre 10 % et 20 %. On ignore<br />
encore quel peut être le mécanisme de prédisposition à la cirrhose chez<br />
certaines personnes. Lors d’études épidémiologiques, on a montré que la<br />
quantité d’alcool consommée était le facteur principal dans le développement<br />
de la cirrhose. Une consommation quotidienne de plus de 60 g d’alcool pour<br />
les hommes et de plus de 40 g d’alcool pour les femmes pendant 10 ans<br />
augmente fortement le risque de cirrhose. Plus que le type de boisson, c’est la<br />
teneur en alcool qui importe et les épisodes isolés de beuverie sont moins<br />
nocifs pour le foie qu’une consommation quotidienne régulière. Les femmes<br />
sont plus susceptibles de lésion hépatique que les hommes. La cirrhose tend à<br />
apparaître plus tôt chez les femmes, à un stade plus avancé, et l’hépatopathie<br />
tend à être plus grave, avec plus de complications. Il se peut que la génétique<br />
intervienne dans le développement de l’hépatopathie alcoolique. Certains<br />
types de comportement alcoolique sont héréditaires. L’alcool est métabolisé<br />
en acétaldéhyde par l’alcool déshydrogénase, puis en acétate par l’acétaldéhyde<br />
déshydrogénase. Le pléomorphisme génétique de ces systèmes enzymatiques<br />
peut se traduire par un taux variable d’élimination de l’alcool et contribuer à<br />
la susceptibilité de chacun aux lésions alcooliques. On a noté lors de certaines<br />
études une fréquence accrue du gène codant pour l’alcool déshydrogénase<br />
chez les patients présentant une hépatopathie alcoolique, ce qui a pour effet<br />
d’augmenter la production d’acétaldéhyde. En outre, chez l’alcoolique présentant<br />
une activité moindre de l’acétaldéhyde déshydrogénase, l’hépatopathie<br />
alcoolique apparaît après une consommation cumulée inférieure à celle des<br />
autres. L’alcool a un effet hépatotoxique direct, qui ne nécessite pas de<br />
malnutrition préexistante. Toutefois, la malnutrition peut jouer un rôle permissif<br />
dans la promotion de l’hépatotoxicité alcoolique. Il existe un seuil de toxicité<br />
de l’alcool au-delà duquel aucun supplément diététique ne peut apporter de<br />
protection. L’obésité peut également constituer un facteur de risque indépendant<br />
d’hépatopathie alcoolique. Enfin, l’hépatite C semble jouer un rôle dans le<br />
développement d’une hépatopathie alcoolique avancée. Chez les patients qui