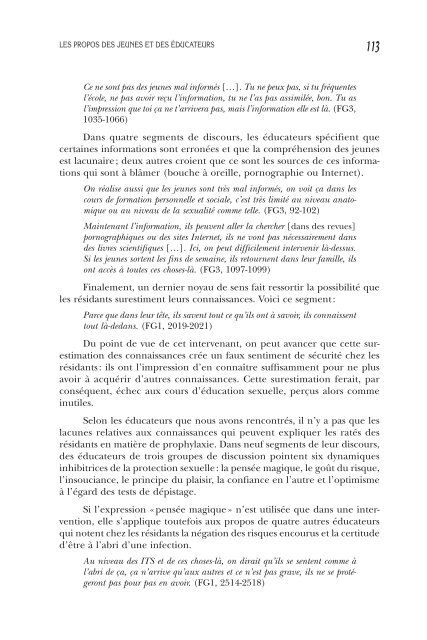Amour et sexualité chez l’adolescent
Amour et sexualité chez l’adolescent
Amour et sexualité chez l’adolescent
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LES PROPOS DES JEUNES ET DES ÉDUCATEURS<br />
113<br />
Ce ne sont pas des jeunes mal informés […]. Tu ne peux pas, si tu fréquentes<br />
l’école, ne pas avoir reçu l’information, tu ne l’as pas assimilée, bon. Tu as<br />
l’impression que toi ça ne t’arrivera pas, mais l’information elle est là. (FG3,<br />
1035-1066)<br />
Dans quatre segments de discours, les éducateurs spécifient que<br />
certaines informations sont erronées <strong>et</strong> que la compréhension des jeunes<br />
est lacunaire ; deux autres croient que ce sont les sources de ces informations<br />
qui sont à blâmer (bouche à oreille, pornographie ou Intern<strong>et</strong>).<br />
On réalise aussi que les jeunes sont très mal informés, on voit ça dans les<br />
cours de formation personnelle <strong>et</strong> sociale, c’est très limité au niveau anatomique<br />
ou au niveau de la sexualité comme telle. (FG3, 92-102)<br />
Maintenant l’information, ils peuvent aller la chercher [dans des revues]<br />
pornographiques ou des sites Intern<strong>et</strong>, ils ne vont pas nécessairement dans<br />
des livres scientifiques […]. Ici, on peut difficilement intervenir là-dessus.<br />
Si les jeunes sortent les fins de semaine, ils r<strong>et</strong>ournent dans leur famille, ils<br />
ont accès à toutes ces choses-là. (FG3, 1097-1099)<br />
Finalement, un dernier noyau de sens fait ressortir la possibilité que<br />
les résidants surestiment leurs connaissances. Voici ce segment :<br />
Parce que dans leur tête, ils savent tout ce qu’ils ont à savoir, ils connaissent<br />
tout là-dedans. (FG1, 2019-2021)<br />
Du point de vue de c<strong>et</strong> intervenant, on peut avancer que c<strong>et</strong>te surestimation<br />
des connaissances crée un faux sentiment de sécurité <strong>chez</strong> les<br />
résidants : ils ont l’impression d’en connaître suffisamment pour ne plus<br />
avoir à acquérir d’autres connaissances. C<strong>et</strong>te surestimation ferait, par<br />
conséquent, échec aux cours d’éducation sexuelle, perçus alors comme<br />
inutiles.<br />
Selon les éducateurs que nous avons rencontrés, il n’y a pas que les<br />
lacunes relatives aux connaissances qui peuvent expliquer les ratés des<br />
résidants en matière de prophylaxie. Dans neuf segments de leur discours,<br />
des éducateurs de trois groupes de discussion pointent six dynamiques<br />
inhibitrices de la protection sexuelle : la pensée magique, le goût du risque,<br />
l’insouciance, le principe du plaisir, la confiance en l’autre <strong>et</strong> l’optimisme<br />
à l’égard des tests de dépistage.<br />
Si l’expression « pensée magique » n’est utilisée que dans une intervention,<br />
elle s’applique toutefois aux propos de quatre autres éducateurs<br />
qui notent <strong>chez</strong> les résidants la négation des risques encourus <strong>et</strong> la certitude<br />
d’être à l’abri d’une infection.<br />
Au niveau des ITS <strong>et</strong> de ces choses-là, on dirait qu’ils se sentent comme à<br />
l’abri de ça, ça n’arrive qu’aux autres <strong>et</strong> ce n’est pas grave, ils ne se protégeront<br />
pas pour pas en avoir. (FG1, 2514-2518)