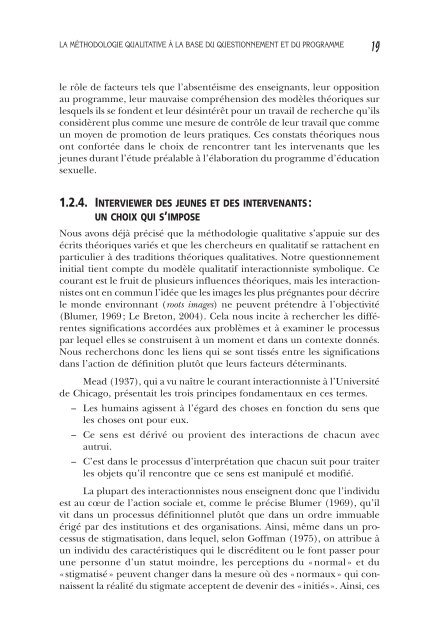Amour et sexualité chez l’adolescent
Amour et sexualité chez l’adolescent
Amour et sexualité chez l’adolescent
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LA MÉTHODOLOGIE QUALITATIVE À LA BASE DU QUESTIONNEMENT ET DU PROGRAMME<br />
19<br />
le rôle de facteurs tels que l’absentéisme des enseignants, leur opposition<br />
au programme, leur mauvaise compréhension des modèles théoriques sur<br />
lesquels ils se fondent <strong>et</strong> leur désintérêt pour un travail de recherche qu’ils<br />
consi dèrent plus comme une mesure de contrôle de leur travail que comme<br />
un moyen de promotion de leurs pratiques. Ces constats théoriques nous<br />
ont confortée dans le choix de rencontrer tant les intervenants que les<br />
jeunes durant l’étude préalable à l’élaboration du programme d’éducation<br />
sexuelle.<br />
1.2.4. INTERVIEWER DES JEUNES ET DES INTERVENANTS :<br />
UN CHOIX QUI S’IMPOSE<br />
Nous avons déjà précisé que la méthodologie qualitative s’appuie sur des<br />
écrits théoriques variés <strong>et</strong> que les chercheurs en qualitatif se rattachent en<br />
particulier à des traditions théoriques qualitatives. Notre questionnement<br />
initial tient compte du modèle qualitatif interactionniste symbolique. Ce<br />
courant est le fruit de plusieurs influences théoriques, mais les interactionnistes<br />
ont en commun l’idée que les images les plus prégnantes pour décrire<br />
le monde environnant (roots images) ne peuvent prétendre à l’objectivité<br />
(Blumer, 1969 ; Le Br<strong>et</strong>on, 2004). Cela nous incite à rechercher les différentes<br />
significations accordées aux problèmes <strong>et</strong> à examiner le processus<br />
par lequel elles se construisent à un moment <strong>et</strong> dans un contexte donnés.<br />
Nous recherchons donc les liens qui se sont tissés entre les significations<br />
dans l’action de définition plutôt que leurs facteurs déterminants.<br />
Mead (1937), qui a vu naître le courant interactionniste à l’Université<br />
de Chicago, présentait les trois principes fondamentaux en ces termes.<br />
– Les humains agissent à l’égard des choses en fonction du sens que<br />
les choses ont pour eux.<br />
– Ce sens est dérivé ou provient des interactions de chacun avec<br />
autrui.<br />
– C’est dans le processus d’interprétation que chacun suit pour traiter<br />
les obj<strong>et</strong>s qu’il rencontre que ce sens est manipulé <strong>et</strong> modifié.<br />
La plupart des interactionnistes nous enseignent donc que l’individu<br />
est au cœur de l’action sociale <strong>et</strong>, comme le précise Blumer (1969), qu’il<br />
vit dans un processus définitionnel plutôt que dans un ordre immuable<br />
érigé par des institutions <strong>et</strong> des organisations. Ainsi, même dans un processus<br />
de stigmatisation, dans lequel, selon Goffman (1975), on attribue à<br />
un individu des caractéristiques qui le discréditent ou le font passer pour<br />
une personne d’un statut moindre, les perceptions du « normal » <strong>et</strong> du<br />
« stigmatisé » peuvent changer dans la mesure où des « normaux » qui connais<br />
sent la réalité du stigmate acceptent de devenir des « initiés ». Ainsi, ces