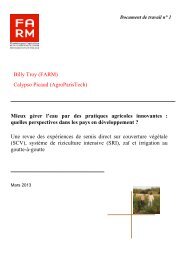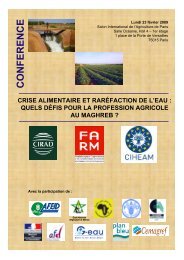La thèse en version intégrale - Fondation FARM
La thèse en version intégrale - Fondation FARM
La thèse en version intégrale - Fondation FARM
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
cette construction de l’individu à partir de l’extérieur signifie priver l’individu de son ess<strong>en</strong>ce,<br />
nier l’importance de l’int<strong>en</strong>tionnalité à l’origine de l’action. On t<strong>en</strong>drait ainsi à perdre la trace<br />
de quelques caractéristiques propres à l’humain, comme la motivation à la découverte de soimême<br />
et fondam<strong>en</strong>talem<strong>en</strong>t au « vivre <strong>en</strong>semble ». <strong>La</strong> considération de ces caractéristiques<br />
me fait relativiser la prét<strong>en</strong>due indissociabilité <strong>en</strong>tre acteurs humains et non-humains<br />
proposée par <strong>La</strong>tour.<br />
Encore une fois, il ne s’agit pas de plaider contre la nécessité de redéfinir la notion d’acteur.<br />
Dans la majorité des cas, le poids des habitudes et des conditionnem<strong>en</strong>ts est déterminant<br />
pour la concrétisation de l’action. Dans de tels cas, l’int<strong>en</strong>tionnalité n’a pas beaucoup de<br />
place à jouer car la totalité des compét<strong>en</strong>ces mis <strong>en</strong> œuvre par l’acteur humain peuv<strong>en</strong>t être<br />
attribuées à des habitudes auxquelles il aurait souscrit auparavant. L’incertitude inhér<strong>en</strong>te à<br />
l’origine de l’action, les différ<strong>en</strong>ces non-négligeables introduites dans l’action par les acteurs<br />
non-humains, et aussi le fait que l’imm<strong>en</strong>se majorité des actions humaines sont déterminées<br />
par des conditionnem<strong>en</strong>ts, tous exig<strong>en</strong>t une refondation du concept d’acteur. Néanmoins,<br />
des actions pleinem<strong>en</strong>t consci<strong>en</strong>tes, celles liées à des instants d’épanouissem<strong>en</strong>t de la<br />
créativité ou des actes motivés par des s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts désintéressés – même s’ils ne<br />
représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t peut-être qu’une minorité des circonstances – ne peuv<strong>en</strong>t pas être repérés dans<br />
la participation des acteurs non-humains à l’action. D’une part une différ<strong>en</strong>ce fondam<strong>en</strong>tale<br />
persiste <strong>en</strong>tre acteurs humains et non-humains, d’autre part les humains ne peuv<strong>en</strong>t pas être<br />
réduits à un <strong>en</strong>semble de conditionnem<strong>en</strong>ts. Convaincu que l’int<strong>en</strong>tionnalité des acteurs<br />
humains a un rôle important à jouer dans la configuration de l’action – <strong>en</strong> particulier des<br />
actions purem<strong>en</strong>t créatives et désintéressées – j’ai été am<strong>en</strong>é à considérer une dernière<br />
source théorique : la sociologie des régimes d’action de Luc Boltanski et <strong>La</strong>ur<strong>en</strong>t Thév<strong>en</strong>ot.<br />
A partir de la fin des années 1980, ces deux chercheurs ont comm<strong>en</strong>cé à structurer un<br />
nouveau paradigme pragmatique <strong>en</strong> sci<strong>en</strong>ces sociales, concernant notamm<strong>en</strong>t les rapports<br />
action-réflexivité, ce qui les a éloignés de plus <strong>en</strong> plus de l’approche bourdieusi<strong>en</strong>ne. Le<br />
« s<strong>en</strong>s pratique » de Bourdieu a le mérite de r<strong>en</strong>dre évid<strong>en</strong>te l’importance de pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong><br />
compte la perspective des acteurs <strong>en</strong> situation dans l’exploration de la construction de la<br />
réalité sociale. Néanmoins, la façon par laquelle Bourdieu propose le concept pousse à<br />
l’extrême la dichotomie <strong>en</strong>tre réflexion et action, négligeant la possibilité de rétroalim<strong>en</strong>tation<br />
<strong>en</strong>tre les deux. Comme l’indique Corcuff, l’opposition radicale proposée par<br />
Bourdieu <strong>en</strong>tre rapport intellectuel et rapport pratique à la pratique laisse <strong>en</strong> susp<strong>en</strong>s la place<br />
de la réflexivité dans l’action : « Si la réflexivité n’apparaît pas comme un point de passage<br />
obligé de toute action, elle n’est pas toujours exclue des conduites pratiques, même si dans ce<br />
cas elle est souv<strong>en</strong>t prise sous le feu de contraintes pragmatiques. » (CORCUFF 2007, p.42)<br />
Au contraire, la « sociologie des régimes d’action » (BOLTANSKI 1990) ou la « sociologie des<br />
régimes d’<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t » (THEVENOT 2006) non seulem<strong>en</strong>t laisse une marge de réflexivité<br />
dans l’action, mais <strong>en</strong>core considère <strong>en</strong> plus que cette part de consci<strong>en</strong>ce et de réflexivité<br />
n’est pas la même selon le type de situation, autrem<strong>en</strong>t dit, selon le « régime d’action ». <strong>La</strong><br />
sociologie pragmatique de Boltanski et Thév<strong>en</strong>ot a ouvert un vaste champ d’exploration car,<br />
contrairem<strong>en</strong>t à d’autres courants sociologiques plus classiques « qui dispos<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t d’un<br />
148