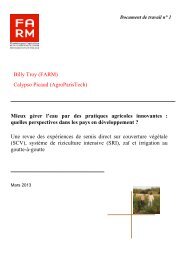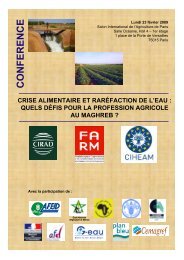La thèse en version intégrale - Fondation FARM
La thèse en version intégrale - Fondation FARM
La thèse en version intégrale - Fondation FARM
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
liée aux différ<strong>en</strong>ces intrinsèques <strong>en</strong>tre le chercheur et les ag<strong>en</strong>ts ordinaires. Dans ma<br />
recherche j’ai voulu éviter cette distance additionnelle pour trois raisons principales : d’abord<br />
parce qu’elle se base sur la possibilité d’atteindre l’objectivité absolue dans l’observation, ce<br />
qui me semble illusoire ; puis car, <strong>en</strong> empêchant l’établissem<strong>en</strong>t de relations de proximité<br />
avec les acteurs locaux, cette distance me semble compromettre la fiabilité de l’observation ;<br />
et finalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> raison de la position de supériorité du chercheur par rapport aux ag<strong>en</strong>ts<br />
ordinaires, à mon avis infondée, qu’elle connote. Comme le suggère Mohia, j’ai voulu<br />
abandonner cette « id<strong>en</strong>tité impersonnelle » pour vivre une « expéri<strong>en</strong>ce vraie » (MOHIA<br />
2008, p.286) lors de mon travail de terrain. J’ai été ainsi am<strong>en</strong>é à r<strong>en</strong>oncer à la prét<strong>en</strong>tion de<br />
faire une analyse objective de la réalité de l’autre, considérant, au même temps, la possible<br />
transformation de ma propre réalité <strong>en</strong> raison des échanges avec mes hôtes. Ma posture<br />
méthodologique est donc de me considérer moi-même comme sujet de mon expéri<strong>en</strong>ce de<br />
terrain. Selon Mohia, l’abandon de l’id<strong>en</strong>tité impersonnelle « permet au chercheur de réaliser<br />
une véritable rupture, intellectuelle et affective, avec la position de supériorité qu’occupe, de<br />
façon plus ou moins manifeste, sa société ou son groupe par rapport aux "autres" groupes,<br />
proches ou lointains, pris comme "objets". » (MOHIA 2008, p.288).<br />
Abandonner l’id<strong>en</strong>tité impersonnelle c’est, finalem<strong>en</strong>t, s’adresser aux ag<strong>en</strong>ts ordinaires avec<br />
tout le respect qu’ils mérit<strong>en</strong>t simplem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> tant qu’être humains : « […] à partir du mom<strong>en</strong>t<br />
où le chercheur s’id<strong>en</strong>tifie lui-même comme sujet de son expéri<strong>en</strong>ce, il reconnaît aussi à ses<br />
hôtes leur statut de sujets à part <strong>en</strong>tière. » (MOHIA 2008, p.289). Ainsi une relation peut être<br />
établie, non pas <strong>en</strong>tre le chercheur et son objet d’étude, mais <strong>en</strong>tre des êtres humains qui<br />
ont à appr<strong>en</strong>dre les uns avec les autres. Détaché de l’illusion d’objectivité absolue et de la<br />
prét<strong>en</strong>tion d’analyser l’autre, le chercheur peut s’ouvrir à la t<strong>en</strong>tative de compr<strong>en</strong>dre l’autre,<br />
assumant la possibilité d’être lui-même transformé par l’expéri<strong>en</strong>ce. Basée sur<br />
l’établissem<strong>en</strong>t de relations humaines auth<strong>en</strong>tiques et naturelles, l’expéri<strong>en</strong>ce de terrain<br />
devi<strong>en</strong>drait simplem<strong>en</strong>t et naturellem<strong>en</strong>t vraie.<br />
Il me semble que l’expéri<strong>en</strong>ce vraie doit primer sur l’exercice de production d’une recherche<br />
sci<strong>en</strong>tifique. Je vois la recherche dans le domaine social comme un effort de réduction d’une<br />
expéri<strong>en</strong>ce vécue afin de la formaliser selon le registre rationnel caractéristique de la sci<strong>en</strong>ce.<br />
Il s’agit, comme le dit <strong>La</strong>tour, d’un exercice artificiel de production d’un texte qui doit servir<br />
de médiateur <strong>en</strong>tre « l’événem<strong>en</strong>t du social » et « l’événem<strong>en</strong>t de la lecture » (LATOUR 2006a,<br />
p.194). Le résultat est une construction de l’esprit du chercheur qui essaie de mettre <strong>en</strong><br />
cohér<strong>en</strong>ce des observations et des concepts théoriques afin de créer une nouvelle<br />
compréh<strong>en</strong>sion sur les phénomènes étudiés. Ce qui est naturellem<strong>en</strong>t vrai et réel n’est pas<br />
dans le texte – forcem<strong>en</strong>t artificiel –, mais dans l’expéri<strong>en</strong>ce de vie à son origine. <strong>La</strong> recherche<br />
est une t<strong>en</strong>tative de formalisation de cette réalité, de réduction, pour ainsi dire, de<br />
l’expéri<strong>en</strong>ce vraie à des aspects rationnellem<strong>en</strong>t codifiables. Une partie seulem<strong>en</strong>t de ce qui a<br />
été vécu p<strong>en</strong>dant la recherche peut effectivem<strong>en</strong>t être traduite <strong>en</strong> rapport sci<strong>en</strong>tifique.<br />
Inhér<strong>en</strong>te à la réalité de l’expéri<strong>en</strong>ce naturelle et absolum<strong>en</strong>t majoritaire dans l’avènem<strong>en</strong>t<br />
de tout phénomène à l’intérieur de cette expéri<strong>en</strong>ce, l’incertitude, <strong>en</strong> particulier, reste<br />
172