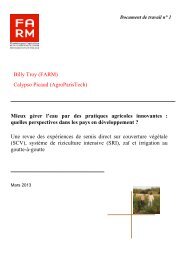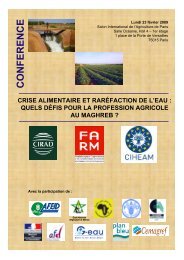La thèse en version intégrale - Fondation FARM
La thèse en version intégrale - Fondation FARM
La thèse en version intégrale - Fondation FARM
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
de la technologie) ; et b) des évaluations sur le processus de changem<strong>en</strong>t à moy<strong>en</strong>-long terme<br />
(des évaluations des t<strong>en</strong>dances, <strong>en</strong> parallèle d’appréciations instantanées de l’impact à un<br />
instant donné). » (SOUTER et al. 2005, p.28).<br />
Dans un rapport pour la <strong>Fondation</strong> Rockefeller publié <strong>en</strong> 2001, Alfonso Gumucio Dagron est<br />
particulièrem<strong>en</strong>t critique du rôle des bailleurs de fonds internationaux, de leur fixation sur<br />
l’approche projet, et, <strong>en</strong> particulier, de la poursuite de résultats à grande échelle et à court<br />
terme. Selon lui cela mettrait <strong>en</strong> péril la durabilité des initiatives au-delà du souti<strong>en</strong> financier<br />
extérieur : « Les exig<strong>en</strong>ces de prouver la "réussite" dans le court terme (le "syndrome du<br />
rapport annuel") ou la mesure d’un projet dans le nombre de bénéficiaires (le plus grand le<br />
nombre de bénéficiaires, le mieux), tout <strong>en</strong> excluant les aspects qualitatifs et des avantages à<br />
long terme, ont conduit à des projets qui ne sont des "réussites" que p<strong>en</strong>dant que les<br />
financem<strong>en</strong>ts extérieurs sont disponibles. […] <strong>La</strong> communauté internationale des bailleurs de<br />
fonds est <strong>en</strong>core rétic<strong>en</strong>te à reconnaître les 30 ou 40 ans d’échecs et les millions gaspillés à<br />
cause des programmes macros mal planifiés. <strong>La</strong> volonté d’aller vite, pour voir des résultats à<br />
court terme, et d’ét<strong>en</strong>dre la couverture à un grand nombre de personnes a donné des mauvais<br />
résultats. » (DRAGON 2001, p.10). Alfonso Dragon suggère que, dans un cadre plus<br />
raisonnable pour le développem<strong>en</strong>t, la question d’échelle aurait à voir avec le fait d’établir<br />
des liaisons <strong>en</strong>tre des communautés avec des problèmes semblables et de faciliter les<br />
échanges, au lieu de multiplier des modèles qui se heurt<strong>en</strong>t à la culture et la tradition : « Le<br />
niveau "macro" est souv<strong>en</strong>t un piège dans un monde très divers <strong>en</strong> cultures et riche <strong>en</strong><br />
différ<strong>en</strong>ces. » (DRAGON 2001, p.10). Selon l’auteur, passer à la grande échelle n’est pas<br />
toujours la bonne solution à long terme car les modèles de masse ne peuv<strong>en</strong>t pas remplacer<br />
le réseautage asc<strong>en</strong>dant (DRAGON 2001, p.10). Cette dynamique asc<strong>en</strong>dante 52 créerait de la<br />
valeur tout <strong>en</strong> r<strong>en</strong>forçant le processus d’appropriation des initiatives par les locaux, <strong>en</strong>core<br />
une fois fondam<strong>en</strong>tal pour la durabilité de ces initiatives.<br />
2.3.3.6 Rapports sociaux de pouvoir<br />
Selon François Ossama, « les sociétés africaines ont probablem<strong>en</strong>t plus vite que d’autres<br />
réalisé que l’information est le pouvoir, tant la connaissance est initiatique et généralem<strong>en</strong>t<br />
transmise dans les cercles d’initiés » (OSSAMA 2001 cité dans P. MASSE 2002, p.12).<br />
L’<strong>en</strong>racinem<strong>en</strong>t socioculturel à la fois de l’oralité et de l’association <strong>en</strong>tre l’information et le<br />
pouvoir expliquerait, toujours selon Ossama, le fait que le processus d’acquisition de la<br />
connaissance <strong>en</strong> Afrique est plus complexe et l’ét<strong>en</strong>due de sa diffusion plus faible qu’ailleurs<br />
dans le monde : « Le mode d’organisation et de vie de la société [africaine] ne favorise pas<br />
une diffusion ét<strong>en</strong>due de la connaissance. » (OSSAMA 2001 cité dans P. MASSE 2002, p.12).<br />
Ayant comme base cette compréh<strong>en</strong>sion culturelle des réalités africaines <strong>en</strong> particulier, il est<br />
évid<strong>en</strong>t que l’utilisation des TIC, des outils s<strong>en</strong>sés faciliter la communication <strong>en</strong>tre les<br />
utilisateurs – ce qui peut se traduire par une augm<strong>en</strong>tation de la transpar<strong>en</strong>ce des échanges –<br />
, peut soulever des <strong>en</strong>jeux de pouvoir importants.<br />
52 En anglais ces approches sont souv<strong>en</strong>t appelés « bottom-up ».<br />
83