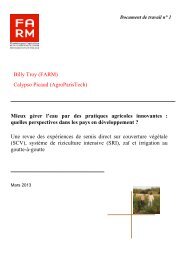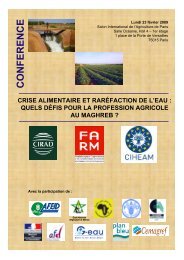La thèse en version intégrale - Fondation FARM
La thèse en version intégrale - Fondation FARM
La thèse en version intégrale - Fondation FARM
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.3.3.3 Participation des acteurs locaux<br />
<strong>La</strong> participation des communautés locales aux initiatives de développem<strong>en</strong>t fait l’objet d’une<br />
att<strong>en</strong>tion accrue de divers auteurs au moins dans les deux dernières déc<strong>en</strong>nies. L’historique<br />
de la littérature à ce propos <strong>en</strong>registre une étape initiale où le manque d’att<strong>en</strong>tion aux<br />
besoins spécifiques des populations supposées bénéficiaires a été fortem<strong>en</strong>t dénoncé – la<br />
participation des acteurs locaux étant alors prés<strong>en</strong>tée comme une solution. Après quelques<br />
années de recul sur l’application concrète des premières approches participatives, des<br />
critiques ont comm<strong>en</strong>cé à émerger à propos des diverses façons de concevoir la participation<br />
et de la mettre <strong>en</strong> œuvre.<br />
Richard Heeks souligne, déjà <strong>en</strong> 1999, que « l’utilisation d’approches participatives dans le<br />
développem<strong>en</strong>t des systèmes d’information a atteint le statut d’une nouvelle orthodoxie : une<br />
espèce de "formule magique" qui est toujours pertin<strong>en</strong>te, toujours bénéfique dans la t<strong>en</strong>tative<br />
de surmonter les taux d’échec élevés des systèmes d’information » (HEEKS 1999, p.1) dans les<br />
PED. Selon Heeks, pourtant, la participation ne serait manifestem<strong>en</strong>t pas si magique dans la<br />
pratique et serait souv<strong>en</strong>t problématique à mettre <strong>en</strong> place. Il souligne que le succès du<br />
concept de participation aurait am<strong>en</strong>é à des dérives dans son application : « Parce que la<br />
participation est dev<strong>en</strong>ue le nouveau mantra, elle est souv<strong>en</strong>t appliquée par une approche<br />
desc<strong>en</strong>dante, comme un patron à suivre. Cela peut empêcher la véritable participation. »<br />
(HEEKS 1999, p.5). Pour éviter ces dérives, Heeks suggère la réflexion sur trois questions<br />
préalables à la considération de la pratique de la participation (HEEKS 1999, p.14) : « Quel est<br />
le contexte politique et culturel », car ces contextes peuv<strong>en</strong>t être plus déterminants que les<br />
pratiques mises <strong>en</strong> œuvre dans le processus de participation ; « Qui veut introduire la<br />
participation, et pourquoi », car la participation ne marchera que si elle est motivée par un<br />
désir d’améliorer la prise de décisions et d’accroître l’appropriation de ces décisions ; et,<br />
finalem<strong>en</strong>t, « Qui sont ceux dont la participation est demandée Veul<strong>en</strong>t-ils, et peuv<strong>en</strong>t-ils,<br />
participer », car, du point de vue des participants pot<strong>en</strong>tiels, leurs motivations et leurs<br />
ressources sont fondam<strong>en</strong>tales à la réussite du processus de participation. Heeks conclut que<br />
la néglig<strong>en</strong>ce des contextes spécifiques, aussi bi<strong>en</strong> des populations locales que du projet à la<br />
base de l’application d’une approche participative, est la source majeure d’échecs de ces<br />
approches.<br />
Dans un ouvrage dirigé par Bill Cooke et Uma Kothari (COOKE & KOTHARI 2001), plusieurs<br />
auteurs analys<strong>en</strong>t les disfonctionnem<strong>en</strong>ts des approches participatives dans le domaine du<br />
développem<strong>en</strong>t, soulevant la question de savoir si la participation serait dev<strong>en</strong>ue « une<br />
nouvelle tyrannie ». Parmi les critiques, on peut souligner celles-ci (BUHLER 2002, p.2-3) :<br />
• <strong>La</strong> dépolitisation du phénomène de participation qui risque d’accompagner la valorisation<br />
du personnel, du local, et de la communauté. En effet, cette valorisation se fait souv<strong>en</strong>t<br />
au détrim<strong>en</strong>t d’une analyse des structures de pouvoir qui imprègn<strong>en</strong>t à la fois le local et<br />
le contexte général dans lequel la participation est incorporée. En d’autres termes, une<br />
démarche participative peut dev<strong>en</strong>ir implicitem<strong>en</strong>t une confirmation des structures de<br />
pouvoir établies : « Des programmes conçus pour inclure ceux qui sont exclus donn<strong>en</strong>t<br />
souv<strong>en</strong>t lieu à des formes de contrôle qui sont plus difficiles à contester, car elles<br />
77