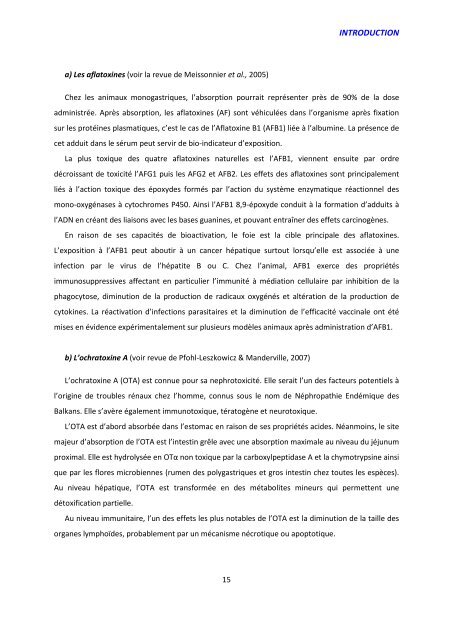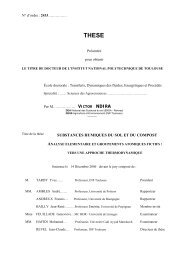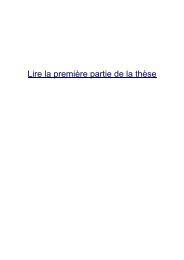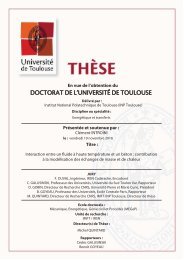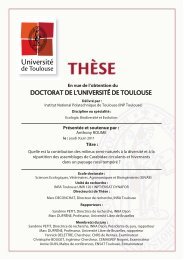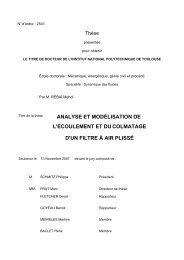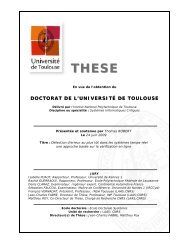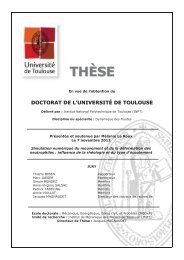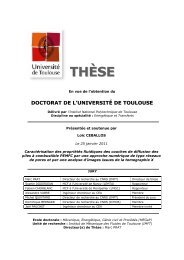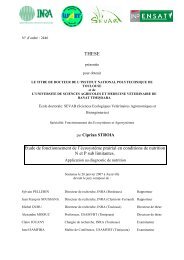Effet chez le porcelet d'une exposition à un régime co-contaminé en ...
Effet chez le porcelet d'une exposition à un régime co-contaminé en ...
Effet chez le porcelet d'une exposition à un régime co-contaminé en ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INTRODUCTIONa) Les aflatoxines (voir la revue de Meissonnier et al., 2005)Chez <strong>le</strong>s animaux monogastriques, l’absorption pourrait représ<strong>en</strong>ter près de 90% de la doseadministrée. Après absorption, <strong>le</strong>s aflatoxines (AF) sont véhiculées dans l’organisme après fixationsur <strong>le</strong>s protéines plasmatiques, c’est <strong>le</strong> cas de l’Aflatoxine B1 (AFB1) liée à l’albumine. La prés<strong>en</strong>ce decet adduit dans <strong>le</strong> sérum peut servir de bio-indicateur d’<strong>exposition</strong>.La plus toxique des quatre aflatoxines naturel<strong>le</strong>s est l’AFB1, vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>en</strong>suite par ordredécroissant de toxicité l’AFG1 puis <strong>le</strong>s AFG2 et AFB2. Les effets des aflatoxines sont principa<strong>le</strong>m<strong>en</strong>tliés à l’action toxique des époxydes formés par l’action du système <strong>en</strong>zymatique réactionnel desmono-oxygénases à cytochromes P450. Ainsi l’AFB1 8,9-époxyde <strong>co</strong>nduit à la formation d’adduits àl’ADN <strong>en</strong> créant des liaisons avec <strong>le</strong>s bases guanines, et pouvant <strong>en</strong>traîner des effets carcinogènes.En raison de ses capacités de bioactivation, <strong>le</strong> foie est la cib<strong>le</strong> principa<strong>le</strong> des aflatoxines.L’<strong>exposition</strong> à l’AFB1 peut aboutir à <strong>un</strong> cancer hépatique surtout lorsqu’el<strong>le</strong> est associée à <strong>un</strong>einfection par <strong>le</strong> virus de l’hépatite B ou C. Chez l’animal, AFB1 exerce des propriétésimm<strong>un</strong>osuppressives affectant <strong>en</strong> particulier l’imm<strong>un</strong>ité à médiation cellulaire par inhibition de laphagocytose, diminution de la production de radicaux oxygénés et altération de la production decytokines. La réactivation d’infections parasitaires et la diminution de l’efficacité vaccina<strong>le</strong> ont étémises <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce expérim<strong>en</strong>ta<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t sur plusieurs modè<strong>le</strong>s animaux après administration d’AFB1.b) L’ochratoxine A (voir revue de Pfohl-Leszkowicz & Mandervil<strong>le</strong>, 2007)L’ochratoxine A (OTA) est <strong>co</strong>nnue pour sa nephrotoxicité. El<strong>le</strong> serait l’<strong>un</strong> des facteurs pot<strong>en</strong>tiels àl’origine de troub<strong>le</strong>s rénaux <strong>chez</strong> l’homme, <strong>co</strong>nnus sous <strong>le</strong> nom de Néphropathie Endémique desBalkans. El<strong>le</strong> s’avère éga<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t imm<strong>un</strong>otoxique, tératogène et neurotoxique.L’OTA est d’abord absorbée dans l’estomac <strong>en</strong> raison de ses propriétés acides. Néanmoins, <strong>le</strong> sitemajeur d’absorption de l’OTA est l’intestin grê<strong>le</strong> avec <strong>un</strong>e absorption maxima<strong>le</strong> au niveau du jéj<strong>un</strong>umproximal. El<strong>le</strong> est hydrolysée <strong>en</strong> OTα non toxique par la carboxylpeptidase A et la chymotrypsine ainsique par <strong>le</strong>s flores microbi<strong>en</strong>nes (rum<strong>en</strong> des polygastriques et gros intestin <strong>chez</strong> toutes <strong>le</strong>s espèces).Au niveau hépatique, l’OTA est transformée <strong>en</strong> des métabolites mineurs qui permett<strong>en</strong>t <strong>un</strong>edétoxification partiel<strong>le</strong>.Au niveau imm<strong>un</strong>itaire, l’<strong>un</strong> des effets <strong>le</strong>s plus notab<strong>le</strong>s de l’OTA est la diminution de la tail<strong>le</strong> desorganes lymphoïdes, probab<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t par <strong>un</strong> mécanisme nécrotique ou apoptotique.15