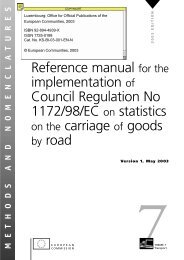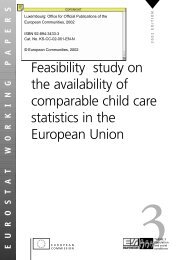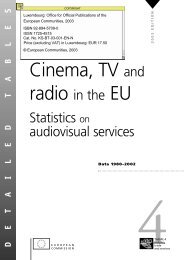Glossarium mediae et infimae latinitatis Conditum a Carolo du ...
Glossarium mediae et infimae latinitatis Conditum a Carolo du ...
Glossarium mediae et infimae latinitatis Conditum a Carolo du ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
que j'ay cite cy-devant, appelle des dras teins <strong>et</strong> d'escarlate.<br />
d<strong>et</strong>ranties a grans barates; <strong>et</strong> parce que les jeunes gens<br />
s'attachent ordinairement a ces nouveautez, pour se faire<br />
distinguer d'avec leurs peres, qui portoient des cottes<br />
d'armes semblables aux leurs, ils en faisoient pendre des<br />
lambeaux, soit au col, soit ailleurs, par forme de difference:<br />
<strong>et</strong> c'est de la que les lambeaux dans les armoiries ont pris<br />
leur origine, n'estans pas des especes de rateaux, comme<br />
Edward Bisse ', Anglois. a ecrit. II en est parle souvent dans<br />
les Comptes d'Estienne de la Fontaine, argentier <strong>du</strong> roy, <strong>et</strong><br />
particulierement en celuy de 1'an 1350 en ces termes: « Ppur<br />
« 7 quartiers de zatoliin d'Inde, <strong>et</strong> 7 quartiers de fort velluiau<br />
« vermeil pour faire deux cottes a armer.... pour un marc,<br />
« 5 esterlins, de perles blanches a semer le champ desdites<br />
« cottes, faire les coppons des labeaux pour 160 grosses<br />
« perles a champoier ledit champ. Plus bas: Pour 24 aunes<br />
« de velluiaux indes fors pour faire 2 couvertures a chevaux<br />
« pour ledit seigneur, <strong>et</strong> pour 2 aunes de velluiau vermeil <strong>et</strong><br />
« blanc a faire les labeaux de I'armoirie. » Au meme chapitre<br />
: « Pour 4 pieces de cendeaux indes <strong>et</strong> jaunes a faire<br />
« bannieres <strong>et</strong> pannonceaux pour ledit seigneur, pour 2<br />
« aunes <strong>et</strong> demie de cendal blanc <strong>et</strong> vermeil a faire les<br />
« labeaux. »<br />
II est arrive ensuite que les chevaliers ont fait empreihdre<br />
dans leurs ecus, non-seulement la couleur des draps d'or <strong>et</strong><br />
d'argent, <strong>et</strong> des riches pannes, qu'ils portoient en leurs cottes<br />
d'armes, mais encore la figure de ces decoupures, dont ils<br />
ont forme les bandes, les jumelles, les faces, les sautoirs,<br />
les chefs, <strong>et</strong> autres pieces. Quelquefpis aussi ils ont parseme<br />
leurs cottes d'armes des figures, soit d'animaux terrestres,<br />
soit d'oiseaux, ou choses semblables, qu'ils ont depuis<br />
empreintes dans leurs ecus, ou bien ils les ont empruntees<br />
de leurs ecus pour en parsemer leurs cottes d'armes, estant<br />
constant que les boucliers ont eu des la grande antiquite<br />
de semblables empreintes: <strong>et</strong> c'est la la pensee de Velser<br />
dans le passage que j'ay allegue de lui. Quelquefois aussi<br />
entre ceux qui diyersifioient ainsi leurs cottes d'armes, il<br />
s'en est trouv6 qui n'ont pas voulu les charger d'aucunes<br />
pieces, mais se sont contentez de les porter toutes simples<br />
sans decoupure, <strong>et</strong> de conserver dans leurs ecus la meme<br />
couleur qu'ils portoient en leurs cottes d'armes. C'est ce qui<br />
nous ouvre la raison pourquoy les comtes <strong>et</strong> les <strong>du</strong>es de<br />
Br<strong>et</strong>agne porterent 1'hermine simple dans leurs ecus, qui<br />
n'estoit autre que parce que qu'ils la portoient de la sorte en<br />
leurs cottes d'armes. Ainsi les seigneurs d'Albr<strong>et</strong> porterent<br />
.les gueules, les captaux de Buch en Guienne, de la maison<br />
de Puy-Paulin, 1'or plein, les seigneurs de S. Chaumont le<br />
gris, ou 1'azur, parce qu'en leurs cottes d'armes ils portoient<br />
les pannes de gueules <strong>et</strong> de gris, <strong>et</strong> le drap d'or.<br />
Cequejeviens de rapporter <strong>du</strong> compte d'Estienne de la<br />
Fontaine fait assez connoitre que Ton avolt coutume de<br />
broder les cottes d'armes, <strong>et</strong> de les enrichir de perles, <strong>et</strong><br />
qu'ainsi ce sont ces cottes brodees dont le sire de Joinville<br />
entend parler. Ces broderies n'estoient que pour relever <strong>et</strong><br />
marquer les armes <strong>du</strong> chevalier , qui y estoient empreintes<br />
en relief, en sorte que les memes figures <strong>et</strong> les memes couleurs<br />
qui se rencontroient dans son ecu se trouvoient aussi<br />
dans sa cotte d'armes. Guillaume le Br<strong>et</strong>on en sa Philippide 2 :<br />
Quaeque armaturae vestis consuta supremo<br />
Serica, cuique facit certis distinctio notis.<br />
Et Guillaume de Nangis en la Vie de Philippe III 3 : « Franci<br />
« vero, subita turbatiqne commoti, mira celeritate ad arma<br />
« prosiliunt, loricas in<strong>du</strong>unt , <strong>et</strong> desuper picturis variis,<br />
« secun<strong>du</strong>m diversas armorum differentias, se distinguunt. »<br />
Et parce que les cottes d'armes estoient parsemees des devises<br />
des chevaliers, on les appela des habits en devises. Ainsi<br />
Masuer *, parlant des preuves de la noblesse, dit que celle-la<br />
en est une « si ipse <strong>et</strong> alii praedecessores sui consueverint<br />
t portare vestes en devise, vel alias quas nobiles portare<br />
a consueverunt. » C'est en ce sens qu'on doit entendre Froissart<br />
s , quand il dit que le comte de Derby vint a Westminster<br />
« accompagne de grand nombre de seigneurs, <strong>et</strong> leurs<br />
« gens vestus chascun de sa livree en devise. » C'est a dire<br />
ayans tous leurs cottes d'armes armoiees de leurs armes.<br />
Monstrel<strong>et</strong> 8 en 1'an 1410, parlant de 1'election <strong>du</strong> pape<br />
Jean XXII, dit qu'a la cavalcade qu'il fit » se trouverent le<br />
« marquis de Ferrare, le seigneur de Malateste, le sire de<br />
t Gaucourt, <strong>et</strong> des autres quarante-quatre, tant <strong>du</strong>es, comtes,<br />
t comme chevaliers de la terre d'ltalie, vestus de paremens<br />
1. In Not. ad Upton. — 2. L. XL Phil, vers 190. — 3. [Cap. 5, pag, 475, ed.<br />
Pith.] — 4. Tit. de Talliis, N. 19. — 5. Vol. 4, ch. 114. — 6. Vol. 1, cli. 62.<br />
SUR L'HISTOIRE DE SAINT LOUYS.<br />
« de leurs livrees. » Georges Chastellain ', « armez <strong>et</strong> vestus<br />
« de cottes d'armes, devises <strong>et</strong> couleurs. » Et Alain Chartier 2 ,<br />
en son poeme intitule: La dame sans mercy, decrivant un<br />
cavalier amoureux, <strong>et</strong> maltraite par les rigueurs de sa maitresse,<br />
le represente rev<strong>et</strong>u de noir sans devise, c'estadire avec<br />
une cotte d'armes toute simple, <strong>et</strong> non armoiee de ses armes,<br />
ce qui estoit une marque de deuil,<br />
Le noir portoit, <strong>et</strong> sans devise.<br />
Ce sont ces devises des cottes d'armes que Sanudo 3 appelle<br />
superinsignia.<br />
Les cottes d'armes ainsi armoiees estoient une des marques<br />
principales de la noblesse, ainsi que Masuer a observe, parce<br />
que n'y ayant que les nobles qui eussent le droit de porter le<br />
haubert, ou la cotte de mailles, il n'y avoit aussi qu'eux qui<br />
eussent celuy de porter la cotte d'armes, qui n'estoit que<br />
pour couvrir celle de mailles. Et comme ordinairement il<br />
n'y avoit que les chevaliers qui portassent 1'un.e <strong>et</strong> 1'autre<br />
dans les guerres, de la est arriv6 que pour marquer un chevalier<br />
les historiens se contentent de le designer par le seul<br />
nom de cotte d'armes. Froissart * ecrit que le sire de Merode<br />
perdit en la bataille centre les Prisons, en laquelle Guillaume,<br />
comte de Hainaut, fut tue, trente-trois cottes d'armes de son<br />
lignage, c'est-a-dire trente-trois chevaliers de sa parente. Et<br />
Monstrel<strong>et</strong> 5 , parlant de la victoire remportee a Formigny,<br />
pres de Bayeux, par les Francois sur les Anglois, 1'an 1450,<br />
dit « qu'a c<strong>et</strong>te bataille furent prins prisonniers messire<br />
« Antoine Kiriel, <strong>et</strong>c., <strong>et</strong> plusieurs autres capitaines <strong>et</strong> gen-<br />
« tilshommes anglois portans cottes d'armes. » C'est une<br />
expression qu'Anne Comnene, en son Alexiade 6 , a empruntee<br />
de nos Francois, lorsque, racontant les pourparlers qui<br />
se firent pour 1'entrevue qui se devoit faire entre 1'empereur<br />
Alexis, son pere, <strong>et</strong> Boemond, prince d'Antioche, ce prince<br />
insista qu'il pourroit se trouver avec 1'empereur accomgagne<br />
de deux cottes d'armes, JIETCC Suo ^a(A'j6tov, c'est-a-dire avec<br />
deux chevaliers. C<strong>et</strong>te princesse ayant exprime la cotte<br />
d'armes par le terme de chlamys 7 , qui estoit un v<strong>et</strong>ement<br />
particulier aux gens de guerre <strong>et</strong> aux cavaliers. D'ou vient<br />
que pour designer un cavalier un titre 8 de Philippes I, roy<br />
de France, de 1'an 1068, use de ces paroles : « Aimericus,<br />
« quern occultabat militaris habitus <strong>et</strong> chlamydis obumbra-<br />
« bat aspectus ; » termes qui sont tirez de saint Ambroise,<br />
en la Vie de Saint Sebastien 9 , si toutefois il en est 1'auteur,<br />
ce que quelques sgavants semblent revoquer en doute. George<br />
Chatellaiu I0 , en YHistoire de Jacques de Lalain. chevalier de<br />
la Toison d'Or, attribue encore assez souvent les cottes<br />
d'armes armoiees aux escuiers, en sorte que 1'on peut conjecturer<br />
que dans les derniers siecles ils ont eu ce privilege,<br />
qui auparavant n'avoit appartenu qu'aux chevaliers.<br />
J'ay remarque que Ton decoupoit les pannes, ou fourrures,<br />
des cottes d'armes en diverses manieres, pour se distinguer<br />
les uns des autres. Ces figures <strong>et</strong> ces decoupures sont encore<br />
a present en usage dans les blazons des armoiries, mais<br />
dans des termes qui a peine nous sont connus. Ce qui me<br />
donnera suj<strong>et</strong> d'en expliquer quelques-uns des plus difficiles.<br />
J'ay dit ce que c'estoit que le lambel, lorsque j'ay parle des<br />
decoupures des habits.<br />
La fasce est, selon mon sentiment, ce qui est appelle par<br />
les auteurs latins <strong>du</strong> moyen temps fasciolaf qui estoit une<br />
espece de jarr<strong>et</strong>ierre pour lier les chausses. II en est parle<br />
souvent dans les constitutions monastiques". On donnoit<br />
encore le nom de fascia aux p<strong>et</strong>its sarocs, que les chanoines<br />
reguliers de S. Augustin portent lorsqu'ils yont a la campagne,<br />
qui n'a de largeur que quatre doits, comme le<br />
scapulaire des moines.<br />
Le pan. ou le pal, n'est rien autre chose que le palus des<br />
Latins, c'est a dire un pieu, d'ou le mot de palissade est<br />
demeure parmy nous.<br />
Le sautoir est 1'<strong>et</strong>rier pour monter <strong>et</strong> pour sauter sur le<br />
cheval. II est appelle par les Latins <strong>du</strong> moyen temps strepa<br />
<strong>et</strong> stapha, <strong>et</strong> par les nouveaux Grecs raaXa l2 . Le Ceremonial<br />
ms. dit que 1'escuier qui se trouvoit aux tournois ne devoit<br />
point avoir de sautoir a sa selle. Le Compte d'Estienne de la<br />
Fontaine, argentier <strong>du</strong> roy, de 1'an 1352, au chapitre des<br />
harnois : « Pour six livres de soye de plusieurs couleurs<br />
« pour faire las tissus <strong>et</strong> aguill<strong>et</strong>tes ausdits harnois, faire<br />
1. Hist, de Jacques de Lalain.— 2. P. 505. — 3. L. 2, part. 4, cap. 8. — 4. Vol. 4.<br />
ch. 77. —5. Vol. 3, p. 27. — 6. L. 10, p. 401. — 7. L. i Cod. Th. de habitu quo<br />
uti oport.; Nonius Paulin. ep. 7. — 8. Aux preuves de 1'Hist. des Chasieign. p. 179.<br />
— 9. C. 3, apud Bol. — 10. C. 54, 55, 64, 68, 71, 72. — 11. Regula Magistri<br />
Lanfranc. iu Decr<strong>et</strong>. Ord. S. Bened. c. 7,14 ; Consu<strong>et</strong>. Cluniac. 1. 3, c. 11 ; Monaco.<br />
S. Galli in <strong>Carolo</strong> M. 1, 1. c. 36 [34] ;. Nebridius Mundeleim, inAntiquar. Monast.<br />
— 12. Codin. de of fie. cap. 3, num. 9; cap. 5, num. 62.