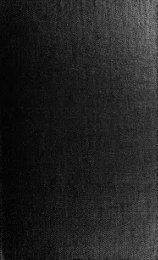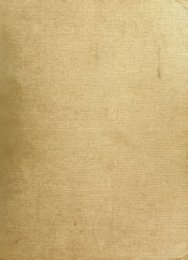Le trait "De unitate formae" de Gilles de Lessines ... - Boston College
Le trait "De unitate formae" de Gilles de Lessines ... - Boston College
Le trait "De unitate formae" de Gilles de Lessines ... - Boston College
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Etu<strong>de</strong> analytique du <strong>de</strong> unitatc forinae 109<br />
gage <strong>de</strong> l'auteur, la <strong>de</strong>terminatio per modiim narrationis'^ , est résumé dans<br />
une page du plus pur thomisme : la forme donne la première actuation,<br />
l'état subsistantiel, à la matière première et à toutes les parties du composé<br />
corporel ; elle est le principe <strong>de</strong> toutes ses déterminations constitutives.<br />
(Prima positio). Si, dans un corps vivant, on attribue <strong>de</strong>s noms divers aux<br />
membres dont les fonctions organiques sont spécialisées, c'est à raison <strong>de</strong>s<br />
manières d'être acci<strong>de</strong>ntelles qui les qualifient, et non pas en vertu d'un état<br />
substantiel qui leur appartiendrait en propre. (Secunda positio). La diversité<br />
nominale que nous attribuons, dans nos jugements, à ces parties corporelles,<br />
repose sur un acte abstractif qui saisit ces déterminations fonctionnelles, et<br />
n'exige pas, dans l'ordre extramental, une indépendance substantielle <strong>de</strong><br />
ces parties. (Positio tertia). Dans les transformations substantielles, même<br />
les plus élémentaires, les dispositions et les qualités qui <strong>de</strong>meurent à travers<br />
la décomposition ou la composition chimique et affectent l'être nouveau, ne<br />
se rattachent plus à la forme du corps disparu, mais à la forme subséquente,<br />
source unique <strong>de</strong>s actuations du nouvel être. (Positio quinta et sexto). Ce<br />
qui est vrai <strong>de</strong> la substance <strong>de</strong>s choses est vrai <strong>de</strong> leurs opérations. <strong>Le</strong><br />
composé seul agit (opérât iones siint sitppositontm), par la vertu <strong>de</strong> l'un ou<br />
<strong>de</strong> l'autre <strong>de</strong> ses éléments constitutifs. La multiplicité <strong>de</strong>s opérations<br />
n'implique pas la pluralité <strong>de</strong>s formes. (Positio qiiarta). Elle s'explique aisé-<br />
ment, ainsi que <strong>Gilles</strong> le déclare ailleurs, par la multiplicité <strong>de</strong>s poteiitiae ou<br />
principes prochains <strong>de</strong> l'action'-.<br />
Quand il entreprend <strong>de</strong> démontrer la thèse <strong>de</strong> l'unité <strong>de</strong> la forme., le<br />
philosophe belge est sobre <strong>de</strong> développements. <strong>De</strong>s arguments fondamen-<br />
taux, auxquels Thomas d'Aquin consacre <strong>de</strong>s chapitres entiers, occupent<br />
ici à peine cinq à dix lignes. Manifestement, l'auteur se réfère à <strong>de</strong>s choses<br />
connues <strong>de</strong> tous au moment où il écrit.<br />
P. 54]-60].<br />
- Potentiel a <strong>de</strong>ux sens très distincts dans le thomisme. Tantôt ce terme s'oppose à<br />
acttis et désigne alors la réceptivité, la simple aptitu<strong>de</strong> d'un sujet à acquérir, par un<br />
changement, une détermination nouvelle. Tantôt la pofeiitia désigne le principe prochain<br />
<strong>de</strong> l'activité <strong>de</strong> la substance, et elle se range alors dans la catégorie aristotélicienne <strong>de</strong> la<br />
qualité. Aucune <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux acceptions n'a <strong>de</strong> rapport avec la fausse notion <strong>de</strong> lapoteiîtm<br />
relevée p. 9G.