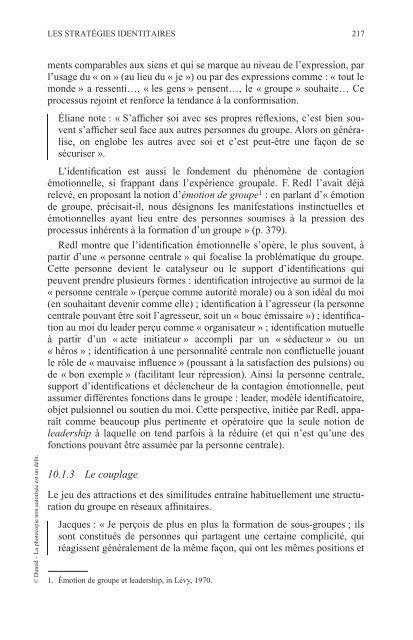psychologie de l'identité _ soi et le groupe
psychologie de l'identité _ soi et le groupe
psychologie de l'identité _ soi et le groupe
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LES STRATÉGIES IDENTITAIRES 217<br />
ments comparab<strong>le</strong>s aux siens <strong>et</strong> qui se marque au niveau <strong>de</strong> l’expression, par<br />
l’usage du « on » (au lieu du « je ») ou par <strong>de</strong>s expressions comme : « tout <strong>le</strong><br />
mon<strong>de</strong> » a ressenti…, « <strong>le</strong>s gens » pensent…, <strong>le</strong> « <strong>groupe</strong> » souhaite… Ce<br />
processus rejoint <strong>et</strong> renforce la tendance à la conformisation.<br />
Éliane note : « S’afficher <strong>soi</strong> avec ses propres réf<strong>le</strong>xions, c’est bien souvent<br />
s’afficher seul face aux autres personnes du <strong>groupe</strong>. Alors on généralise,<br />
on englobe <strong>le</strong>s autres avec <strong>soi</strong> <strong>et</strong> c’est peut-être une façon <strong>de</strong> se<br />
sécuriser ».<br />
L’i<strong>de</strong>ntification est aussi <strong>le</strong> fon<strong>de</strong>ment du phénomène <strong>de</strong> contagion<br />
émotionnel<strong>le</strong>, si frappant dans l’expérience groupa<strong>le</strong>. F. Redl l’avait déjà<br />
re<strong>le</strong>vé, en proposant la notion d’émotion <strong>de</strong> <strong>groupe</strong> 1 : en parlant d’« émotion<br />
<strong>de</strong> <strong>groupe</strong>, précisait-il, nous désignons <strong>le</strong>s manifestations instinctuel<strong>le</strong>s <strong>et</strong><br />
émotionnel<strong>le</strong>s ayant lieu entre <strong>de</strong>s personnes soumises à la pression <strong>de</strong>s<br />
processus inhérents à la formation d’un <strong>groupe</strong> » (p. 379).<br />
Redl montre que l’i<strong>de</strong>ntification émotionnel<strong>le</strong> s’opère, <strong>le</strong> plus souvent, à<br />
partir d’une « personne centra<strong>le</strong> » qui focalise la problématique du <strong>groupe</strong>.<br />
C<strong>et</strong>te personne <strong>de</strong>vient <strong>le</strong> catalyseur ou <strong>le</strong> support d’i<strong>de</strong>ntifications qui<br />
peuvent prendre plusieurs formes : i<strong>de</strong>ntification introjective au surmoi <strong>de</strong> la<br />
« personne centra<strong>le</strong> » (perçue comme autorité mora<strong>le</strong>) ou à son idéal du moi<br />
(en souhaitant <strong>de</strong>venir comme el<strong>le</strong>) ; i<strong>de</strong>ntification à l’agresseur (la personne<br />
centra<strong>le</strong> pouvant être <strong>soi</strong>t l’agresseur, <strong>soi</strong>t un « bouc émissaire ») ; i<strong>de</strong>ntification<br />
au moi du <strong>le</strong>a<strong>de</strong>r perçu comme « organisateur » ; i<strong>de</strong>ntification mutuel<strong>le</strong><br />
à partir d’un « acte initiateur » accompli par un « séducteur » ou un<br />
« héros » ; i<strong>de</strong>ntification à une personnalité centra<strong>le</strong> non conflictuel<strong>le</strong> jouant<br />
<strong>le</strong> rô<strong>le</strong> <strong>de</strong> « mauvaise influence » (poussant à la satisfaction <strong>de</strong>s pulsions) ou<br />
<strong>de</strong> « bon exemp<strong>le</strong> » (facilitant <strong>le</strong>ur répression). Ainsi la personne centra<strong>le</strong>,<br />
support d’i<strong>de</strong>ntifications <strong>et</strong> déc<strong>le</strong>ncheur <strong>de</strong> la contagion émotionnel<strong>le</strong>, peut<br />
assumer différentes fonctions dans <strong>le</strong> <strong>groupe</strong> : <strong>le</strong>a<strong>de</strong>r, modè<strong>le</strong> i<strong>de</strong>ntificatoire,<br />
obj<strong>et</strong> pulsionnel ou soutien du moi. C<strong>et</strong>te perspective, initiée par Redl, apparaît<br />
comme beaucoup plus pertinente <strong>et</strong> opératoire que la seu<strong>le</strong> notion <strong>de</strong><br />
<strong>le</strong>a<strong>de</strong>rship à laquel<strong>le</strong> on tend parfois à la réduire (<strong>et</strong> qui n’est qu’une <strong>de</strong>s<br />
fonctions pouvant être assumée par la personne centra<strong>le</strong>).<br />
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.<br />
10.1.3 Le couplage<br />
Le jeu <strong>de</strong>s attractions <strong>et</strong> <strong>de</strong>s similitu<strong>de</strong>s entraîne habituel<strong>le</strong>ment une structuration<br />
du <strong>groupe</strong> en réseaux affinitaires.<br />
Jacques : « Je perçois <strong>de</strong> plus en plus la formation <strong>de</strong> sous-<strong>groupe</strong>s ; ils<br />
sont constitués <strong>de</strong> personnes qui partagent une certaine complicité, qui<br />
réagissent généra<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> la même façon, qui ont <strong>le</strong>s mêmes positions <strong>et</strong><br />
1. Émotion <strong>de</strong> <strong>groupe</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>a<strong>de</strong>rship, in Lévy, 1970.