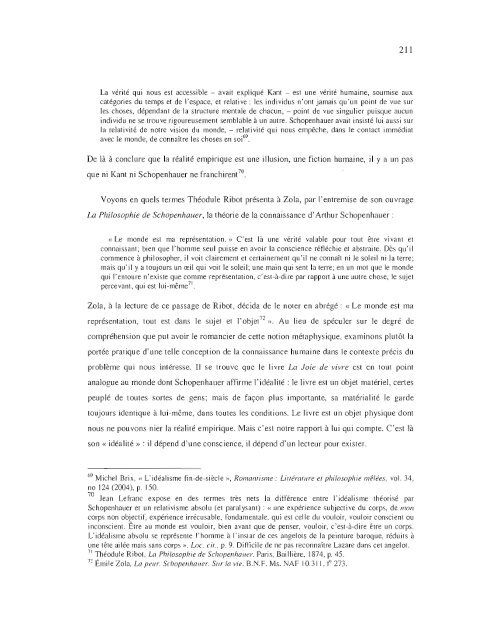Émile Zola et le pessimisme schopenhauerien ... - Archipel - UQAM
Émile Zola et le pessimisme schopenhauerien ... - Archipel - UQAM
Émile Zola et le pessimisme schopenhauerien ... - Archipel - UQAM
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
211<br />
La vérité qui nous est accessib<strong>le</strong> - avait expliqué Kant - est une vérité humaine, soumise aux<br />
catégories du temps <strong>et</strong> de l'espace, <strong>et</strong> relative: <strong>le</strong>s individus n'ont jamais qu'un point de vue sur<br />
<strong>le</strong>s choses, dépendant de la structure menta<strong>le</strong> de chacun, - point de vue singulier puisque aucun<br />
individu ne se trou ve rigoureusement semblab<strong>le</strong> à un autre. Schopenhauer avait insisté lui aussi sur<br />
la relativité de notre vision du monde, - relativité qui nous empêche, dans <strong>le</strong> contact immédiat<br />
avec <strong>le</strong> monde, de connaître <strong>le</strong>s choses en soi 69 .<br />
De là à conclure que la réalité empirique est une illusion, une fiction humaine, il y a un pas<br />
que ni Kant ni Schopenhauer ne franchirent 70.<br />
Voyons en quels termes Théodu<strong>le</strong> Ribot présenta à <strong>Zola</strong>, par l'entremise de son ouvrage<br />
La Philosophie de Schopenhauer, la théorie de la connaissance d'Arthur Schopenhauer:<br />
«Le monde est ma représentation.» C'est là une vérité valab<strong>le</strong> pour tout être vivant <strong>et</strong><br />
connaissant; bien que J'homme seul puisse en avoir la conscience réfléchie <strong>et</strong> abstraite. Dès qu'il<br />
commence à philosopher, il voit clairement <strong>et</strong> certainement qu'il ne connaît ni Je so<strong>le</strong>il ni la terre;<br />
mais qu'il y a toujours un œil qui voit <strong>le</strong> so<strong>le</strong>il; une main qui sent la terre; en un mot que <strong>le</strong> monde<br />
qui l'entoure n'existe que comme représentation, c'est-à-dire par rapport à une autre chose, <strong>le</strong> suj<strong>et</strong><br />
percevant, qui est lui-même 71 .<br />
<strong>Zola</strong>, à la <strong>le</strong>cture de ce passage de Ribot, décida de <strong>le</strong> noter en abrégé: «Le monde est ma<br />
représentation, tout est dans <strong>le</strong> suj<strong>et</strong> <strong>et</strong> 1'0bj<strong>et</strong> 72 ». Au lieu de spécu<strong>le</strong>r sur <strong>le</strong> degré de<br />
compréhension que put avoir <strong>le</strong> romancier de c<strong>et</strong>te notion métaphysique, examinons plutôt la<br />
portée pratique d'une tel<strong>le</strong> conception de la connaissance humaine dans <strong>le</strong> contexte précis du<br />
problème qui nous intéresse. Il se trouve que <strong>le</strong> livre La Joie de vivre est en tout point<br />
analogue au monde dont Schopenhauer affirme l'idéalité: <strong>le</strong> livre est un obj<strong>et</strong> matériel, certes<br />
peuplé de toutes sortes de gens; mais de façon plus importante, sa matérialité <strong>le</strong> garde<br />
toujours identique à lui-même, dans toutes <strong>le</strong>s conditions. Le livre est un obj<strong>et</strong> physique dont<br />
nous ne pouvons nier la réalité empirique. Mais c'est notre rapport à lui qui compte. C'est là<br />
son « idéalité» : il dépend d'une conscience, il dépend d'un <strong>le</strong>cteur pour exister.<br />
69 Michel Brix, « L'idéalisme fin-de-sièc<strong>le</strong> », ROl11.all/isme: Lillér{//ure el philosophie mêlées, vol. 34,<br />
no 124 (2004), p. 150.<br />
70 Jean Leli'anc expose en des termes très n<strong>et</strong>s la diftërence entre l'idéal isme théorisé par<br />
Schopenhauer <strong>et</strong> un relativisme absolu (<strong>et</strong> paralysant) : « une expérience subjective du corps, de /11on<br />
corps non objectif, expérience irrécusab<strong>le</strong>, fondamenta<strong>le</strong>, qui est cel<strong>le</strong> du vouloir. vouloir conscient ou<br />
inconscient. Êlre au monde est vouloir, bien avant que de penser, vouloir, c'est-à-dire être un corps.<br />
L'idéalisme absolu se représente l'homme à l'jnslar de ces angelots de la peinture baroque, réduits à<br />
une tête ailée mais sans corps ». Loc. Cil., p. 9. Diffici<strong>le</strong> de ne pas reconnaître Lazare dans cel angelo!.<br />
71 Théodu<strong>le</strong> Ribot, La Philosophie de Schopenhauer. Paris, Baillière, 1874, p. 45.<br />
72 <strong>Émi<strong>le</strong></strong> <strong>Zola</strong>, La peur. Schopenhauer. Sur la vie, B.N.F. Ms. NAf 10.31 1, JO 273.