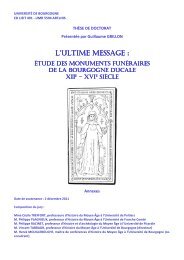le même processus pour tous - Université de Bourgogne
le même processus pour tous - Université de Bourgogne
le même processus pour tous - Université de Bourgogne
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Revue bibliographique<br />
participants huit stimuli représentant <strong>de</strong>s barres vertica<strong>le</strong>s <strong>de</strong> tail<strong>le</strong> variab<strong>le</strong> mais en continuum (5% <strong>de</strong><br />
différence <strong>de</strong> tail<strong>le</strong> entre <strong>de</strong>ux barres successives). Les barres étaient présentées une par une sur <strong>de</strong>s<br />
feuil<strong>le</strong>s séparées. Certaines étaient associées à <strong>de</strong>s <strong>le</strong>ttres et d’autres non. Trois conditions ont été<br />
testées (Figure 1).<br />
Figure 1. Stimuli utilisés par Tafjel et Wilkes (1963).<br />
Dans la condition 1 (condition d’appariement systématique), <strong>le</strong>s quatre barres <strong>le</strong>s plus courtes étaient<br />
associées à la <strong>le</strong>ttre A et <strong>le</strong>s quatre plus gran<strong>de</strong>s à la <strong>le</strong>ttre B. Les auteurs incitaient ainsi <strong>le</strong>s<br />
participants à établir une catégorisation en <strong>de</strong>ux groupes distincts : <strong>le</strong>s gran<strong>de</strong>s et <strong>le</strong>s petites barres.<br />
Dans la condition 2 (condition d’appariement aléatoire), <strong>le</strong>s barres étaient associées <strong>de</strong> façon aléatoire<br />
avec <strong>le</strong>s <strong>le</strong>ttres A et B. Enfin dans la condition 3 (condition contrô<strong>le</strong>), <strong>le</strong>s barres n’étaient associées à<br />
aucune <strong>le</strong>ttre. La tâche <strong>de</strong>s sujets consistait à estimer la tail<strong>le</strong> <strong>de</strong> chaque barre. La condition 1 a fait<br />
apparaître <strong>le</strong>s phénomènes <strong>de</strong> contraste et d’assimilation. Certains participants ont maximisé <strong>le</strong>s<br />
différences entre <strong>le</strong>s barres en estimant que <strong>de</strong>s barres différentes objectivement <strong>de</strong> 5% en tail<strong>le</strong> mais<br />
ayant reçu une <strong>le</strong>ttre différente, ont une tail<strong>le</strong> beaucoup plus dissemblab<strong>le</strong> qu’el<strong>le</strong> ne l’est en réalité. A<br />
l’inverse, certains participants ont minimisé <strong>le</strong>s différences entre <strong>le</strong>s barres en jugeant toutes <strong>le</strong>s barres<br />
associées avec la <strong>le</strong>ttre A comme étant très semblab<strong>le</strong>s, <strong>de</strong> <strong>même</strong> <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s barres associées avec la<br />
<strong>le</strong>ttre B. Dans la condition 2 où l’appariement entre <strong>le</strong>s barres et <strong>le</strong>s <strong>le</strong>ttres est aléatoire, <strong>le</strong>s résultats<br />
sont semblab<strong>le</strong>s à la condition 3 sans appariement : <strong>le</strong>s participants ne peuvent pas établir <strong>de</strong> relation<br />
entre la <strong>le</strong>ttre et la tail<strong>le</strong>. Lors <strong>de</strong> phénomènes <strong>de</strong> contraste ou d’assimilation, <strong>le</strong> participant fait comme<br />
si <strong>le</strong>s similitu<strong>de</strong>s ou <strong>le</strong>s différences étaient plus marquées qu’el<strong>le</strong>s ne <strong>le</strong> sont en réalité. La<br />
catégorisation aboutit donc à regrouper et simultanément à différencier <strong>le</strong>s objets.<br />
Devant la comp<strong>le</strong>xité <strong>de</strong> notre environnement, la catégorisation apparait comme un <strong>processus</strong><br />
primordial <strong>pour</strong> l'homme. Les philosophes et <strong>le</strong>s psychologues se sont querellés pendant <strong>de</strong>s années<br />
sur la façon dont <strong>le</strong>s individus catégorisent <strong>le</strong>s objets ou <strong>le</strong>s situations. Comment détermine-t-on qu'un<br />
crabe est un crustacé et non un insecte alors que <strong>le</strong>s crabes ressemb<strong>le</strong>nt à <strong>de</strong> grosses araignées ?<br />
Plusieurs théories se sont succédées <strong>pour</strong> tenter d’expliquer la structure <strong>de</strong>s concepts.<br />
8