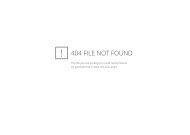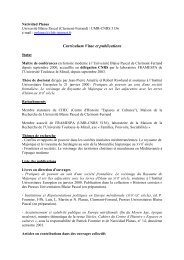Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La communauté vénitienne dans son ensemble souffrait <strong>de</strong> la guerre et <strong>de</strong>s conséquences<br />
pratiques et symboliques <strong>de</strong> la conquête <strong>de</strong> la Terre ferme par les troupes ennemies. Les<br />
phénomènes sociaux que nous observons durant la guerre <strong>de</strong> la ligue <strong>de</strong> Cambrai semblent<br />
relever d’une forme <strong>de</strong> gestion collective <strong>de</strong>s conflits et tensions intérieurs. On assista ainsi à<br />
la diffusion d’un sentiment collectif <strong>de</strong> culpabilité lié, au moins dans les discours officiels, à<br />
la dépravation morale <strong>de</strong>s Vénitiens. Il s’agissait d’une accusation collective <strong>de</strong>s mœurs<br />
dissolues <strong>de</strong>s habitants <strong>de</strong> la lagune considérés dans leur ensemble. De nombreuses<br />
processions furent organisées durant la guerre, avec la volonté affichée d’expier <strong>de</strong> façon<br />
collective les péchés et les vices <strong>de</strong>s Vénitiens. Le peintre Vittore Carpaccio a été l’un <strong>de</strong>s<br />
témoins précieux <strong>de</strong> ces événements 196 .<br />
Face aux défaites successives et à l’urgence <strong>de</strong> la situation, les Vénitiens invoquèrent la<br />
possibilité d’une punition divine. De nombreux phénomènes naturelles – comètes,<br />
tremblements <strong>de</strong> terre, tempête, etc. – furent interprétés comme autant <strong>de</strong> manifestations <strong>de</strong> la<br />
colère <strong>de</strong> Dieu, auxquelles il fallait répondre par <strong>de</strong>s signes <strong>de</strong> soumission, afin d’obtenir sa<br />
clémence. Les processions se multiplièrent et même si les phénomènes collectifs <strong>de</strong> ce genre<br />
étaient déjà fréquents à l’époque médiévale à Venise comme dans les autres villes italiennes,<br />
c’est la mise en discours d’une faute collective qui est ici intéressante. Celle-ci n’était pas la<br />
même selon les sources. Le chroniqueur G. Priuli insistait sur le vice et les péchés d’ordre<br />
moral, sodomie et pratiques sexuelles illicites, alors que M. Sanudo semblait davantage<br />
préoccupé par les erreurs politiques <strong>de</strong> ses pairs : corruption, vénalité et conscience politique<br />
limitée.<br />
De nombreux procès et rituels <strong>de</strong> punition ou d’exécution furent organisés. Certains patriciens<br />
appauvris focalisèrent l’attention car ils furent, accusés <strong>de</strong> s’être rendus coupables <strong>de</strong> vols ou<br />
d’autres crimes encore et condamnés sur la place publique. Les exécutions sur la piazzetta,<br />
<strong>de</strong>vant le Palais <strong>de</strong>s doges, rassemblaient alors la population <strong>de</strong> la ville venue assister à la<br />
punition <strong>de</strong> ces patriciens personnifiant une déca<strong>de</strong>nce morale à expier collectivement.<br />
Le lien social<br />
L’expression et la manifestation <strong>de</strong> ces tensions permettent d’apporter quelques éléments <strong>de</strong><br />
conclusion sur la fonction occupée par les conflits dans la définition du lien social. Venise se<br />
révèle un excellent cas d’étu<strong>de</strong> en raison <strong>de</strong> l’exceptionnelle cohésion sociale dont la ville<br />
avait toujours joui à l’époque médiévale, et encore au XVI e siècle. Il s’agit <strong>de</strong> l’un <strong>de</strong>s thèmes<br />
au cœur <strong>de</strong> l’historiographie <strong>de</strong> Venise, même si les historiens font en réalité rarement usage<br />
du concept même <strong>de</strong> « lien social ». La terminologie, en effet, n’est généralement pas utilisée<br />
par les historiens italiens, qui la considère plutôt galvaudée et ancienne, et relativement peu<br />
employée par les historiens américains et anglais.<br />
Néanmoins, si l’on considère le concept dans sa définition large, force est <strong>de</strong> constater que le<br />
lien social – considéré comme l’ensemble <strong>de</strong>s processus sociaux permettant aux membres<br />
d’une même société <strong>de</strong> vivre ensemble et <strong>de</strong> cohabiter – fon<strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la société vénitienne<br />
du Moyen Âge à l’époque mo<strong>de</strong>rne. L’histoire <strong>de</strong> Venise a été traversée par <strong>de</strong>s va et vient<br />
entre mythe, anti-mythe et contre-mythe 197 . Pourtant, malgré les tentatives <strong>de</strong> nombreux<br />
historiens, nul n’est réellement parvenu à déconstruire le mythe <strong>de</strong> la stabilité et <strong>de</strong> la<br />
cohésion sociale vénitiennes, ni à expliquer la solidité <strong>de</strong> ce lien. Venise était, à la fin du<br />
Moyen Âge, l’une <strong>de</strong>s plus gran<strong>de</strong>s villes d’Occi<strong>de</strong>nt, entre 120 000 et 150 000 habitants. Elle<br />
n’en était pas moins la capitale <strong>de</strong> l’un <strong>de</strong>s États les plus stables et puissants d’Italie du nord.<br />
Certains conflits politiques retentissants avaient émaillé l’histoire <strong>de</strong> la ville, en particulier au<br />
196 P. Fortini Brown, Venetian Narrative Painting in the Age of Carpaccio, New Haven and London, 1988. Voir aussi E.<br />
Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton, 1981.<br />
197 J. S. Grubb, « When Myths Lose Power : Four Deca<strong>de</strong>s of Venetian Historiography », The Journal of Mo<strong>de</strong>rn History,<br />
LVIII, n°1, 1986, p. 43-94<br />
116