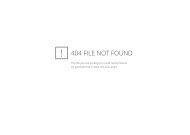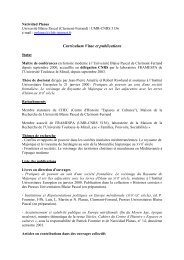Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Troisième République 267 ? La thèse soutenue est celle d’une hostilité avignonnaise aux vicelégats<br />
italiens et à leurs juridictions, hostilité étendue à tout le personnel italien à leur service.<br />
C’est aussi celle d’une fascination pour la monarchie française qui offre protection et<br />
privilèges (notamment celui <strong>de</strong> régnicolité permettant <strong>de</strong>puis 1536 aux sujets du pape<br />
d’exercer <strong>de</strong>s offices civils et militaires en France 268 ). Les entrées royales offertes à Avignon<br />
aux souverains français (Marie <strong>de</strong> Médicis en 1600, Louis XIII en 1622, Louis XIV en 1660)<br />
sont <strong>de</strong>s manifestations <strong>de</strong> respect envers le roi Très-Chrétien capable, beaucoup mieux que le<br />
pape, <strong>de</strong> protéger les enclaves contre les huguenots ou <strong>de</strong> pacifier la cité après un temps <strong>de</strong><br />
révolte. Ainsi se caractériserait une tentation avignonnaise <strong>de</strong> s’offrir au roi <strong>de</strong> France qui<br />
culminerait avec l’accueil enthousiaste fait à l’occupation française <strong>de</strong> 1663-1664, après<br />
l’affaire <strong>de</strong>s gar<strong>de</strong>s corses. Les Comtadins seraient en revanche plus réservés dans la mesure<br />
où les liens avec la France seraient moins étendus, notamment parmi les élites, plus mo<strong>de</strong>stes<br />
et où existerait une rivalité judiciaire entre Carpentras et Avignon. Le Comtat aurait<br />
davantage souffert qu’Avignon <strong>de</strong> l’introduction du système judiciaire français.<br />
Paradoxalement, c’est la présence <strong>de</strong> l’échelon le plus haut du pouvoir local qui aurait créé<br />
une forte agitation à Avignon au milieu du XVII e siècle. La corruption <strong>de</strong>s gouvernants<br />
italiens est visée par les sources contemporaines et cet argument est repris à l’i<strong>de</strong>ntique par les<br />
historiens.<br />
Mais l’attitu<strong>de</strong> ambiguë <strong>de</strong> Louis XIV est aussi pointée : ce roi joue <strong>de</strong> son prestige en 1663-<br />
1664 pour convaincre les Avignonnais <strong>de</strong> soutenir sa politique <strong>de</strong> rétorsion vis-à-vis du pape<br />
mais il abandonne ensuite la ville aux mesures répressives <strong>de</strong>s vice-légats une fois qu’il a<br />
obtenu satisfaction, malgré les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la cité. Cet épiso<strong>de</strong>, qui aurait pu<br />
être un moment <strong>de</strong> gloire pour une ville accomplissant le <strong>de</strong>stin qu’elle s’était tracée, consacre<br />
donc au contraire le déclin du rôle politique d’Avignon et du Comtat Venaissin sur la scène<br />
politique européenne. L’histoire <strong>de</strong>s enclaves pontificales serait ainsi le reflet du renforcement<br />
du gallicanisme et <strong>de</strong> l’absolutisme louis-quatorzien. La « trahison » <strong>de</strong> Louis XIV est<br />
interprétée par P. Charpenne comme l’illustration <strong>de</strong> l’arbitraire monarchique : l’idéologie<br />
républicaine et anticléricale <strong>de</strong> l’auteur se donne ici libre cours.<br />
C’est aussi en terme <strong>de</strong> psychologie <strong>de</strong>s peuples qu’est écrite l’histoire <strong>de</strong>s enclave. Pour P.<br />
Charpenne, l’opposition entre la noblesse et le « peuple » structure les relations sociales au<br />
milieu du XVII e siècle. Le conflit entre pévoulins (les « pouilleux » désignant le parti<br />
populaire) et pessugaux (les nobles qualifiés <strong>de</strong> « pressureurs »), entre 1652 et 1658, surjoue<br />
cet antagonisme, même si certains nobles soutiennent les revendications populaires, au moins<br />
au début <strong>de</strong> la révolte, comme Louis <strong>de</strong> Berton, baron <strong>de</strong> Crillon. Au cours du déroulement<br />
<strong>de</strong>s événements, les fractures sociales et politiques s’avèrent plus complexes : sans rentrer<br />
dans le détail <strong>de</strong>s récits qui ont servi presque exclusivement à écrire cette histoire 269 , il<br />
apparaît que les clivages traversent les élites avignonnaises en fonction d’enjeux qui sont<br />
souvent mal définis. Les principaux chefs pessugaux quittent Avignon pour Carpentras<br />
pendant l’été 1653, après le pillage <strong>de</strong> plusieurs maisons <strong>de</strong> nobles. Ils se regroupent autour<br />
du cardinal Bichi, le puissant évêque <strong>de</strong> Carpentras, qui défend leurs intérêts auprès <strong>de</strong> Rome,<br />
et ne reviennent à Avignon qu’au cours <strong>de</strong> l’année 1656, après que <strong>de</strong>s émeutes violentes en<br />
novembre 1655 ont débordé les chefs pévoulins et montré leur incapacité à maîtriser le<br />
267 . P. CHARPENNE, Histoire <strong>de</strong>s réunions temporaires d’Avignon et du Comtat Venaissin à la France, Paris, Clamnn Lévy,<br />
1886, T. I ; J. MERITAN, « Les troubles et émeutes d’Avignon (1652-1659) », Mémoires <strong>de</strong> l’Académie <strong>de</strong> Vaucluse, 2 ème<br />
série, T. I, 1901, p. 1-83.<br />
268 . Ce privilège fut octroyé aux Avignonnais et Comtadins en 1536 pour les remercier <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> apportée à l’armée du roi <strong>de</strong><br />
France contre les troupes <strong>de</strong> Charles Quint qui avaient envahi la Provence. Cf. R. PERETTI, Les Avignonnais et les Comtadins<br />
régnicoles, Avignon, 1922 ; Ed. GOUBET, « Quatre siècles <strong>de</strong> diplomatie royale à l’égard <strong>de</strong> la colonie pontificale d’Avignon<br />
et du Comtat Venaissin », Mémoires <strong>de</strong> l’Académie <strong>de</strong> Vaucluse, 3 ème série, T. VII, 1942, p. 51-83.<br />
269 . J. MERITAN fournit une analyse détaillée <strong>de</strong>s sources qu’il a utilisées : il s’agit <strong>de</strong> mémoires et récits, <strong>de</strong> règlements,<br />
d’archives familiales et <strong>de</strong> pièces <strong>de</strong> procédures criminelles, tous documents tirés <strong>de</strong>s manuscrits conservés à la bibliothèque<br />
municipale d’Avignon. La correspondance <strong>de</strong>s consuls et les archives municipales ne sont pas utilisées.<br />
149