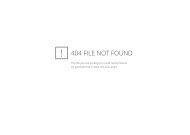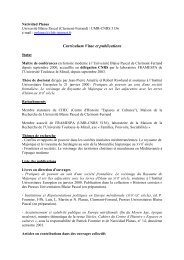Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il n’est pas possible non plus d’opposer un parti français à un parti italien. Le factum <strong>de</strong> Cursi<br />
suggère une opposition entre ses partisans et ceux <strong>de</strong> Bichi. Peut-on assimiler ces <strong>de</strong>rniers à<br />
un parti français alors qu’ils ont déclenché les troubles en engageant la lutte contre les<br />
fermiers <strong>de</strong> la douane française ? Quant à Crillon, il prend soin <strong>de</strong> mettre en avant sa fidélité<br />
au pape et sommé par Bichi <strong>de</strong> se prononcer entre lui et le vice-légat, il affirme selon le<br />
factum <strong>de</strong> Cursi qu’un Etat ecclésiastique ne peut avoir d’autre parti que celui du Saint-Siège.<br />
Cela fait-il <strong>de</strong> lui un « italien » alors que sa famille s’est illustrée au service <strong>de</strong> la France et<br />
qu’il est lui-même gentilhomme <strong>de</strong> la chambre du roi ? Le « peuple » qu’il défend revendique<br />
en tout cas une amélioration <strong>de</strong>s relations avec la France pour qu’elle rétablisse les privilèges<br />
<strong>de</strong> la ville et du Comtat. L’implication <strong>de</strong> certains nobles avignonnais dans les récentes luttes<br />
provençales est rappelée à charge : les pévoulins font ainsi grief au marquis <strong>de</strong> la Rousselle<br />
d’avoir soutenu le comte d’Alais contre le roi, ce qui est une curieuse interprétation <strong>de</strong>s<br />
événements provençaux et prouve la confusion <strong>de</strong>s esprits. Quoi qu’il en soit, la Rousselle<br />
aurait lésé les intérêts <strong>de</strong>s Comtadins et <strong>de</strong>s Avignonnais qui possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s biens nombreux<br />
au sud <strong>de</strong> la Durance, dans <strong>de</strong>s villages soumis au pillage <strong>de</strong>s troupes du comte d’Alais.<br />
L’hostilité affichée n’est pas tournée contre le roi <strong>de</strong> France mais contre les partisans du<br />
gouverneur présenté comme un traître. Cela confirme que l’objectif <strong>de</strong>s révoltés est une<br />
normalisation <strong>de</strong>s relations avec la France, non une hostilité à celle-ci. Cursi a certes intérêt à<br />
présenter ses adversaires comme opposés au respect <strong>de</strong>s juridictions respectives : « Plusieurs<br />
<strong>de</strong>s nobles retirés <strong>de</strong> la ville [c’est-à-dire ayant accompagné Bichi à Carpentras], poussés <strong>de</strong><br />
rage, entreprenoient mesme <strong>de</strong> mettre <strong>de</strong> la division entre la jurisdiction du pape et du Roy,<br />
sur le pont du Rhosne qui fait la séparation <strong>de</strong> Villeneufve avec Avignon ». Il n’en reste pas<br />
moins que l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pessugaux apparaît comme équivoque.<br />
Les textes qui concernent la pério<strong>de</strong> postérieure au départ <strong>de</strong> Cursi confirment que<br />
l’opposition entre la France et Rome est artificielle. L’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pévoulins montre un jeu<br />
constant entre la France et le Saint-Siège. L’arrivée <strong>de</strong> Conti à la vice-légation à la fin <strong>de</strong><br />
l’année 1655, après les émeutes <strong>de</strong> novembre, est suivie <strong>de</strong> l’exil <strong>de</strong>s chefs pévoulins, dont<br />
Crillon et Suarez, tandis que d’autres quittent volontairement la ville par peur <strong>de</strong>s représailles.<br />
Les nobles qui avaient accompagné Bichi à Carpentras rentrent au contraire à Avignon. Les<br />
chefs pévoulins, beaucoup plus que les pessugaux, jouent <strong>de</strong> la double fidélité au pape et au<br />
roi. Ainsi, Crillon exilé se rend-il à Montélimar, en terre française, avant d’aller se justifier à<br />
Rome 292 où il obtient assez facilement la reconnaissance <strong>de</strong> son innocence : pour les autorités<br />
pontificales, il ne semble pas constituer un danger, même si son image peut être utilisée par<br />
<strong>de</strong>s agitateurs et s’il reconnaît lui-même avoir fait ériger <strong>de</strong>s barrica<strong>de</strong>s en 1653 et fait prendre<br />
la paille à ses partisans comme signe <strong>de</strong> reconnaissance. Cette action aurait été menée en<br />
concertation avec le vice-légat pour lutter contre les ennemis <strong>de</strong> celui-ci. Le soutien apporté<br />
au vice-légat est fréquemment mentionné. Le baron rappelle aussi qu’il s’est opposé à Louis<br />
Pallis, un autre noble, « parce qu’il lisoit un libelle diffamatoire contre le roy et la reine <strong>de</strong><br />
France ». La volonté <strong>de</strong> préserver les relations entre Rome et la monarchie française est donc<br />
présentée par Crillon comme la motivation principale <strong>de</strong> son attitu<strong>de</strong>.<br />
Le séjour du roi à Avignon du 19 mars au 1 er avril 1660 intervient dans un contexte pacifié<br />
mais toujours tendu 293 . Pour Louis XIV, cette visite dans la cité pontificale s’inscrit dans une<br />
longue tradition : François I er en 1516, 1524 et 1533, Charles IX en 1564, Henri III en<br />
1574 294 , Marie <strong>de</strong> Médicis en 1600 et Louis XIII en 1622 ont été reçus avec tous les honneurs<br />
dans la ville pontificale, l’intégrant dans <strong>de</strong>s parcours aux motivations diverses comme<br />
292 . Bibl. Mun. Avignon, ms 3357, f° 140 sqq., « Justification <strong>de</strong> M. <strong>de</strong> Crillon » publiée dans J. MERITAN, « Les troubles et<br />
émeutes d’Avignon (1652-1659) », art. cité, p. 79-81.<br />
293 . Histoire d’Avignon, Aix-en-Provence, Edisud, 1979, p. 405-406.<br />
294 . En prenant l’habit <strong>de</strong>s pénitents blancs d’Avignon, Henri III montre toute l’importance qu’il accor<strong>de</strong> au rôle religieux<br />
d’Avignon. Cf. M. VENARD, Réforme protestante, Réforme catholique dans la province d’Avignon (XVIe siècle), Paris, Cerf,<br />
1993, p. 870.<br />
157