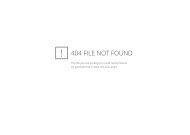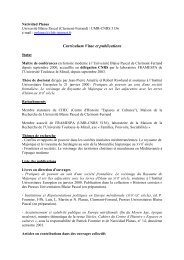Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
est pourtant confirmé le 6 mars par le conseil <strong>de</strong>s finances tandis que les Avignonnais<br />
multiplient plaintes et procès-verbaux à l’encontre <strong>de</strong>s commis qui lèveraient <strong>de</strong>s droits indus<br />
sur les marchandises entrant dans leur ville et dans le Comtat.<br />
Une audience accordée par le roi au marquis <strong>de</strong> Pérussis le 13 mars accélère le règlement <strong>de</strong><br />
l’affaire. Dans la lettre qu’il envoie au conseil d’Avignon, Pérussis met en avant le geste <strong>de</strong><br />
Louis XIV <strong>de</strong>stiné à apaiser les tensions : il a été reçu comme un ambassa<strong>de</strong>ur et le roi a<br />
assuré Avignon et le Comtat <strong>de</strong> sa protection. Les reines (Anne d’Autriche et Marie-Thérèse)<br />
reçoivent aussi Pérussis le 20 mars 285 . Dans les faits, l’arrêt du 2 mars est maintenu mais<br />
Etienne d’Aligre intervient pour arrêter les abus du fermier et une fois le délai expiré, lui et<br />
Colbert font rétablir les bureaux en Dauphiné tandis que ceux placés sur la Durance sont<br />
abandonnés. Le conflit se termine donc à l’avantage <strong>de</strong>s sujets du pape. Ce <strong>de</strong>rnier se montre<br />
très satisfait <strong>de</strong> la manière dont le problème a été réglé. Pour la monarchie française, le<br />
résultat est comparable à celui obtenu en 1652 : la situation douanière mise en place entre<br />
1634 et 1647 est maintenue mais l’autorité <strong>de</strong>s agents du roi est démontrée et la possibilité<br />
pour les fermiers <strong>de</strong> la foraine <strong>de</strong> surveiller activement les activités <strong>de</strong> contreban<strong>de</strong> est<br />
renforcée. Entre ces <strong>de</strong>ux épiso<strong>de</strong>s, la « fron<strong>de</strong> avignonnaise » (1652-1658) a <strong>de</strong>s racines plus<br />
profon<strong>de</strong>s que les seules questions douanières et ses enjeux sociaux doivent être éclaircis pour<br />
comprendre les spécificités <strong>de</strong>s relations entre Avignon et la monarchie française.<br />
3. Un « parti » italien contre un « parti » français : les faux-semblants d’une opposition<br />
complexe<br />
La pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s troubles avignonnais (le Comtat restant relativement calme) correspond<br />
à un moment d’intense agitation dans la Provence voisine, sans qu’un lien direct entre ces<br />
événements puisse être établi 286 . Les crises provençales se caractérisent par l’extrême<br />
diversité <strong>de</strong>s cas : Aix, Marseille, Tarascon, Toulon et Draguignan notamment connaissent<br />
<strong>de</strong>s insurrections et <strong>de</strong>s agitations politiques qui témoignent davantage <strong>de</strong> rivalités locales que<br />
<strong>de</strong> choix nationaux ou même provinciaux. En revanche, Mazarin choisit <strong>de</strong> soutenir telle ou<br />
telle faction en fonction <strong>de</strong> l’intérêt qu’elle semble représenter pour l’autorité royale,<br />
s’appuyant notamment sur la personne du baron d’Oppè<strong>de</strong> à Aix, qui joue le rôle d’un<br />
intendant sans en avoir le titre. A Marseille, Mazarin et Louis XIV, qui ne trouvent pas <strong>de</strong><br />
personnalité suffisamment forte pour rétablir l’ordre, préfèrent humilier la ville par une<br />
occupation militaire et une entrée du roi par une brèche effectuée dans les remparts, inversion<br />
<strong>de</strong>s rituels traditionnels d’entrée royale.<br />
La Fron<strong>de</strong> provençale n’a pas la même gravité que dans d’autres provinces, notamment dans<br />
le Bassin Parisien, malgré les ravages d’une partie du bassin aixois en 1649 287 . Les<br />
événements qui déclenchent la crise avignonnaise se produisent alors que la situation est<br />
confuse en Provence après l’échec du gouverneur, le comte d’Alais, rappelé auprès <strong>de</strong> la Cour<br />
française. Toutefois, un personnage important appelé à jouer un rôle déterminant dans les<br />
affaires avignonnaises est intervenu en Provence : c’est le cardinal Bichi, évêque <strong>de</strong><br />
Carpentras, considéré comme un émissaire <strong>de</strong> Mazarin dans la région. Entre février et avril<br />
1649, il a négocié une paix qui permet <strong>de</strong> réconcilier les parlementaires aixois, divisés sur la<br />
question du « semestre » 288 , et <strong>de</strong> faire libérer le comte d’Alais, prisonnier du parlement<br />
<strong>de</strong>puis plusieurs semaines. Le cardinal est utilisé pour ses relations au sein <strong>de</strong>s élites aixoises.<br />
285 . Arch. Mun. Avignon, AA 69, pièce 48, lettre du 28 mars 1662.<br />
286 . Ibid., p. 567-862.<br />
287 . R. PILLORGET, S. PILLORGET, France baroque. France classique (1589-1715), Paris, Robert Laffont, 1995, T. I, p. 535-<br />
536 et 556-557.<br />
288 . Le « semestre », ou parlement semestre, double le parlement aixois par la création d’un nouveau corps d’officiers appelés<br />
à siéger six mois par an en alternance avec les « anciens » officiers, ce qui entraîne la création et la vente <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> trente<br />
nouveaux offices.<br />
155