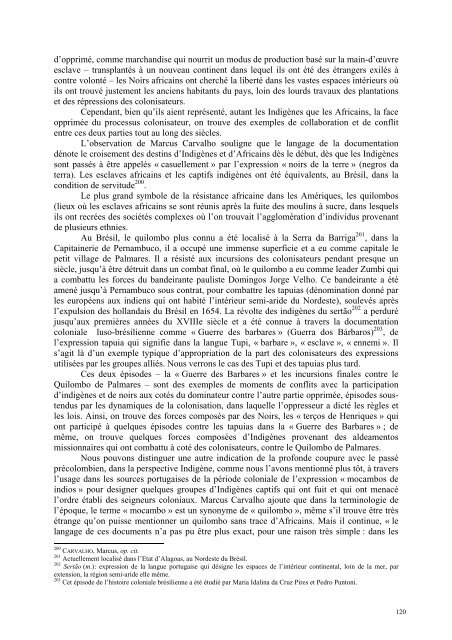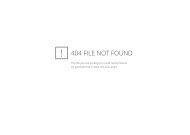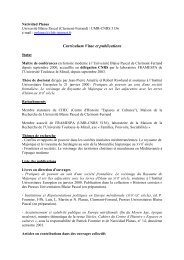Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
d’opprimé, comme marchandise qui nourrit un modus <strong>de</strong> production basé sur la main-d’œuvre<br />
esclave – transplantés à un nouveau continent dans lequel ils ont été <strong>de</strong>s étrangers exilés à<br />
contre volonté – les Noirs africains ont cherché la liberté dans les vastes espaces intérieurs où<br />
ils ont trouvé justement les anciens habitants du pays, loin <strong>de</strong>s lourds travaux <strong>de</strong>s plantations<br />
et <strong>de</strong>s répressions <strong>de</strong>s colonisateurs.<br />
Cependant, bien qu’ils aient représenté, autant les Indigènes que les Africains, la face<br />
opprimée du processus colonisateur, on trouve <strong>de</strong>s exemples <strong>de</strong> collaboration et <strong>de</strong> conflit<br />
entre ces <strong>de</strong>ux parties tout au long <strong>de</strong>s siècles.<br />
L’observation <strong>de</strong> Marcus Carvalho souligne que le langage <strong>de</strong> la documentation<br />
dénote le croisement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>stins d’Indigènes et d’Africains dès le début, dès que les Indigènes<br />
sont passés à être appelés « casuellement » par l’expression « noirs <strong>de</strong> la terre » (negros da<br />
terra). Les esclaves africains et les captifs indigènes ont été équivalents, au Brésil, dans la<br />
condition <strong>de</strong> servitu<strong>de</strong> 200 .<br />
Le plus grand symbole <strong>de</strong> la résistance africaine dans les Amériques, les quilombos<br />
(lieux où les esclaves africains se sont réunis après la fuite <strong>de</strong>s moulins à sucre, dans lesquels<br />
ils ont recrées <strong>de</strong>s sociétés complexes où l’on trouvait l’agglomération d’individus provenant<br />
<strong>de</strong> plusieurs ethnies.<br />
Au Brésil, le quilombo plus connu a été localisé à la Serra da Barriga 201 , dans la<br />
Capitainerie <strong>de</strong> Pernambuco, il a occupé une immense superficie et a eu comme capitale le<br />
petit village <strong>de</strong> Palmares. Il a résisté aux incursions <strong>de</strong>s colonisateurs pendant presque un<br />
siècle, jusqu’à être détruit dans un combat final, où le quilombo a eu comme lea<strong>de</strong>r Zumbi qui<br />
a combattu les forces du ban<strong>de</strong>irante pauliste Domingos Jorge Velho. Ce ban<strong>de</strong>irante a été<br />
amené jusqu’à Pernambuco sous contrat, pour combattre les tapuias (dénomination donné par<br />
les européens aux indiens qui ont habité l’intérieur semi-ari<strong>de</strong> du Nor<strong>de</strong>ste), soulevés après<br />
l’expulsion <strong>de</strong>s hollandais du Brésil en 1654. La révolte <strong>de</strong>s indigènes du sertão 202 a perduré<br />
jusqu’aux premières années du XVIIIe siècle et a été connue à travers la documentation<br />
coloniale luso-brésilienne comme « Guerre <strong>de</strong>s barbares » (Guerra dos Bárbaros) 203 , <strong>de</strong><br />
l’expression tapuia qui signifie dans la langue Tupi, « barbare », « esclave », « ennemi ». Il<br />
s’agit là d’un exemple typique d’appropriation <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s colonisateurs <strong>de</strong>s expressions<br />
utilisées par les groupes alliés. Nous verrons le cas <strong>de</strong>s Tupi et <strong>de</strong>s tapuias plus tard.<br />
Ces <strong>de</strong>ux épiso<strong>de</strong>s – la « Guerre <strong>de</strong>s Barbares » et les incursions finales contre le<br />
Quilombo <strong>de</strong> Palmares – sont <strong>de</strong>s exemples <strong>de</strong> moments <strong>de</strong> conflits avec la participation<br />
d’indigènes et <strong>de</strong> noirs aux cotés du dominateur contre l’autre partie opprimée, épiso<strong>de</strong>s soustendus<br />
par les dynamiques <strong>de</strong> la colonisation, dans laquelle l’oppresseur a dicté les règles et<br />
les lois. Ainsi, on trouve <strong>de</strong>s forces composés par <strong>de</strong>s Noirs, les « terços <strong>de</strong> Henriques » qui<br />
ont participé à quelques épiso<strong>de</strong>s contre les tapuias dans la « Guerre <strong>de</strong>s Barbares » ; <strong>de</strong><br />
même, on trouve quelques forces composées d’Indigènes provenant <strong>de</strong>s al<strong>de</strong>amentos<br />
missionnaires qui ont combattu à coté <strong>de</strong>s colonisateurs, contre le Quilombo <strong>de</strong> Palmares.<br />
Nous pouvons distinguer une autre indication <strong>de</strong> la profon<strong>de</strong> coupure avec le passé<br />
précolombien, dans la perspective Indigène, comme nous l’avons mentionné plus tôt, à travers<br />
l’usage dans les sources portugaises <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> coloniale <strong>de</strong> l’expression « mocambos <strong>de</strong><br />
índios » pour <strong>de</strong>signer quelques groupes d’Indigènes captifs qui ont fuit et qui ont menacé<br />
l’ordre établi <strong>de</strong>s seigneurs coloniaux. Marcus Carvalho ajoute que dans la terminologie <strong>de</strong><br />
l’époque, le terme « mocambo » est un synonyme <strong>de</strong> « quilombo », même s’il trouve être très<br />
étrange qu’on puisse mentionner un quilombo sans trace d’Africains. Mais il continue, « le<br />
langage <strong>de</strong> ces documents n’a pas pu être plus exact, pour une raison très simple : dans les<br />
200 CARVALHO, Marcus, op. cit.<br />
201 Actuellement localisé dans l’Etat d’Alagoas, au Nor<strong>de</strong>ste du Brésil.<br />
202 Sertão (m.): expression <strong>de</strong> la langue portugaise qui désigne les espaces <strong>de</strong> l’intérieur continental, loin <strong>de</strong> la mer, par<br />
extension, la région semi-ari<strong>de</strong> elle même.<br />
203 Cet épiso<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’histoire coloniale brésilienne a été étudié par Maria Idalina da Cruz Pires et Pedro Puntoni.<br />
120