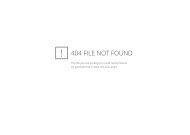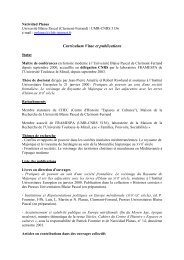Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
davantage utile en conservant son statut <strong>de</strong> ville pontificale au cœur du royaume qu’en<br />
<strong>de</strong>venant une ville provençale ordinaire.<br />
*<br />
Fortement intégrée à l’espace français, Avignon est attentive au respect <strong>de</strong> ses<br />
privilèges à la fois par les représentants du pape et par la monarchie française : c’est le<br />
comportement normal <strong>de</strong> toute ville d’Ancien Régime accentué par la situation géographique<br />
et politique spécifique <strong>de</strong> la cité pontificale. Il faut en revanche insister sur l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
France qui, jusqu’au mariage <strong>de</strong> Louis XIV au moins, n’a aucun intérêt à un affrontement<br />
avec le Saint-Siège à propos du Comtat. Seules les circonstances politiques expliquent<br />
l’occupation <strong>de</strong> 1663-1664 qui crée une situation nouvelle en montrant que les élites<br />
avignonnaises pourraient s’accommo<strong>de</strong>r facilement d’une intégration à la France mais qui n’a<br />
pas été préparée. Les conflits douaniers <strong>de</strong> 1652 et 1662, le second précédant <strong>de</strong> quelques<br />
mois l’affaire <strong>de</strong>s gar<strong>de</strong>s corses, montre au contraire qu’Avignon a tout intérêt à défendre ses<br />
droits contre les empiètements <strong>de</strong>s fermiers français et que sa situation d’enclave étrangère<br />
l’ai<strong>de</strong> à jouer d’arguments divers pour maintenir le statu quo. Ses liens avec la Provence<br />
voisine sont étroits mais la collaboration sur un pied d’égalité avec les élites provençales est<br />
rendue plus facile par la dépendance à l’égard d’une souveraineté étrangère.<br />
Il faut se gar<strong>de</strong>r aussi <strong>de</strong> penser la ville d’Avignon comme un bloc faisant front face à<br />
la menace française. Certes, la pression française est réelle : elle a surtout pour but <strong>de</strong><br />
contrôler les <strong>de</strong>ux rives du Rhône et <strong>de</strong> la Durance afin <strong>de</strong> maîtriser dans leur totalité ces<br />
voies d’eau essentielles et <strong>de</strong> limiter la contreban<strong>de</strong>. Mais cette pression n’est pas si forte<br />
qu’elle nécessiterait constamment une unanimité <strong>de</strong>s élites avignonnaises. Pendant les<br />
troubles comme dans les négociations <strong>de</strong> 1662, <strong>de</strong>s voies discordantes se font entendre avec<br />
plus ou moins <strong>de</strong> vigueur. M. <strong>de</strong> la Falèche, victime du pillage <strong>de</strong> sa maison par les émeutiers<br />
en 1653 et premier consul opposé à la majorité du conseil en 1662, incarne les hésitations <strong>de</strong><br />
la noblesse, partagée entre l’hostilité aux commis <strong>de</strong> la ferme française et une attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
conciliation <strong>de</strong>stinée à attirer la bienveillance française. Mais la noblesse avignonnaise est<br />
constamment divisée sur l’attitu<strong>de</strong> à adopter, sans que sa vision <strong>de</strong>s rapports avec la France<br />
apparaisse avec beaucoup <strong>de</strong> netteté. Le baron <strong>de</strong> Crillon, d’une envergure supérieure à celle<br />
<strong>de</strong> ses concitoyens, choisit la fidélité politique au Saint-Siège et la fidélité personnelle au roi<br />
<strong>de</strong> France, attitu<strong>de</strong> la plus cohérente qui explique son prestige local.<br />
Beaucoup reste à faire pour comprendre la manière dont se construit le lien social à<br />
Avignon et dans le Comtat au XVII e siècle. Une prosopographie <strong>de</strong>s familles nobles (qu’elles<br />
appartiennent à l’épée ou à la robe) mise en relation avec leur carrière et leurs choix politiques<br />
permettrait <strong>de</strong> mieux saisir les modalités et les enjeux <strong>de</strong>s affrontements du milieu du siècle<br />
mais aussi <strong>de</strong> mettre à jour le fonctionnement <strong>de</strong>s relations sociales <strong>de</strong>s élites sur le long<br />
terme et <strong>de</strong> comprendre les liens entre familles avignonnaises, comtadines, provençales ou<br />
d’autres provinces françaises. L’attitu<strong>de</strong> du « peuple », perçue surtout à travers le regard <strong>de</strong><br />
ces élites, est plus difficile à décrypter. Nul doute cependant que bourgeois et artisans ne sont<br />
pas unanimes non plus : les émotions populaires sont plus ou moins radicales et les meneurs<br />
les plus violents lors <strong>de</strong>s émeutes <strong>de</strong> novembre 1655 sont arrêtés et exécutés. Malgré les<br />
pillages <strong>de</strong> certaines maisons, la répression <strong>de</strong>s troubles s’opère assez facilement sans<br />
intervention extérieure et sans inquiéter fortement la France. Le vice-légat et la noblesse<br />
locale s’organisent pour quadriller la ville et contenir les foules : en novembre 1655, une<br />
certaine unité se reforme pour empêcher l’extension <strong>de</strong>s désordres avant que le retour au<br />
calme ne laisse resurgir les vieilles querelles. Les élites locales jouent donc <strong>de</strong> la situation<br />
frontalière, l’intégrant dans leurs comportements en fonction d’intérêts immédiats et en<br />
soupesant les rapports <strong>de</strong> force. Elles ont plus directement affaire au roi <strong>de</strong> France<br />
159